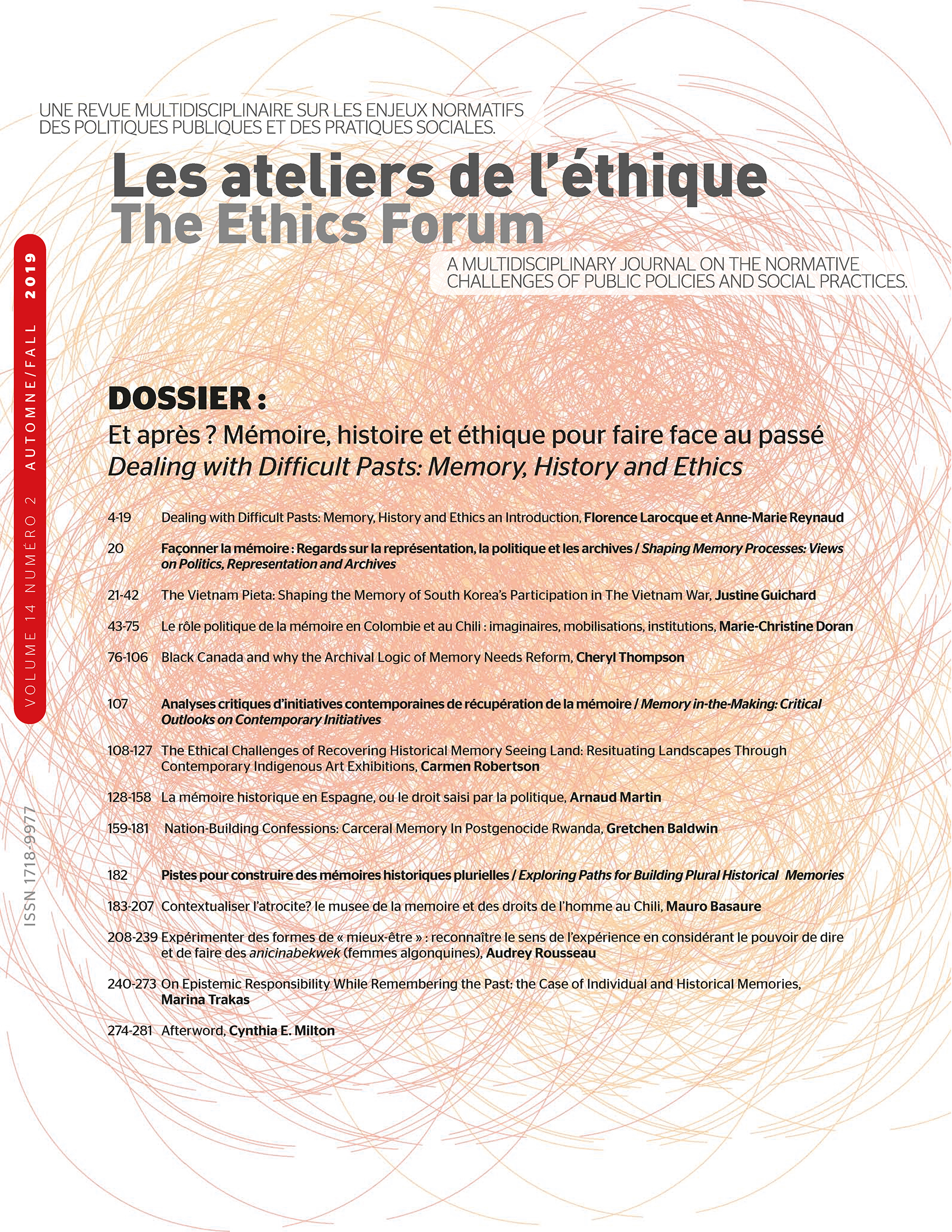Abstracts
Résumé
Le 29 août 2018, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez annonça la création d’une commission de la vérité sur les crimes commis durant la guerre civile et la dictature franquiste. Ainsi devait prendre officiellement fin la politique d’impunité et d’amnésie politique imposée au peuple espagnol au lendemain de la mort du général Franco par la loi du 15 octobre 1977, confirmée trente ans plus tard par la loi du 26 décembre 2007, comme contrepartie des mesures d’amnistie prises en faveur des condamnés politiques et comme prix à payer pour assurer la réussite du processus consensuel de transition démocratique. La mémoire historique qui avait été refusée aux Espagnols allait pouvoir devenir réalité.
La commission s’inscrit de façon originale dans la logique de la justice transitionnelle. En effet, l’élaboration de la vérité historique annoncée par Pedro Sánchez a pour but, non pas d’assurer la transition démocratique et la pacification d’une société postconflictuelle, mais de prévenir la « déconsolidation » démocratique à laquelle pourraient conduire la non-reconnaissance des torts subis par les victimes du franquisme et l’impossibilité de l’Espagne – notamment de la droite – à tourner la page du franquisme.
Abstract
On August 29, 2018, the president of the Spanish government, Pedro Sánchez, announced the forthcoming creation of a truth commission on crimes committed during the civil war and the Franco dictatorship. This was the official end to the policy of impunity and political amnesia imposed on the Spanish people in the aftermath of the death of General Franco by the law of October 15, 1977, and confirmed thirty years later by the law of December 26, 2007, as a counterpart to the amnesty measures taken in favour of those sentenced politically and as a price to be paid to ensure the success of the consensual democratic transition process. The elaboration of the historical memory that had been denied to the Spanish people was going to become a reality.
The future commission is an original part of the logic of transitional justice. Indeed, the elaboration of the historical truth announced by Pedro Sánchez is intended not to ensure the democratic transition and pacification of a postconflict society, but to prevent the democratic “deconsolidation” that could result from the nonrecognition of the wrongs suffered by the victims of Francoism and from Spain’s refusal—especially on the right—to turn the page on Francoism.
Article body
Le 29 août 2018, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez annonça la création d’une commission de la vérité sur les crimes commis durant la guerre civile et la dictature franquiste, dite « commission de la vérité historique ».[1] Ainsi devait prendre officiellement fin la politique d’amnésie imposée au peuple espagnol au lendemain de la mort du général Franco, en accompagnement des mesures d’amnistie prises en faveur des condamnés politiques et comme prix à payer pour assurer la réussite du processus de transition démocratique[2] dans lequel le roi Juan Carlos avait décidé d’engager l’Espagne et qui nécessitait comme préalable un consensus des forces politiques sur l’instauration d’une monarchie parlementaire.[3] La déclaration de Pedro Sánchez constituait ainsi un tournant majeur dans la politique menée par les gouvernements successifs depuis 1977 à l’égard du passé franquiste de l’Espagne, et annonçait ainsi l’élaboration tant attendue de la mémoire historique[4] qui avait été si longtemps refusée aux Espagnols.
Le fait que, dans un pays qui a connu une guerre civile particulièrement meurtrière et trente-cinq ans de dictature, il ait fallu attendre plus de quarante ans pour que le gouvernement annonce la création d’une commission de la vérité historique ne peut manquer de surprendre. En effet, l’élaboration de la mémoire historique[5] constitue un facteur essentiel de consolidation démocratique, à tel point que de nombreux pays touchés par la troisième vague de démocratisation (Huntington, 1991), notamment en Amérique latine[6], ont créé une commission de la vérité et de la réconciliation[7], laquelle fait partie de « l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en oeuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation (Rapport du Secrétaire général des Nations unies, 23 août 2004) », qui définissent, selon l’Organisation des Nations unies, la justice transitionnelle.[8] L’Europe, en revanche, a tardé à s’engager dans cette voie. La France, par exemple, a dû attendre le 16 juillet 1995 et la commémoration de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942 pour qu’un chef d’État, le président Jacques Chirac, évoque officiellement les « fautes du passé » et reconnaisse la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs.[9] « L’irruption de la mémoire dans le champ des études historiques n’est pas […] une spécificité espagnole », mais « s’inscrit dans le cadre d’un contexte européen qui voit s’affronter [des] héritiers de tel ou tel camp qui revendiquent parfois l’adoption de textes juridiques qui ont pour effet de figer l’interprétation d’une histoire qui s’écrit alors dans les Parlements et les prétoires des tribunaux, et non dans les bibliothèques des historiens (De Prémonville, 2013) ».[10]
Peut-on considérer la décision de créer une commission de la vérité historique en Espagne comme un recours à la justice transitionnelle ? Si tel est le cas, il s’agirait d’une application sui generis. En effet, la justice transitionnelle vise quatre objectifs connus comme les « principes Joinet (Joinet, 1996) » : le droit de savoir et le droit à la vérité ; le droit à la justice à la suite des violations des droits de l’homme du passé et la lutte contre l’impunité ; les politiques de réparation comme moyen de restauration de la dignité des victimes ; les réformes institutionnelles et les garanties de non-répétition.[11] Or, l’Espagne a justement emprunté la démarche inverse pour réussir sa transition démocratique. Elle a préféré jeter un voile sur les crimes commis durant la guerre civile (1936-1939) et la dictature franquiste (1939-1975), quitte à entretenir un sentiment de profonde injustice chez les descendants des centaines de milliers de morts, d’exilés et de disparus. La loi du 15 octobre 1977, dite « pacte d’oubli »,[12] proclama une amnistie qui bénéficiait principalement aux franquistes en interdisant toute enquête sur les crimes commis durant les quatre dernières décennies. Appliquée avec zèle par les différents gouvernements, quelle que soit leur tendance politique, cette loi empêcha l’établissement de la vérité historique sur la période franquiste, vérité qui aurait aidé les victimes et leurs familles à tourner une page de leur histoire personnelle mais dont on craignait qu’elle ne conduisît à déstabiliser la monarchie parlementaire en nourrissant un désir de revanche des républicains et un rejet par les franquistes de la démocratie libérale.
Trente ans plus tard, alors que la réussite de la consolidation démocratique ne faisait aucun doute, le parlement espagnol vota la loi du 26 décembre 2007 « reconnaissant et étendant les droits et établissant des mesures en faveur de ceux qui ont subi des persécutions ou des violences pendant la guerre civile et la dictature », laquelle devait permettre l’établissement de la « mémoire historique ».[13] Son application se heurta à l’hostilité des gouvernements conservateurs et socialistes : la fidélité de la droite à ses racines franquistes et la crainte de la gauche d’une déstabilisation de la démocratie étaient plus fortes que l’aspiration d’une majorité d’Espagnols de voir enfin rédigé le récit historique national de la guerre civile et de la dictature franquiste. Les pouvoirs publics s’opposèrent systématiquement à toute demande individuelle ou collective susceptible de remettre en cause la politique d’impunité décidée par le général Franco et poursuivie par Juan Carlos.
Il apparut finalement inopportun de poursuivre dans cette voie. Depuis une dizaine d’années, la pression de l’opinion publique pour l’établissement de la mémoire historique[14] s’est faite de plus en plus forte, et la découverte de l’ampleur des crimes commis a rendu impossible la poursuite de la politique d’amnésie. De plus, le temps faisant son oeuvre, la plupart des criminels sont morts, et la politique d’impunité ne bénéficie plus à grand monde. Enfin, les victimes du franquisme ont changé : les familles des personnes disparues ou décédées réclament moins la condamnation des coupables que l’établissement ou la reconnaissance des faits pour reconstruire leur histoire personnelle ; de même, la découverte de nouveaux crimes, comme la disparition de centaines de milliers de bébés déclarés morts et enlevés à leurs parents pour être donnés ou vendus à d’autres familles pour des motifs politiques, sociaux ou simplement financiers, rend indispensable l’ouverture d’enquêtes. Ainsi, alors que la politique d’amnistie pouvait apparaître comme le prix à payer pour une transition démocratique réussie, la politique d’amnésie à laquelle elle a conduit risque de devenir un facteur de déstabilisation du régime démocratique.
L’annonce faite par le président du gouvernement Pedro Sánchez répond ainsi à une nécessité politique tout à fait inhabituelle. Il s’agit moins de faciliter la transition ou la consolidation démocratique, achevées depuis trois décennies, que d’éviter une « déconsolidation » démocratique à laquelle pourrait conduire la poursuite de la politique d’amnésie. La création d’une commission de la vérité historique s’inscrit donc à contretemps de la justice transitionnelle, mais l’on peut considérer qu’elle n’en est pas dénuée de tout lien puisqu’elle vient répondre à une attente populaire et qu’elle devrait à ce titre pérenniser la consolidation démocratique.
Pour autant, la création de la commission de la vérité historique, outre le fait qu’elle se fait toujours attendre, soulève de graves difficultés. Venant trop tardivement, elle ne pourra que très accessoirement faire participer les victimes ou leurs descendants, du moins en ce qui concerne la guerre civile ou les premières années de la dictature franquiste, et sa méthode de travail s’écartera inévitablement des commissions de la vérité et de la réconciliation dans le cadre des transitions démocratiques que l’on a connues au cours de la troisième vague de démocratisation. Ne doit-on pas, dans ce cas, laisser l’histoire aux historiens ? En outre, les lois de 1977 et de 2007, qui ont, dans un premier temps, imposé le silence sur la période de la guerre civile et du franquisme avant d’accorder aux Espagnols, dans un second temps, et de façon imparfaite, un droit à la vérité et à la reconnaissance des torts subis, ont contribué à la réussite de la transition et de la consolidation démocratique en violant ouvertement les principes du droit international relatifs aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité. En ce sens, l’annonce de la création d’une commission de la vérité historique va de pair avec celle de la réforme complète de la loi de 2007, mais l’on ne peut être sûr qu’elle conduira à l’abrogation de la loi de 1977, à laquelle, de toute évidence, la droite devrait s’opposer. La création d’une commission de la vérité historique permettra au moins de faire le jour sur quarante ans d’histoire de l’Espagne ; elle aidera ainsi les victimes et leurs familles à voir reconnus les torts qu’elles ont subis, ce qui leur est nécessaire pour tourner la page, comme elle aidera l’Espagne tout entière à reléguer définitivement le franquisme dans les livres d’histoire.
I. La création annoncée d’une commission de la vérité historique
L’annonce, le 31 août 2018, par le président du gouvernement Pedro Sánchez, de la création prochaine d’une commission de la vérité sur les crimes commis durant la guerre civile et la dictature franquiste, n’a pas manqué de surprendre. En effet, la création d’une commission de la vérité est une pratique devenue classique en matière de justice transitionnelle : elle permet d’établir la vérité sur un passé douloureux – une dictature, une guerre civile ou une révolution –, de reconnaître aux victimes et à leurs familles les torts qu’elles ont subis, d’obtenir des coupables qu’ils acceptent d’en assumer la responsabilité, d’élaborer une histoire officielle qui fait office de mémoire collective,[15] et ainsi de permettre aux ennemis d’hier de construire ensemble une société démocratique pacifiée en acceptant de tourner une page et, à défaut de pardonner, de vivre ensemble. Mais dans le cas de l’Espagne, la commission intervenant quarante-quatre ans après la mort du général Franco et l’engagement du processus de démocratisation, on peut douter qu’elle s’inscrive dans la logique de la justice transitionnelle.
A. Une démarche légitime
Pour autant, cette démarche n’est pas dénuée de sens. Certes, si les commissions de la vérité et de la réconciliation – expression généralement employée à l’étranger pour de telles commissions – ont vocation à obtenir la réconciliation des ennemis d’hier par l’établissement de la vérité, ce n’est manifestement pas l’objet de la commission de la vérité dont la création est annoncée. De même, l’Espagne a, depuis longtemps, réussi la consolidation démocratique, et l’intérêt politique d’une commission de la vérité n’est donc pas évident. Manifestement, on ne se trouve pas dans le cadre traditionnel de la justice transitionnelle.
La création d’une commission de la vérité peut toutefois avoir des effets positifs sur la démocratie espagnole, à deux points de vue.
D’une part, la transition démocratique espagnole a été rendue possible grâce à une politique d’amnésie consentie par l’ensemble de la classe politique. C’est au prix d’une occultation du passé que toutes les formations politiques, de la gauche communiste à la droite franquiste en passant par le centre réformiste, ont accepté la monarchie parlementaire, la gauche renonçant à la république pour obtenir la mise en place d’un régime parlementaire, la droite se résignant à la démocratie comme prix à payer pour voir se maintenir la monarchie voulue par le général Franco. Mais plus de quarante ans après la mise en oeuvre de la Constitution du 27 décembre 1978, cette politique d’amnésie, prolongement de la politique d’amnistie décidée sous le régime de Franco et poursuivie après 1975, n’est plus acceptable. Elle ne présente plus l’utilité initiale qu’elle pouvait avoir pour le régime démocratique. En ce sens, la création d’une commission de la vérité pourrait permettre de relancer les recherches sur une période particulièrement sanglante de l’histoire de l’Espagne et aider les victimes ou leurs descendants à connaître et à comprendre leur histoire nationale, familiale et personnelle. La guerre civile a fait plus de 500 000 morts et 300 000 exilés,[16] la dictature franquiste entre 150 000 et 400 000 morts.[17] En outre, quels que soient les crimes commis durant la dictature franquiste, on ne peut se contenter d’une présentation manichéenne de la guerre civile, car les deux camps eurent dans leurs rangs des victimes et des criminels.[18] Toutes les familles espagnoles ont été affectées, et toutes sont susceptibles de ressentir un fort besoin de voir la vérité être établie.
D’autre part, si la création d’une commission de la vérité ne s’inscrit pas dans la logique de recherche de la réussite de la transition démocratique ou de la consolidation démocratique, elle pourrait être la réponse au risque d’une déconsolidation démocratique. En effet, la démocratie espagnole est moins solide qu’il n’y paraît : il semble de plus en plus difficile de maintenir une politique d’impunité et d’amnésie collective et de la justifier par une nécessité de démocratisation de l’Espagne. Il se trouve en effet que la monarchie espagnole, socle de la démocratie, est plus faible que l’on aurait pu le penser. Choisi comme successeur par Franco, Juan Carlos, petit-fils d’Alphonse XIII, le dernier roi d’Espagne avant l’avènement de la Seconde République en 1930, a établi une démocratie fondée sur une nouvelle monarchie (on parle, non pas de restauration monarchique, mais d’instauration monarchique) en associant à son projet politique non seulement les démocrates à majorité républicaine, mais aussi les partisans du franquisme qu’il n’a pas voulu exclure du processus transitionnel et de l’élaboration des nouvelles institutions politiques espagnoles. L’association de l’ensemble des forces politiques a été planifiée dès l’accession de Juan Carlos au pouvoir en 1975, avec la légalisation de l’ensemble des formations politiques et les mesures d’amnistie : un processus peut-être un peu lent d’après certains observateurs de l’époque, mais régulier et méthodique, visant manifestement un objectif politique à moyen terme. Juan Carlos a conquis l’ensemble de la population, toutes tendances politiques confondues, et les Espagnols sont devenus très majoritairement monarchistes,[19] alors que cela ne semblait pas acquis d’avance. Son comportement d’homme d’État lors du coup d’État manqué du colonel Tejero le 13 février 1981 et de sauveur de la jeune démocratie espagnole fut déterminant dans l’adhésion populaire à la monarchie parlementaire.[20]
Cependant, les Espagnols ont souvent été présentés comme étant plus carlistes que monarchistes, et la fin du règne de Juan Carlos a été marquée par plusieurs scandales et comportements critiquables qui ont affaibli, non seulement l’autorité du roi, mais aussi le régime monarchiste. Ainsi, lors d’un sondage organisé juste après l’annonce, le 2 juin 2014, de la décision de Juan Carlos d’abdiquer le 18 juin, 62 % des personnes interrogées pensaient qu’un référendum devait être organisé pour décider si l’Espagne devait demeurer une monarchie ou redevenir une république.[21] Cette fin de règne chaotique a finalement été une chance pour la monarchie espagnole car, alors que l’on se demandait si elle pouvait survivre au départ de Juan Carlos, l’accession au trône du prince Felipe le 19 juin 2014 est arrivée à point nommé pour enrayer la crise de la monarchie.[22] La légitimité de Felipe VI n’étant pas celle de son père, les fondements de la démocratie espagnole apparaissent plus fragiles que par le passé.[23] Le nouveau roi ne peut se prévaloir que de la filiation bourbonienne, et non, contrairement à son père, de son éducation sous la tutelle du général Franco ou d’un rôle déterminant joué dans la démocratisation de l’Espagne. Le régime monarchique, qui avait permis l’avènement d’une amnésie collective, fragile et trompeuse, mais essentielle pour la réussite de la transition démocratique, ne semble donc pas être en mesure d’assurer la coexistence pacifique des franquistes et des démocrates, qu’ils aient connu la dictature franquiste ou la guerre civile, ou qu’en tant que descendants des protagonistes d’hier, ils se sentent tenus par une obligation morale de ne pas pardonner les crimes du passé.
Il devient ainsi nécessaire, pour ne pas dire urgent, de se pencher sur la mémoire collective de l’Espagne et de rédiger un récit historique dans lequel tous les Espagnols se retrouveront et qui leur permettra de se construire un avenir commun.
B. Une démarche hasardeuse
Même si la création d’une commission de la vérité semble présenter une réelle utilité, elle soulève de graves difficultés.
D’abord, la composition de la commission n’est pas convaincante. Ses onze membres seraient des juristes, des enquêteurs, des historiens, des psychologues et des universitaires choisis, trois par le parlement, deux par le pouvoir judiciaire et le parquet, un par le conseil des universités, trois par les associations des victimes, auxquels viendraient s’ajouter deux experts internationaux. Cette composition est sujette à caution : elle s’inspire clairement des commissions de la vérité et de la réconciliation qui sont généralement mises en place dans le cadre de la transition ou de la consolidation démocratique. Or, ce n’est plus le cas en Espagne, et l’établissement de la vérité historique relève avant tout du travail des historiens, de la recherche scientifique et des débats de spécialistes libres de tout a priori de nature partisane, personnelle ou autre. Certes, on ne peut reprocher à la commission dont la création est envisagée de n’accorder qu’une place secondaire aux historiens, car la reconstitution d’une mémoire collective et l’élaboration d’un récit historique sont deux tâches complémentaires mais distinctes, celle-là nourrissant celui-ci. En outre, il est prévu que la commission ait accès à « tous les documents nécessaires, sans restriction », sans que l’armée ou une quelconque institution puisse s’y opposer, « même s’il s’agit de documents secrets ». Mais on pourrait tout aussi bien assurer aux historiens – du moins à ceux qui développent leurs recherches dans un cadre officiel comme les universités ou les centres de recherche – un accès sans réserve aux documents nécessaires à leurs travaux : une commission n’est pas indispensable. Par ailleurs, une fois mise en place, la commission devrait rendre un document dans le délai de deux ans. Or, un travail d’une telle ampleur ne peut être enfermé dans un carcan temporel aussi strict. La recherche des informations et leur traitement nécessitent un temps beaucoup plus long, ce qui est d’autant moins gênant que l’on ne se situe pas dans le cadre d’une transition démocratique et que le régime démocratique n’est pas en danger. En outre, la mise en place d’une commission de la vérité « officielle » peut alimenter les soupçons d’instrumentalisation de la vérité historique à des fins politiques. Ce ne sera probablement pas le cas, mais le fait que la population le croie est un facteur déterminant à prendre en compte, car le but d’une telle commission est justement de répondre à une demande, non seulement des victimes ou de leurs familles, mais de la nation tout entière.
Par ailleurs, la création d’une commission de la vérité est trop tardive. Même si l’on peut comprendre les raisons qui ont poussé les gouvernements successifs à être fidèles à la politique d’amnésie mise en oeuvre au début de la transition démocratique, les quatre décennies qui se sont écoulées rendent particulièrement difficile le travail d’enquête. En Amérique latine comme en Afrique, les commissions de la vérité ont été créées immédiatement après la chute des dictatures ou la fin des guérillas. Mais quarante ans après la fin de la dictature franquiste, et quatre-vingts ans après la fin de la guerre civile, les témoins se font rares, et il semble impossible d’établir une vérité « officielle », laquelle se construit sur l’agrégation des mémoires individuelles dont la multiplicité est censée compenser la subjectivité[24] et permettre d’établir un récit a priori objectif, ce caractère objectif étant d’ailleurs – même s’il est imparfait – un élément déterminant pour faire du récit historique un outil efficace de consolidation de la démocratie et de pacification des rapports humains dans un cadre postconflictuel. Certes, d’aucuns affirmeront que d’autres pays, comme l’Australie, le Canada ou les États-Unis, ont mis plusieurs décennies avant d’accepter d’enquêter sur une période sombre de leur histoire. Mais, dans le cas de l’Espagne, toutes les familles ayant été touchées par la guerre civile et le régime franquiste, on peut difficilement fonder le travail de la commission de la vérité sur l’accumulation de récits individuels, inévitablement parcellaires et partiaux, pour écrire l’histoire collective. En revanche, à défaut d’établir la vérité, une telle commission pourrait faciliter la reconnaissance officielle des crimes commis durant cette période de l’histoire espagnole, et mettre un terme à cette longue période d’amnésie officielle trop souvent vécue par une partie de la population espagnole comme un déni démocratique et la marque d’une complicité objective des partis politiques démocratiques avec le franquisme.
La décision du président du gouvernement Pedro Sánchez de créer une commission de la vérité sur les crimes commis durant la guerre civile et la dictature franquiste soulève donc de graves difficultés pratiques. Elle conduit toutefois à remettre en cause l’amnésie collective imposée au peuple espagnol pour les besoins de la transition démocratique et, à ce titre, il semble difficile d’en faire l’économie. Une telle commission devrait logiquement conduire à la remise en cause de la loi du 26 décembre 2007, dite « Loi de reconnaissance et d’extension des droits et de rétablissement des moyens en faveur de ceux qui ont souffert de persécution ou de violence durant la Guerre civile et la Dictature ».
II. La remise en cause de la législation d’impunité
À défaut de laisser présager l’élaboration d’une mémoire historique capable de permettre aux Espagnols de tourner enfin quelques-unes des pages les plus sombres de leur histoire, la loi du 26 décembre 2007 a souvent été présentée comme une avancée majeure dans la remise en cause de la politique d’amnésie[25] voulue par Juan Carlos lors de son accession au trône dans le but de faciliter le processus de transition démocratique. Ce n’est que partiellement vrai. Certes, cette loi s’est inscrite en réaction à la loi 46/1977 du 15 octobre 1977 (BOE n° 248 du 17 octobre 1977), dite « loi d’amnistie », laquelle était difficilement compatible avec les principes de l’État de droit et le droit international. Mais elle n’a que très partiellement corrigé les insuffisances de la loi de 1977 et, en aucun cas, elle n’a permis de faire le jour sur les pages les plus sombres de l’histoire de l’Espagne.
A. L’illégitimité de la loi d’amnistie de 1977
Si la loi de 1977 apparaît aujourd’hui comme inacceptable au regard des principes de l’État de droit, elle a pu se justifier : elle se plaçait, au début de la transition démocratique, dans un cadre plus large d’une politique d’amnistie dont l’ensemble de la classe politique espagnole a profité.
En effet, une première amnistie fut accordée le 25 novembre 1975 par le décret n° 2940/1975, trois jours après que Juan Carlos Ier fut proclamé roi d’Espagne. Permettant la libération de sept cents prisonniers politiques (Memoria del Fiscal del Tribunal Supremo, 1977, p. 61.), elle s’inscrivait à la fois dans le prolongement de la dizaine de mesures d’amnistie prises par le général Franco et dans la logique de la politique de « concorde nationale » proclamée lors de l’intronisation du nouveau roi (ABC, 23 novembre 1975). Puis, le 30 juillet 1976, le décret-loi royal n° 10/1976 (BOE n° 186, 4 août 1976, p. 15097) proclama une amnistie politique totale, qui concerna les délits d’opinion et les délits commis contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État, à l’exception de ceux ayant mis en péril la vie humaine, et qui conduisit à la libération de 330 prisonniers politiques, seuls 86 étant maintenus en détention en raison de condamnations pour des délits de droit commun. L’opinion publique accueillit ces mesures avec satisfaction,[26] alors même que, comme le souligna Adolfo Suárez (Osorio, 1980, p. 160), elles constituaient moins une amnistie qu’une grâce puisqu’elles n’abrogeaient pas la législation relative aux délits politiques. En outre, les nationalistes basques condamnés pour crimes de sang n’en bénéficièrent pas, et il fallut attendre le mois de juin 1977 pour que les peines de prison fussent commuées en exil. Finalement, le 15 octobre 1977 fut votée la loi n° 48/1977 par l’ensemble des groupes parlementaires du Congrès des députés, à l’exception de celui de l’Alliance populaire; cette loi était censée tourner définitivement la page, non seulement du régime franquiste, mais aussi de la guerre civile.
La loi de 1977 établit un nouveau modèle de réconciliation qui assure l’impunité aux vainqueurs, les victimes étant de facto privées de toute possibilité de reconnaissance par l’État. L’article 1er proclame en effet : « Sont amnistiés : a) Tous les actes d’intention politique, quel qu’en soit le résultat, qualifiés de crimes et délits commis avant le quinzième jour du mois de décembre mil neuf cent soixante-seize. » En outre, l’article 2 de la loi précise :
Dans tous les cas, sont inclus dans l’amnistie :
Les crimes et délits susceptibles d’avoir été commis par les autorités, les fonctionnaires et les responsables de l’application des lois à l’occasion d’enquêtes et de poursuites concernant les actes visés par la présente loi.
Les infractions commises par des fonctionnaires et des agents de la force publique contre l’exercice des droits des individus.
Cette loi n’imposait pas une amnésie collective mais décidait d’« exclure, sur le plan politique, les conflits du passé du champ du présent pour construire un avenir commun ». Elle annonçait le début d’une authentique paix civile et d’une réconciliation nationale sur lesquelles devait se fonder la démocratie espagnole. L’amnistie fut, en ce sens, perçue comme la condition préalable et nécessaire à la démocratie, le Parlement, libéré de ce poids du passé, pouvant désormais se consacrer pleinement au travail de construction du nouvel État démocratique (Baby, 2007).
Si l’on peut comprendre les motivations du législateur en 1977, le fait qu’une telle loi, qui méconnaît clairement les droits des victimes, ait été votée, étonne cependant. Pour l’expliquer, évoquons quatre facteurs.
Premièrement, formellement, la transition démocratique s’est inscrite dans une logique de réforme et non de renversement du régime politique. Même si l’on peut penser que Franco n’avait pas prévu la démocratisation de l’Espagne, il était évident que sa mort causerait celle du régime qu’il avait fondé et qu’il personnifiait, et que Juan Carlos, bien que choisi par lui comme son successeur, mènerait à bien une libéralisation des institutions, le fait d’être l’héritier du dictateur ne lui donnant pas l’autorité nécessaire à la pérennisation de son régime, si tant est qu’il en ait eu la volonté.[27] Ainsi, dans le premier gouvernement d’Adolfo Suárez, seuls deux ministres n’avaient eu aucune responsabilité sous le régime franquiste (Martín Villa, 2002). La réussite de la démocratisation supposait la participation à celle-ci de l’ensemble des forces politiques, ce qui impliquait l’amnistie des crimes commis durant la guerre civile et sous la dictature.
Deuxièmement, s’il est vrai que Juan Carlos a été le principal promoteur de la transition démocratique et a réussi à agréger autour de son projet la grande majorité de la classe politique, on peut estimer que ce processus a été engagé, probablement involontairement, par Franco lui-même, puisque dès les années 1960, le renouvellement du personnel politique, notamment dans les gouvernements successifs, a conduit à donner une place de plus en plus importante à une nouvelle génération, plus jeune, plus moderne et plus ouverte sur le monde, celle-là même qui, à la mort du dictateur, a soutenu le roi dans son entreprise de démocratisation.[28]
Troisièmement, la classe politique espagnole était organisée sur un modèle ternaire : la droite conservatrice fidèle au franquisme, la gauche héritière des républicains, et le centre réformiste. Trois familles politiques devaient collaborer pour construire le régime démocratique. Il s’agissait d’une transition démocratique concertée, reposant sur un ensemble de concessions : ainsi, la droite franquiste accepta la démocratisation du régime et le pluralisme politique, et la gauche la monarchie parlementaire. Il fallut donc présenter l’histoire de l’Espagne sous un jour acceptable pour l’ensemble des formations politiques.
Quatrièmement, on a rejeté une présentation manichéenne de la guerre civile, et on a préféré voir en elle une guerre fratricide dans laquelle les deux camps ont compté, parmi leurs rangs, des victimes et des criminels. La grande perdante a été la nation espagnole, et le régime franquiste n’a fait que chercher à restaurer son unité, fût-ce au prix d’un régime autoritaire. Dès lors, rien ne justifiait de réveiller les blessures du passé. Mieux valait tourner la page et réussir, ensemble, la transition démocratique.
En imposant un silence officiel, la loi de 1977 a semblé fonder la transition démocratique sur un artifice, avec le risque de voir l’édifice s’écrouler en cas de prise de conscience trop précoce du passé et de développement d’un désir collectif de justice, pour ne pas dire de revanche.
Ce silence collectif imposé est la principale critique qui a été adressée à la loi de 1977. Il a pourtant été accepté, dès les premières années du régime franquiste, par la majorité des partis politiques, y compris ceux condamnés à l’exil. Ainsi peut-on rappeler l’accord signé à Saint-Jean-de-Luz en 1947 entre la Confédération des forces monarchiques et le Parti socialiste, qui prévoyait une amnistie des délits politiques et l’interdiction de toute sorte de représailles, ou encore la prise de position du Parti communiste en 1956, celui-ci considérant que la transition démocratique pacifique passait par la recherche d’une « réconciliation nationale », fût-ce au prix de l’irresponsabilité des deux camps de la guerre civile. Le choix de l’impunité a ainsi fait l’objet d’un consensus de l’ensemble des formations politiques (Santos & Mainer, 2000), et concernait à la fois la guerre civile et le régime franquiste, comme si les deux périodes n’en faisaient qu’une. C’est ce qui explique que la classe politique tout entière ait pu accepter une loi qui, de toute évidence, contrevenait au droit international et était de nature à mettre l’Espagne au ban de la société internationale. Mais, là encore, le souci des démocraties occidentales de voir l’Espagne réussir sa transition démocratique les a conduites à se montrer pour le moins compréhensives à l’égard du nouveau régime espagnol.
B. L’inconventionalité de la loi d’amnistie de 1977
La loi de 1977 soulève de graves problèmes juridiques que le législateur espagnol ne pouvait ignorer, mais dont il s’est manifestement fort bien accommodé : elle contrevient aux principaux textes internationaux sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, et elle n’aurait donc jamais dû être promulguée.
En effet, la résolution 3074 (XXVIII) de l’Assemblée générale des Nations unies du 3 décembre 1973 affirme :
Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, où qu’ils aient été commis et quel que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l’objet d’une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu’ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés, traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, punis.
Tout État a le droit de juger ses propres ressortissants pour crimes de guerre ou pour crimes contre l’humanité.
En outre, l’article 15-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ratifié par l’Espagne le 13 avril 1977, c’est-à-dire avant le vote de la loi d’amnistie, déclare :
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations (BOE, 30 avril 1977).
Mais la notion de crime contre l’humanité est antérieure à la guerre d’Espagne et à la dictature franquiste : elle a été invoquée pour la première fois en 1919 pour le génocide arménien en reprenant la notion de crime de lèse-humanité du xviiie siècle – un crime inexpiable et imprescriptible (Wahnich, 2008) –, puis définie clairement par le statut du tribunal de Nuremberg de 1945, et enfin consacrée par l’Organisation des Nations unies en 1950.[29] La loi de 1977 était donc contraire au droit international en vigueur, et qu’un gouvernement fasse voter un tel texte en plein processus de transition démocratique est difficilement acceptable sur le plan juridique et moral, même si cela peut se comprendre d’un point de vue politique.
Pour autant, la loi de 1977 n’est pas inconstitutionnelle. Certes, l’article 10 alinéa 2 de la Constitution de 1978 déclare que « les normes portant sur les droits fondamentaux et les libertés reconnus par la Constitution doivent être interprétées au regard de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que des traités et des accords internationaux en la matière, ratifiés par l’Espagne ». Mais la Constitution est postérieure à la loi, et ne fait qu’imposer une interprétation de celle-ci conforme au droit international. Le principe de la hiérarchie des normes ne peut donc fonder une annulation de la loi pour inconventionalité, laquelle remettrait en cause le principe de non-rétroactivité, l’adoption de la Constitution de 1978 ne conduisant pas à l’abrogation des lois antérieures qui lui sont contraires.
En outre, se pose le problème de l’interprétation du droit international, laquelle est souvent fondée sur des motifs plus politiques que juridiques. Ainsi, dans son arrêt du 27 février 2012,[30] le Tribunal suprême devait se prononcer sur l’éventuel délit de prévarication dont était accusé le juge Baltasar Garzón qui, en tant que juge d’instruction à l’Audiencia Nacional, avait mis en oeuvre une procédure visant à rechercher des fosses communes de personnes disparues entre 1936 et 1952. Il a souligné l’importance du rôle joué par la loi de 1977 dans le processus de transition démocratique et la « réconciliation pacifique entre les Espagnols », et il a rejeté les arguments avancés par le Conseil de l’Europe dans sa résolution 828 du 26 septembre 1984 relative aux disparitions forcées et par le Comité des droits de l’homme des Nations unies dans son rapport de 2009 (Comité des droits de l’homme de l’ONU, 2009). Cela aurait pourtant permis de requalifier les crimes et délits commis durant la guerre civile et le régime franquiste en crimes contre l’humanité, suivant ainsi la résolution 828 du Conseil de l’Europe, qui :
Invite les gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe :
à appuyer au sein des Nations unies l’élaboration et l’adoption d’une déclaration affirmant les principes suivants :
la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité qui : ne peut pas être considéré comme un crime politique et les dispositions sur l’extradition sont donc applicables à son égard ;
est imprescriptible ;
ne peut pas être couvert par les lois d’amnistie ;
à mettre leur système juridique en conformité avec les principes énoncés ci-dessus, afin de leur donner une force contraignante.
Pour autant, à défaut de fonder juridiquement une abrogation de la loi de 1977, le droit international peut inciter le législateur à voter une nouvelle loi ou à réviser la loi en vigueur. Ce n’est toutefois pas le souci d’un meilleur respect du droit international qui a poussé le Parlement espagnol à voter la loi 52/2007 dite « loi de la mémoire historique », et il est difficile de se satisfaire d’une loi qui, si elle assurait une impunité utile à défaut d’être légitime au lendemain de la mort de Franco, n’est plus acceptable et risque de remettre en cause la consolidation démocratique en suscitant chez de nombreux Espagnols un sentiment d’injustice. En effet, en privant de la reconnaissance des torts subis et de l’établissement d’une mémoire historique le peuple espagnol qui, comme tout peuple, en a besoin pour rendre possible le « vivre ensemble », on fragilise la consolidation démocratique.
C. L’insuffisance de loi du 26 décembre 2007
La loi du 26 décembre 2007 vient confirmer qu’en politique, la recherche de solutions modérées conduit à s’attirer des critiques de tous les bords. Après plus de trois années de travail, dont quatorze mois de débats parlementaires, le roi Juan Carlos a promulgué la loi dite « de la mémoire historique », « reconnaissant et étendant les droits et établissant des mesures en faveur de ceux qui ont subi des persécutions ou des violences pendant la guerre civile et la dictature ».
Cette loi ne peut manquer de surprendre. Trente ans après la loi de 1977 qui garantissait l’impunité des crimes commis durant la guerre civile et la dictature franquiste sous prétexte de garantir les conditions de la réussite de la transition démocratique que d’aucuns jugeaient hasardeuse, et au regard de la consolidation démocratique manifestement achevée, on pouvait espérer un texte plus ambitieux. De toute évidence, la démocratie espagnole n’a plus à craindre les soubresauts de l’histoire et une rechute de l’autoritarisme ; la timidité du législateur espagnol est donc choquante, car elle rappelle l’attachement d’une partie de la droite à son passé franquiste. Certes, on ne saurait nier l’évolution idéologique considérable de la droite espagnole depuis la création en 1976 de l’Alliance populaire, une coalition conservatrice dirigée par d’anciennes personnalités du franquisme, devenue Parti populaire en 1989, et dont le recentrage sur l’échiquier politique espagnol a rendu possible son accession au pouvoir à l’issue des élections générales anticipées du 3 mars 1996.[31] Le Parti populaire est incontestablement devenu un parti de gouvernement de centre-droite parfaitement démocratique. Pourtant, il a voté contre le projet de loi, avec le soutien d’une partie de l’électorat conservateur et de certaines personnalités de droite qui ont clairement pris position contre le texte, comme l’ancien ministre de l’Intérieur Jaime Mayor Oreja, qui a déclaré : « Je ne condamne pas le franquisme. Pourquoi condamnerais-je ce qui représentait un grand nombre d’Espagnols ? Le franquisme fait partie de l’histoire de l’Espagne. Laissons-le aux historiens. »[32]
La droite a justifié ce refus en reprochant à la loi de remettre en cause le consensus politique fondé sur un « pacte d’oubli »[33] en 1977. Et il est vrai que cette peur a pu motiver le silence gardé pendant trente ans par la classe politique sur la période sombre du franquisme. D’ailleurs, le président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero n’a pas caché souhaiter « réhabiliter la mémoire des vaincus ». Mais le projet de loi aurait-il reçu un accueil plus favorable de la droite si le président du gouvernement avait évoqué la « mémoire des victimes » ? Rien ne permet de l’affirmer.
Il est vrai que la genèse de la loi vient conforter la position de la droite. Outre le fait que le président Zapatero est le petit-fils d’un républicain fusillé en 1936 par les troupes franquistes, le gouvernement a été encouragé en ce sens par diverses associations de gauche qui ont entrepris de retrouver les corps des fusillés enterrés dans des fosses communes dont la localisation est devenue difficile avec la disparition de la plupart des témoins de l’époque. Si la motivation des descendants de républicains est parfaitement légitime, elle n’est pas sans présenter des risques d’exacerbation des clivages politiques sur la question de la guerre civile et de la dictature franquiste.
On peut toutefois s’étonner que la droite, même peu désireuse de voir les enquêtes sur le passé se multiplier, ait refusé de voter la loi, car le gouvernement a manifestement souhaité jouer la carte de l’apaisement, et ce, sur trois plans.
Premièrement, la loi n’oublie pas les victimes franquistes de la guerre civile, et elle les place sur un pied d’égalité avec les victimes républicaines. On ne peut donc pas accuser le législateur de parti pris.
Deuxièmement, sur le plan formel, les termes « franquisme » ou « franquiste » sont très rarement employés. Autant la guerre civile est fréquemment évoquée, autant la loi se contente généralement d’évoquer la « dictature ». Ce silence est bien entendu symbolique.
Troisièmement, la loi fait une distinction entre la guerre civile et la dictature. Si l’article 1er précise que « la présente loi a pour objet de reconnaître et d’étendre les droits en faveur de ceux qui ont subi des persécutions ou des violences, pour des raisons politiques, idéologiques ou religieuses, pendant la guerre civile et la dictature », l’article 2 « reconnaît et déclare le caractère radicalement injuste de toutes les condamnations, sanctions et de toutes les formes de violence personnelle commise pour des raisons politiques, idéologiques ou religieuses pendant la guerre civile, ainsi que les gestes subis pour les mêmes causes pendant la dictature ». Le fait d’évoquer les crimes « commis » durant la guerre civile et ceux « subis » durant la dictature introduit clairement une distinction entre les deux périodes : en ce qui concerne la guerre civile, la loi envisage les coupables, tandis qu’en ce qui concerne la dictature, elle ne s’intéresse qu’aux victimes. Ainsi, le législateur ne fait aucune distinction entre les franquistes et les républicains durant la guerre civile, mais il en fait une entre le pouvoir franquiste et l’opposition démocratique puisqu’il n’envisage que les conséquences de la répression et le droit à la reconnaissance et à la réparation des dommages subis. Ainsi, la loi de 2007 confirme indirectement l’impunité assurée par la loi de 1977.
En outre, la loi de 2007 n’annule pas les jugements sommaires prononcés par les tribunaux militaires, mais, pour autant, on ne peut affirmer qu’elle les confirme indirectement, puisque l’article 3 déclare « l’illégitimité des tribunaux, des jurys et de tout autre organe pénal ou administratif qui, pendant la guerre civile, ont été constitués pour imposer, pour des raisons politiques, idéologiques ou religieuses, des peines ou sanctions à caractère personnel, ainsi que celle de leurs résolutions ».
Par ailleurs, l’article 11 prévoit que « les administrations publiques […] faciliteront aux descendants directs des victimes qui en font la demande les activités d’enquête, de localisation et d’identification des personnes violemment disparues pendant la guerre civile et que la répression politique qui a suivi et dont on ignore où elles se trouvent », et les articles 12 à 14 précisent les obligations de l’administration en la matière.
De plus, l’article 15, alinéa 1er de la loi prévoit que « les administrations publiques […] prendront les mesures appropriées pour l’enlèvement des armoiries, insignes, plaques et autres objets ou mentions commémorant le soulèvement militaire, la guerre civile et la répression de la dictature », l’alinéa 2 limitant toutefois la portée de ces dispositions, lesquelles ne s’appliquent pas « lorsque les mentions sont de stricte mémoire privée, sans exaltation des parties adverses, ou lorsque, pour des raisons artistiques, architecturales ou artistico-religieuses, elles sont protégées par la loi ».
En outre, l’article 16 exclut explicitement le Valle de los Caídos du champ d’application de la loi, en le soumettant aux « règles généralement applicables aux lieux de culte et aux cimetières publics » tout en interdisant tous les « actes de nature politique ou les exaltations de la guerre civile, de ses protagonistes ou du régime franquiste ». Cette disposition vise manifestement à protéger le monument le plus symbolique du régime franquiste, construit à proximité de Madrid, notamment par des prisonniers politiques, commandé par le général Franco, dans un premier temps pour rendre hommage aux « héros et martyrs de la Croisade », c’est-à-dire aux combattants nationalistes morts pendant la guerre civile, et devenu en 1957[34] un mausolée pour l’ensemble des morts de la guerre civile, y compris les républicains pourvu qu’ils fussent catholiques. Voulu officiellement par le gouvernement franquiste comme le symbole de la réconciliation nationale, il est devenu celui du régime franquiste avec l’inhumation du général Franco et du chef de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera.
Enfin, l’article 20 de la loi de 2007 prévoit la création du Centre documentaire de la mémoire historique, auquel est confiée la tâche de gérer les Archives générales de la guerre civile, c’est-à-dire de collecter et de numériser l’ensemble des documents se rapportant à la guerre civile et à la dictature, notamment ceux possédés par les bibliothèques et les archives publiques, et à encourager et soutenir la recherche historique ainsi que la diffusion de la documentation sur la question.[35]
La loi de 2007 constitue donc une avancée significative en matière de reconnaissance des droits des victimes de la guerre civile et du régime franquiste. Son caractère modéré, notamment dans la terminologie employée, aurait dû lui permettre de recueillir l’adhésion de l’ensemble de la classe politique espagnole. Ne pas parler clairement du franquisme, ne pas envisager la responsabilité des crimes commis durant la dictature et placer les républicains et les nationalistes sur un pied d’égalité en ce qui concerne la période de la guerre civile s’inscrit parfaitement dans la logique de la loi qui, selon l’article 1er, vise « à supprimer des éléments de division entre les citoyens […] dans le but de promouvoir la cohésion et la solidarité entre les différentes générations d’Espagnols autour des principes, des valeurs et des libertés constitutionnels ». Mais l’on peut aussi penser que l’opposition de la droite à cette loi pourtant modérée confirme son incapacité à reconnaître les torts du franquisme et sa difficulté à se délivrer de ses racines franquistes.
IIi. La nécessité de répondre à un besoin de justice
Le refus par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, de remettre en cause la politique d’impunité sur laquelle s’est construite la transition démocratique pacifique des années 1970, a conduit à ôter à la loi de 2007 toute portée pratique. Les pouvoirs publics se sont vus privés des financements nécessaires, et les magistrats qui ont tenté d’enquêter sur les crimes commis durant la guerre civile et le régime franquiste ont fait l’objet de pressions ou d’obstructions, le cas du juge Garzón étant symptomatique. La volonté affichée par le président du gouvernement Pedro Sánchez de procéder à une réforme complète de la loi de 2007 et de créer une commission de la vérité historique pourrait être une réponse. En attendant le vote d’une hypothétique nouvelle loi, il devient nécessaire, pour éviter une désaffection des Espagnols envers les institutions démocratiques, et sans même chercher à juger les coupables, que les victimes soient reconnues comme telles, et que certains monuments symboliques du franquisme, qui rappellent l’attachement d’une partie de la population à la mémoire du Caudillo et à la dictature, cessent d’être compris comme l’expression d’une opposition irréductible entre républicains et nationalistes.
A. Les enquêtes entravées sur la guerre civile et le régime franquiste
« Qui veut la peau de Baltasar Garzón ? », se demandait le 6 octobre 2009 le quotidien Le Monde (Bozonnet, 2019) alors que la chambre d’accusation de la Cour suprême espagnole s’apprêtait à le renvoyer devant un tribunal pour « prévarication dans l’exercice de ses fonctions ». Il était reproché au magistrat d’avoir ouvert, le 18 octobre 2008, à la demande des familles, une enquête sur les disparitions forcées de 114 000 républicains au cours de la guerre civile et de la dictature franquiste.
Le juge Garzón avait pris soin de requalifier ces disparitions de « crimes contre l’humanité », par définition imprescriptibles. Cette décision avait fait l’objet de violentes critiques, non seulement de la droite, qui estimait qu’elle était contraire à l’intérêt de la démocratie espagnole en remettant en cause la transition démocratique consensuelle fondée sur l’occultation du passé, mais aussi de la majorité socialiste, qui y voyait une critique à peine déguisée de la loi sur la mémoire historique adoptée l’année précédente. Le procureur général de l’État demanda l’annulation de la procédure, estimant l’Audience nationale incompétente en la matière, et le recours du parquet fut accepté le 2 décembre 2008. Mais, entre-temps, le 18 novembre, le juge Garzón s’était dessaisi de l’affaire, déclarant les juges territoriaux compétents pour ordonner l’ouverture des fosses communes et l’exhumation des corps des victimes.
En janvier 2009, deux organisations d’extrême droite déposèrent une plainte au pénal : le syndicat de fonctionnaires Manos limpias et l’association Libertad e identitad reprochaient au juge Garzón d’avoir violé la loi d’amnistie de 1977 et d’avoir voulu enquêter sur des faits prescrits ou amnistiés en les qualifiant de crimes contre l’humanité, notion qui n’existait pas encore à l’époque de la guerre civile. La plainte fut jugée recevable par une commission présidée par le juge Adolfo Prego, connu pour ses positions conservatrices – il avait notamment signé, en tant que membre du comité d’honneur de la Fondation pour la défense de la nation espagnole, un texte hostile à la loi sur la mémoire historique à laquelle il reprochait de « rendre hommage comme martyrs de la liberté à un grand nombre des pires criminels qui assombrirent notre histoire ».
La position du juge Prego ne peut manquer de surprendre. Si la définition de la notion de crime contre l’humanité est postérieure à la guerre civile espagnole – on peut la dater de 1945[36] –, elle est antérieure à perpétration de la plupart des crimes commis sous la dictature franquiste. En outre, la nature juridique particulière du crime contre l’humanité l’affranchit de toute limite temporelle. C’est d’ailleurs cette notion qui a permis que se tiennent les procès de Nuremberg et de Tokyo. Si l’on ne pouvait retenir rétroactivement la notion de crime contre l’humanité pour juger les crimes commis par le régime franquiste, il faudrait alors en tirer les conséquences et nier la légitimité de la condamnation des criminels nazis et japonais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’affaire fut instruite par le juge Luciano Varela, dont l’aversion pour le juge Garzón est notoire. Dès lors, une instruction à charge était prévisible, écartant toute éventualité d’un non-lieu qui aurait été pourtant fondé en droit.
Le coup de grâce fut donné au juge Garzón le 9 février 2012, avec sa condamnation pour forfaiture par le Tribunal suprême de Madrid, à l’unanimité des juges, à onze ans d’interdiction d’exercer ses fonctions de magistrat. Le juge Garzón s’était en effet rendu coupable d’avoir ordonné des écoutes de conversations entre des suspects incarcérés et leurs avocats, dans une enquête sur un réseau de corruption qui avait éclaboussé en 2009 la droite espagnole, violant ainsi les droits de la défense. Le jugement précisa que pendant les onze ans de sa condamnation, le juge ne pourrait pas non plus exercer un « emploi ou fonction juridictionnelle ou de gouvernance au sein du pouvoir judiciaire ». En outre, le juge Garzón perdit définitivement sa fonction de juge d’instruction de l’Audience nationale de Madrid, la plus haute instance pénale de l’Espagne, dont il était déjà suspendu depuis mai 2010. Ce jugement, insusceptible d’appel, mit un terme à sa carrière.
Certes, les faits étaient avérés, mais on peut être tenté de voir dans ce jugement une condamnation politique. En ordonnant les écoutes, le juge Garzón avait commis une faute, cette décision violant les droits de la défense, et celle-ci aurait pu motiver l’annulation de la procédure en cours, voire un blâme à l’encontre du juge. Mais les magistrats ont voulu aller plus loin : par cette sanction particulièrement sévère, ils ont bâillonné définitivement le juge Garzón en mettant un terme à sa carrière, cherchant manifestement à décourager les enquêtes sur les crimes contre l’humanité perpétrés durant la guerre civile et le régime franquiste.
Trois semaines plus tard, le lundi 27 février 2012, le juge Garzón a été acquitté dans un procès concernant l’instruction des crimes du franquisme. Le tribunal suprême de Madrid a jugé qu’il ne s’était pas rendu coupable de forfaiture, mais qu’il avait seulement commis une « erreur » en voulant instruire lesdits crimes. Contrairement à l’analyse de ce jugement qui a été souvent faite,[37] cette victoire du juge Garzón n’est pas seulement symbolique. Elle n’a aucune portée pratique sur l’interdiction qui lui a été faite d’exercer ses fonctions pendant onze ans, mais elle le réhabilite moralement et lui donne raison au fond dans sa volonté d’enquêter sur le passé franquiste de l’Espagne. En outre, la série de procédures dont a fait l’objet le juge Garzón pour empêcher les enquêtes sur les crimes commis durant la guerre civile et la dictature franquiste confirme qu’il existe toujours en Espagne des forces politiques prêtes à entraver la démocratie. Car il est reproché essentiellement au juge Garzón d’avoir interprété et appliqué la loi d’amnistie, ce qui est pourtant la fonction même d’un juge, comme l’a souligné Pedro Nikkei, le président de la Commission internationale des juristes : « Trois procédures ont été engagées contre un juge qui a levé le voile de l’amnistie protégeant des crimes présumés contre l’humanité qui n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête. On peut se demander dans quelle mesure cette condamnation est juste un moyen de faire taire Garzón (Le Figaro, 9 février 2012). »
Cette hypothèse d’une condamnation politique du juge Garzón semble être finalement une réponse à la multiplication des actions intentées sur les cas de disparitions de républicains durant la guerre civile ou la dictature franquiste et de centaines de milliers de bébés jusqu’à la fin des années 1980, actions qui se sont souvent heurtées à la mauvaise volonté des pouvoirs publics.
B. Le besoin d’une reconnaissance des crimes commis
Alors même que les victimes nationalistes de la répression dans les zones républicaines ont fait l’objet d’une reconnaissance officielle et que leurs corps ont été exhumés et identifiés avant de faire l’objet d’un enterrement digne, celles de la répression franquiste ont été, pour la plupart, enterrées dans des centaines de fosses communes disséminées sur l’ensemble du territoire espagnol. Jusqu’à la fin des années 1990, elles furent « oubliées », et aucune enquête générale sur les victimes ne fut diligentée. Ceci n’empêcha pas leurs familles de demander la localisation et l’exhumation des corps afin qu’une sépulture décente leur soit accordée. Celles-ci se regroupèrent dans l’Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, créée en décembre 2000. Plusieurs milliers de corps furent localisés et exhumés, ce qui représente un très faible pourcentage des victimes.
Par la suite, le vote de la loi de 2007 ne permit pas à la recherche des fosses communes de connaître des progrès sensibles du fait de l’opposition de la droite. Ainsi, à l’automne 2008, la Généralité de Catalogne débloqua des fonds destinés à financer la recherche des charniers. De même, d’autres communautés autonomes, comme l’Andalousie, les Asturies ou encore l’Aragon, firent le nécessaire en ce sens. En revanche, les communautés autonomes gérées par le Parti populaire n’affectèrent aucuns fonds ni ne lancèrent de recherches.
La recherche des fosses communes suppose un travail de grande envergure réalisé à l’échelle nationale, ce qui excède les moyens financiers et matériels dont disposent les associations de familles de victimes. Elle nécessite également une collaboration des différentes composantes de la société espagnole, difficile à obtenir. Ainsi, le 28 août 2008, afin de lui permettre de décider s’il était compétent dans la plainte déposée par quatre associations pour la récupération de la mémoire historique (les associations de Catalogne, de Valence, d’Aragon, et de Puenteareas), le juge de l’Audiencia Nacional Baltasar Garzón recueillit des informations auprès du gouvernement, de la Conférence épiscopale et de plusieurs municipalités afin de dresser un recensement des personnes tuées, disparues et enterrées dans les charniers le 17 juillet 1936. Mais il se heurta à une évidente mauvaise volonté. La Conférence épiscopale refusa d’accéder à cette demande, se déclarant incompétente devant le juge; en fait, de nombreux religieux ont été assassinés par les républicains durant la guerre civile, et même plusieurs décennies plus tard, ces faits sont toujours présents dans la mémoire collective du clergé. De même, le ministère de la Défense répondit au juge qu’il n’avait pas de documentation sur le nombre de victimes. Le 23 septembre 2008, l’Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica transmit au juge Garzón la liste de 143 353 victimes de la répression franquiste ayant disparu. Le ministère de la Défense répondit qu’il ne pouvait ni confirmer ni infirmer ces informations. Enfin, un grand nombre de maires membres du Parti populaire, comme celui d’Almería (López Díaz & Albert, 2008), refusèrent de collaborer.
Finalement, le 7 novembre 2008, l’Audiencia Nacional, à la demande du procureur général de l’État, suspendit l’ouverture des tombes et des exhumations demandées par le juge Garzón (Altozano, 2008). Le 18 novembre, le juge Garzón déclara s’abstenir d’enquêter sur le franquisme, et renvoya devant les tribunaux territoriaux compétents les enquêtes sur les disparitions et les fosses communes (El País, 18 novembre 2008).
Dans le même sens, la découverte, dans les années 1990, du vol de centaines de milliers de bébés entre 1940 et la fin des années 1980, organisé par le régime franquiste pour des raisons politiques, puis par des réseaux criminels pour des raisons financières, donna lieu à de très rares ouvertures.
Au lendemain de la guerre civile, le général Franco avait organisé un « transfert » de bébés destiné à « combattre la propension dégénérative des enfants ayant grandi dans une atmosphère républicaine ». Le décret du 23 novembre 1940 sur la protection de l’État aux orphelins de la Révolution nationale et de la Guerre (BOE, 3 décembre 1940) accorda aux personnes « irréprochables du triple point de vue religieux, éthique et national » la tutelle d’enfants dont « l’éducation morale était en danger (González de Tena, 2012) ». La loi du 4 décembre 1941 permit l’inscription à l’État civil sous un nouveau nom des enfants des parents fusillés, disparus, exilés, prisonniers, fugitifs ou clandestins, afin de faciliter une éventuelle adoption. Ces deux textes ont ainsi « fourni une couverture officielle à une gigantesque opération de vols d’enfants, perpétrée par le régime franquiste ». À partir des années 1960, le trafic de bébés pour motifs politiques se doubla d’un trafic commercial mais non dénué d’un objectif social, puisqu’il concernait principalement les enfants des mères célibataires, des mineures, des couples analphabètes et des pauvres.
Dans un arrêt du 18 novembre 2008, le juge Baltasar Garzón attribua aux franquistes « le développement d’un système de disparition d’enfants mineurs de mères républicaines (mortes, prisonnières, exécutées, exilées ou disparues) pendant plusieurs années, entre 1937 et 1950 ». Il évalua à plus de 30 000 le nombre d’enfants de prisonnières politiques placés sous tutelle de l’État, une telle mesure entraînant la perte de l’autorité parentale sur l’enfant. D’autres enquêtes menées notamment par des historiens et des sociologues évaluèrent à 300 000 le nombre d’enfants espagnols qui auraient été volés ou adoptés illégalement. L’avocat Enrique Vila, qui s’est spécialisé dans les recherches de paternité, a estimé que plus de 15 % des actes de naissance entre 1940 et la fin des années 1980 étaient des faux officiels, et que le nombre d’enfants enlevés et revendus pour une somme allant de 300 euros dans les années 1940 à 24 000 euros – soit le prix d’un petit appartement – dans les années 1980 était supérieur à 300 000.[38]
En 2011, l’Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR)[39] demanda officiellement la création d’une commission d’enquête parlementaire; la demande fut rejetée en janvier 2012.
Les crimes commis durant la guerre civile et le régime franquiste étant couverts par les lois de 1977 et de 2007, lorsque les associations de victimes décident de demander l’ouverture d’enquêtes sur les disparitions d’enfants survenues depuis le retour de la démocratie, lesdites demandes sont généralement classées sans suite, les magistrats estimant les fondements juridiques insuffisants. Ainsi, une demande déposée par l’ANADIR au parquet général espagnol portant sur la disparition de 261 enfants a été rejetée le 1er février 2011. Pourtant, on a pu dénombrer, rien qu’en Andalousie, souvent à l’occasion de déplacements de tombes dans des cimetières, plus de 300 cas de cercueils vides d’enfants officiellement décédés et qui, en réalité, ont été enlevés à leur famille, déclarés orphelins et adoptés, souvent contre le versement d’une somme d’argent. Cela devrait suffire à la justice pour accepter plus facilement l’ouverture d’enquêtes sur de possibles cas de trafics d’enfants. De même, depuis deux décennies, se multiplient les confessions de parents qui, sur leur lit de mort ou dans leur testament, révèlent à leurs enfants les avoir achetés. Mais le parquet général rejette les demandes d’ouverture d’enquêtes au niveau national, estimant que si les faits sont avérés, ils ne relèvent pas de l’action concertée d’un réseau criminel mais sont autant de cas particuliers relevant de la compétence des juridictions locales. Dès lors, les trafics d’enfants n’entrent pas dans le cadre de la loi de 2007 sur la mémoire historique qui vise expressément à réhabiliter les victimes de la guerre civile et de la dictature franquiste. Moralement inacceptable, ce raisonnement l’est tout autant sur le plan juridique pour deux raisons. D’une part, le trafic d’enfants jusqu’à la disparition de Franco relevait d’une politique nationale décidée en 1940 au lendemain de la guerre civile, et l’on peut donc considérer comme recevable une demande d’enquête au niveau national. D’autre part, un trafic constitue sans aucune ambiguïté un crime contre l’humanité, donc imprescriptible, et qu’aucune loi ne peut légitimer.
Par conséquent, le refus d’ouvrir une enquête nationale et le fait de renvoyer les victimes aux juridictions locales vise manifestement un seul but : ralentir le plus possible l’établissement des faits sur le trafic d’enfants. Cela constitue une « obstruction juridictionnelle ». Par ailleurs, en refusant de qualifier les faits de crimes contre l’humanité, le parquet fait en sorte que les trois quarts des plaintes soient classés sans suite, car les faits sont prescrits et, sur ce fondement, les magistrats prononcent généralement l’acquittement lorsqu’ils acceptent de connaître des faits.[40]
La solution pourrait venir d’une proposition de loi sur les bébés volés dans l’État espagnol, déposée le 25 septembre 2018 par le parti de la gauche radicale UnidosPodemos, les indépendantistes de la Gauche républicaine catalane et le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), laquelle reprend les principales revendications des associations de défense des enfants victimes d’adoptions criminelles, notamment pour faciliter la recherche des parents naturels. Cette proposition de loi prévoit notamment la création d’une banque d’ADN et d’un registre unique des victimes, l’accès aux registres de naissance publics et privés et de l’Église, la création d’un parquet et d’une unité de police spécialisés, une prise en charge psychologique des victimes, et le lancement d’une campagne publique de sensibilisation.
La révélation de ce trafic de bébés à grande échelle finit de lever le voile sur la nature du régime franquiste, et il devient très difficile d’en prendre la défense. On peut penser que cela pourrait faciliter le règlement de l’autre grande question qui fait actuellement débat en Espagne : l’avenir du Valle de los Caídos, le symbole du régime franquiste devenu lieu de pèlerinage pour ses nostalgiques.
C. Le Valle de los Caídos
À une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Madrid se trouve un monument dont l’objet ne saurait se résumer au nom qui lui a été donné : El Valle de los Caídos, la vallée des morts.
Construit entre 1941 et 1959, ce monument, voulu par Francisco Franco, était initialement destiné à rendre hommage aux « héros et martyrs de la Croisade », c’est-à-dire aux combattants nationalistes morts pendant la guerre d’Espagne. Dans un souci d’apaisement, le Caudillo décida, en 1958, d’en faire un mausolée dédié à l’ensemble des morts de la guerre civile, y compris les républicains, pourvu que ceux-ci fussent catholiques. Près de 35 000 dépouilles, principalement nationalistes, furent ainsi déposées dans la crypte, non loin de la nef centrale dans laquelle fut transféré, en 1959, le corps de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange, rejoint en 1975 par celui du général Franco.
Outre le fait que les dépouilles des anciens combattants républicains placées dans le mausolée sont très peu nombreuses et qu’elles y furent transférées sans que l’autorisation des familles fût sollicitée, les tombes toujours fleuries de José Antonio Primo de Rivera et de Francisco Franco rappellent l’attachement d’une partie de la population espagnole au régime franquiste et constituent un lieu de culte politique que les démocrates considèrent comme une offense faite à la mémoire des centaines de milliers de victimes de la guerre civile et de la dictature.
Le 11 mai 2017, l’assemblée plénière du Congrès des députés adopta, par 198 voix – 12 députés ayant voté contre et 140 s’étant abstenus –, une proposition de résolution présentée par le PSOE par laquelle le gouvernement était invité à mettre en oeuvre les mesures appropriées pour l’exhumation de la dépouille de Francisco Franco (Cruz, 2017). Cette résolution n’avait aucune portée impérative pour le gouvernement et ne constituait qu’une invitation à donner une certaine orientation politique à son action. En outre, le déplacement du corps de Franco n’était pas envisagé par la loi de 2007. Enfin, selon l’article 16 de ladite loi, la vallée des morts a perdu son statut de monument politique funéraire et est dorénavant régie par les textes juridiques concernant les lieux de culte et les cimetières publics. Cet article précise notamment que « dans aucune partie de l’enceinte ne peuvent être accomplis des actes de nature politique ou des exaltations de la guerre civile, de ses protagonistes ou du régime franquiste ».
Mais le sentiment des Espagnols est tout autre : pour une grande majorité, le monument reste un point de référence de la dictature franquiste,[41] et il conviendrait d’en faire un lieu de réconciliation et de souvenir de l’ensemble de victimes de la guerre civile et de la dictature franquiste. Cela suppose, dans un premier temps, de déplacer les dépouilles de Francisco Franco et de José Antonio Primo de Rivera dans un lieu à l’écart de la basilique. Pourtant, alors que la majorité des Espagnols porte un jugement négatif sur la dictature franquiste, ils sont une minorité – moins de 40 % selon les différents sondages réalisés[42] – à souhaiter qu’une telle mesure soit prise. De même, la Fondation Franco et la famille du dictateur se sont opposées à l’exhumation du Caudillo et ont multiplié les recours pour la mettre en échec, avant de s’y résigner à condition que les restes soient transférés en plein centre-ville de Madrid, dans la crypte de la cathédrale de la Almudena, dans un quartier très touristique où ont lieu les cérémonies officielles, dans le but manifeste quoique non avoué de maintenir un culte à la mémoire de Franco.
Au-delà du contenu même de la résolution et de sa portée juridique et politique incertaine, il est intéressant de se pencher sur les raisons de l’abstention de 140 députés, principalement ceux du Parti populaire et de l’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Pour le Parti populaire, cette demande rompt l’engagement clé de la transition démocratique : que l’histoire ne serait pas utilisée comme un argument politique. Pour l’ERC, de même que pour Unidos Podemos – qui vota toutefois la proposition du PSOE « par responsabilité » –, l’initiative était trop timide et aurait dû aller beaucoup plus loin.
Finalement, le texte de la résolution n’est qu’un résumé des principaux points de la loi sur la mémoire historique auquel les auteurs ont ajouté l’exhumation de la dépouille du général Franco. En fait, l’objectif manifeste du PSOE était de réveiller la loi de 2007, que le Parti populaire, au pouvoir, n’appliquait pas, officiellement pour des raisons de restrictions budgétaires…
Outre le déplacement du corps du Caudillo, la proposition de résolution prévoyait la réalisation de travaux de localisation et d’exhumation des charniers de la guerre civile, la constitution d’une banque d’ADN pour faciliter l’identification des ossements, la réparation effective des victimes et la suppression de toute subvention ou aide publique aux organisations ou aux formations vantant les réalisations de Franco, sa politique ou son idéologie. Elle envisageait également la nullité des condamnations pénales prononcées par les tribunaux franquistes contre les républicains. Enfin, les parlementaires demandaient que le 11 novembre fût une journée de commémoration et d’hommage aux victimes du franquisme et que la mémoire historique fût inscrite dans les programmes éducatifs.
Finalement, suivant le vote des députés, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a ainsi annoncé, dans son discours du 18 juin 2018, qu’il souhaitait déplacer la dépouille de Franco et faire de la vallée des morts un « mémorial des victimes du fascisme » et un lieu de réconciliation (D’Halluin, 2018). Cette prise de position s’inscrit dans le prolongement des premières inspections de la nécropole par des spécialistes dans le but de s’assurer de la faisabilité technique de l’exhumation des dépouilles d’anciens combattants, en fonction notamment de l’état des ossements, lesquels ont été mal conservés et parfois mêlés (Le Figaro, 23 avril 2018). On peut penser que les familles des victimes devraient être de plus en plus nombreuses à demander la restitution des corps.
* * *
L’annonce de la création d’une commission de la vérité sur les crimes commis durant la guerre civile et la dictature franquiste quarante ans après l’adoption de la Constitution qui concrétisait, sur le plan juridique, la transition démocratique entreprise par le roi Juan Carlos au lendemain de la mort du général Franco ne pouvait manquer de susciter deux interrogations : quelles pouvaient être les motivations du président du gouvernement Pedro Sánchez, et quelles étaient les chances de réussite d’une telle entreprise ?
Un an après, ces deux questions demeurent d’actualité. La commission n’est toujours pas créée, et le silence sur certaines pages sombres de l’histoire de l’Espagne demeure bien gardé. Faut-il pour autant en conclure à un échec de la démarche entreprise le 29 août 2018 par Pedro Sánchez ? Ce serait probablement excessif, ne serait-ce que parce que celle-ci a eu deux conséquences positives. D’une part, la critique du passé franquiste de l’Espagne n’est plus considérée comme un danger pour la démocratie, et l’on assiste à ce titre à une certaine normalisation de l’histoire espagnole du xxe siècle. Ainsi, la décision prise d’exhumer la dépouille du général Franco du Valle de los Caídos n’a pas suscité de vague de protestation comme cela aurait été le cas il y a encore quelques années. D’autre part, il est encore trop tôt pour affirmer que la commission de la vérité ne sera jamais créée : il ne faut pas confondre prudence et jeu de dupes.
Pour autant, il convient de faire preuve d’un optimisme raisonnable. La décision de créer une commission de la vérité est avant tout politique au sens partisan du terme : elle est un hommage rendu au gouvernement républicain qui se trouve dédouané de ses crimes. On procède ainsi à une relecture manichéenne de l’histoire dans laquelle on peut voir une volonté d’instrumentalisation de celle-ci. Or, « la mémoire, lorsqu’elle est hémiplégique, ne règle rien (Wolton, 2018) ». L’histoire de la guerre civile espagnole et de la dictature franquiste est autrement plus complexe qu’un simple affrontement du bien contre le mal, comme l’imagerie populaire la représente trop souvent.
L’Espagne a été prise dans l’étau totalitaire de l’époque. Si Hitler y a testé ses armes, Staline, lui, a testé dans la péninsule ses méthodes de répression, de noyautage et de prise du pouvoir. Ce qui s’est fait du côté républicain a servi de galop d’essai au dictateur soviétique pour imposer son ordre. […] L’Espagne de ces années-là a servi de laboratoire au mal du siècle, rouge et brun, au détriment des Espagnols, finalement les premières victimes de ce qui allait déferler sur le reste du monde
Wolton, 2018
Ainsi, la décision de Pedro Sánchez de rouvrir les livres d’histoire est dangereuse, non pas en soi, mais du fait des motivations manifestes du président du gouvernement : les arrière-pensées idéologiques sont évidentes, et les risques sont grands de voir ravivées les divisions du pays sur le fondement d’un rappel de la guerre civile et de la dictature franquiste. De toute évidence, l’Espagne n’a toujours pas fait la paix avec son passé, et il serait regrettable que son histoire soit, à terme, victime d’une réécriture consensuelle ou partisane et que, le temps faisant son oeuvre, la vérité officielle, alimentée par l’oubli et la disparition progressive des acteurs et des témoins, s’impose peu à peu.
On ne peut ainsi qu’espérer que l’annonce par Pedro Sánchez de la création d’une commission de la vérité historique ne demeure pas un voeu pieux. Une telle commission pourrait aider à mieux connaître le passé de l’Espagne et à le libérer d’un carcan partisan dans lequel la droite comme la gauche tente de le maintenir. Elle répondrait ainsi à un besoin de reconnaissance et de justice toujours vivace. Elle contribuerait à écarter le risque d’une « déconsolidation » démocratique, laquelle n’est pas à exclure tant que les formations politiques hésitent entre le maintien de l’omerta sur la guerre civile et la dictature franquiste et leur instrumentalisation à des fins partisanes. Elle rappelle ainsi l’impérieuse nécessité pour un peuple de fonder son avenir commun sur une histoire collective la plus objective et la plus dépassionnée possible.
Appendices
Notes
-
[1]
Voir, par exemple, « La Comisión de la Verdad trabajará para “acordar una versión de país”, según Pedro Sánchez », Eldiario.es, 29 août 2018 (consulté le 14 mars 2019).
-
[2]
Pour une approche comparative, voir Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada, Madrid, Alizanza Editorial, 2008.
-
[3]
On peut considérer que la transition démocratique espagnole a commencé en septembre 1976 lorsqu’a été décidée la tenue d’élections libres, et qu’elle s’est terminée en octobre 1982 avec la victoire électorale du Parti socialiste ouvrier espagnol, lorsque l’ensemble de la classe politique a définitivement reconnu que les règles du jeu démocratique étaient le seul moyen d’accéder au pouvoir. En ce qui concerne les repères de périodisation du phénomène de transition démocratique, voir Juan Linz, « Transitions to democracy », The Washington Quaterly, no. 3, 1990, p. 157-158. La classe politique a finalement entériné le choix politique fait par la grande majorité des Espagnols qui, aux élections législatives de juin 1977, se sont détournés des extrêmes, l’extrême droite franquiste et les petits partis d’extrême gauche n’obtenant que 8 sièges, contre 165 pour l’Union du centre démocratique (coalition politique de centre-droite constituée autour du président du gouvernement Adolfo Suárez, symbole du ralliement des phalangistes modérés au projet de transition démocratique), 118 pour le Parti socialiste ouvrier espagnol, 20 pour le Parti communiste, 16 pour l’Alliance populaire et 14 pour le Parti socialiste populaire, 11 pour Convergence et Union (catalan) et 7 pour le Parti nationaliste basque.
-
[4]
La « mémoire historique » est un récit historique fondé sur des témoignages et des récits autobiographiques, donc non dénué de subjectivité, mais riche d’enseignements, car reflétant le vécu, même si les souvenirs sont inévitablement déformés par le temps; voir, par exemple, le témoignage et l’analyse édifiants du neuropsychiatre, Sauve-toi, la vie t’appelle, Paris, Odile Jacob, 2014. Voir notamment la loi du 26 décembre 2007, Loi de reconnaissance et d’extension des droits et de rétablissement des moyens en faveur de ceux qui ont souffert de persécution ou de violence durant la guerre civile et la dictature, communément appelée « Loi de mémoire historique », ou l’Association pour la récupération de la mémoire historique, créée en 2000 pour recueillir des témoignages sur les victimes du franquisme et réaliser des fouilles archéologiques pour identifier notamment les corps ensevelis dans des fosses communes.
-
[5]
Sur la question, voir Paul Ricoeur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paris, Seuil, 2000.
-
[6]
Il est d’ailleurs symptomatique que Pedro Sánchez ait évoqué sa décision de créer une commission de la vérité historique à l’occasion d’une visite officielle au Chili, rare pays ayant créé deux commissions de la vérité de la réconciliation.
-
[7]
Sur la pratique des commissions de la vérité et de la réconciliation, notamment en Amérique latine, voir notamment Sandrine Lefranc, Politiques du pardon, Paris, Presses universitaires de France (PUF), 2002 ; Étienne Jaudel, Justice sans châtiment. Les commissions Vérité-Réconciliation, Paris, Odile Jacob, 2019 ; Pierre Hazan, Juger la guerre, juger l’Histoire. Du bon usage des commissions Vérité et de la justice internationale, Paris, PUF, 2007 ; Arnaud Martin, La mémoire et le pardon. Les commissions de la vérité et de la réconciliation en Amérique latine, Paris, L’Harmattan, 2009.
-
[8]
La technique de la commission de la vérité et de la réconciliation peut également être utilisée en dehors du cadre d’une transition politique, c’est-à-dire dans des sociétés qui ne sont pas en proie à un conflit ou qui ne sortent pas d’un conflit. On peut citer en ce sens les exemples de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, créée en 2008 dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI) (https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1450124405592/1529106060525), et de la demande en octobre 2019 de la création d’une commission justice et vérité (CJV) par diverses associations antillaises afin notamment de « rechercher et retracer tous les éléments permettant d’écrire l’histoire du chlordécone » dans les Antilles françaises, où 90 % de la population a été contaminé par ce pesticide employé à grande échelle dans les bananeraies (https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/tribune-pollution-au-chlordecone-aux-antilles-cest-la-reconnaissance-de-la-responsabilite-de-letat-dans-ce-scandale-sanitaire-majeur-qui-nous-motive_3657477.html).
-
[9]
Allocution de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des juifs durant la deuxième guerre mondiale et sur les valeurs de liberté, de justice et de tolérance qui fondent l’identité française, Paris, 16 juillet 1995, https://www.elysee.fr/jacques-chirac/1995/07/16/allocution-de-m-jacques-chirac-president-de-la-republique-sur-la-responsabilite-de-letat-francais-dans-la-deportation-des-juifs-durant-la-deuxieme-guerre-mondiale-et-sur-les-valeurs-de-liberte-de-justice-et-de-tolerance-qui-fondent-lidentite-franca
-
[10]
Sur cette question, voir également Ariana Macaya Lizano, Histoire, mémoire et droit : les usages juridiques du passé, thèse, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, France, 2014, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01982171/document.
-
[11]
Sur la question, voir notamment Pierre Hazan, Juger la guerre, juger l’histoire, Paris, PUF, 2007.
-
[12]
La notion de « pacte d’oubli » a parfois été critiquée et présentée comme reflétant imparfaitement la réalité politique de l’Espagne de la fin des années 1970 (voir notamment Paloma Aguilar Fernandez, Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid, Alianza Editorial, 1996). Cette notion demeure pour autant largement utilisée dans les études portant sur la transition démocratique espagnole (voir, par exemple, Danielle Rozenberg, « Le “pacte d’oubli” de la transition démocratique en Espagne. Retours sur un choix politique controversé », Politix, no. 74, 2006, p. 173-188), même si certains auteurs préfèrent utiliser l’expression moins ambiguë de « pacte de silence » (Preston, Paul, « Venganza y reconciliacion: la Guerra Civil española y la memoria historica », dans Biruté Ciplijanskaite et Christopher Maurer (dir.), La voluntad del humanismo. Homenaje a Juan Marichal, Barcelone, Anthropos, 1990, p. 71-87).
-
[13]
Sur la notion de mémoire historique, voir notamment Enzo Traverso, Le passé, modes d’emploi : histoire, mémoire, politique, Paris, La Fabrique, 2006.
-
[14]
Voir notamment Pedro Luis Díaz Ruiz, « La memoria histórica », Sociedad de la información, no. 19, février 2010. Repéré le 2 décembre 2019 à : http://www.sociedadelainformacion.com.
-
[15]
Voir notamment Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Paris, PUF, 1950.
-
[16]
Voir Hugh Thomas, La Guerre d’Espagne : juillet 1936-mars 1939, vol. 2, Paris, Robert Laffont, 2009.
-
[17]
Le nombre de victimes est difficile à établir, de nouveaux charniers étant encore découverts aujourd’hui; cf. Beevor, Antony, La Guerre d’Espagne, Paris, Calmann-Lévy, 2006, p. 180-181; Richards, Michael, A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936-1945, Cambridge University Press, 1998, p. 11.
-
[18]
Voir, par exemple, Georges Bernanos, La France contre les robots, Editions AOJB, 2019 [1947], p. 26.
-
[19]
Sur l’évolution de la popularité de la monarchie en Espagne, voir https://everything.explained.today/Republicanism_in_Spain/ (consulté le 2 décembre 2019).
-
[20]
Voir notamment Julio De Busquets, Miguel A. Aguilar et Ignacio Puche, El Golpe: Anatomía y Claves Del Asalto Al Congreso, Barcelone, Ariel, 1981.
-
[21]
D’après ledit sondage, si le référendum avait eu lieu, 49 % des Espagnols se seraient prononcés en faveur du maintien de la monarchie avec l’accession au trône du prince Felipe, et 36 % auraient choisi le retour à la république.
-
[22]
La popularité de la monarchie connaît en effet une lente érosion que l’abdication de Juan Carlos Ier semble avoir enrayée. Voir Toharia, José Juan, « ¿Monarquía? ¿República? », El País, 22 décembre 2011, https://blogs.elpais.com/metroscopia/2011/12/monarquia-republica.html (consulté le 2 décembre 2019).
-
[23]
Il convient toutefois de noter qu’en moins d’un an, Felipe VI a réussi à restaurer la popularité de la monarchie espagnole, laquelle atteint 61,5 % d’opinions favorables, tandis que 75 % des Espagnols interrogés affirment avoir une bonne opinion de leur roi. Sur la question, voir Remírez de Ganuza, Carmen. « El Rey recupera el apoyo de los españoles a la Monarquía », El Mundo, 15 juin 2016, https://www.elmundo.es/espana/2015/06/15/557dc06f22601d30648b457e.html.
-
[24]
Il convient par ailleurs de noter, comme l’a fait Maurice Halbwachs, qu’« un homme, pour évoquer son propre passé, a souvent besoin de faire appel aux souvenirs des autres » (Halbwachs, 1950, p. 26).
-
[25]
On parle parfois d’« amnésie collective », laquelle constitue, non pas une perte collective des mémoires individuelles, mais l’occultation d’une partie de l’histoire espagnole pour faciliter un processus de transition démocratique consensuelle, même s’il est vrai que les souvenirs individuels sont inévitablement influencés par la société (voir en ce sens Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, PUF, 1925).
-
[26]
Sur la question, voir notamment « Del indulto a la amnistía », El País, 18 juillet 1976. Repéré à : https://elpais.com/diario/1976/07/18/espana/206488805_850215.html. Voir aussi La Vanguardia, 3 décembre 1976, p. 11.
-
[27]
Sur cette question, voir notamment Alfredo Grimaldos, Las claves de la transición (1973-1986), Madrid, Península, 2013; et Paul Preston, The Triumph of Democracy in Spain, New York, Methuen, 1986.
-
[28]
Sur cette question, voir notamment Bartolomé Bennassar, Histoire de Madrid, Paris, Perrin, 2013, p. 374.
-
[29]
Principe VI : « Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crime de droit international : c) Crimes contre l’humanité : L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis à la suite d’un crime contre la paix ou d’un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes. » Principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal. Texte adopté par la Commission à sa deuxième session, en 1950, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session, Annuaire de la Commission du droit international, 1950, vol. II, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/7_1_1950.pdf.
-
[30]
STS 101/2012, Sala de lo Penal, Sindicato de funcionarios públicos “Manos Limpias” y Asociación Civil Libertad e Identidad, 27 février 2012, p. 20.
-
[31]
Le Parti populaire recueillit 38,79 % des voix et obtint 156 sièges de députés sur les 350 que compte le Congrès des députés, contre 37,63 % des voix et 141 sièges pour le Parti socialiste ouvrier espagnol, 10,54 % des voix et 21 sièges pour Gauche unie (coalition de gauche à dominante communiste), et 4,60 % des voix et 16 sièges pour Convergence et Union (parti nationaliste catalan), sept autre partis politiques se partageant les seize sièges restants.
-
[32]
Cité par Jean-Hébert Armengaud, « Une loi de “mémoire historique” pour en finir avec la guerre civile », Libération, 18 octobre 2007.
-
[33]
Sur la notion de pacte d’oubli, voir notamment Paloma Aguilar Fernández, Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid, Alianza Editorial, 1996; Alexandra Barahona De Brito, Carmen González Enríquez et Paloma Aguilar Fernández, The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratizing Societies, Oxford, Oxford University Press, 2001.
-
[34]
Décret-loi du 23 août 1957, Boletín oficial del Estado, no. 226, 5 septembre 1957, p. 834-835.
-
[35]
Le Centre documentaire de la mémoire historique a été créé par le décret royal n° 697/2007 du 1er juin 2007, Boletín oficial del Estado, no. 143, 15 juin 2007, p. 25976.
-
[36]
La notion de crime contre l’humanité a été définie juridiquement par l’article 6 c du Statut de Nuremberg signé à Londres le 8 août 1945, comme « […] l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime ».
-
[37]
Voir, par exemple, Mathieu De Taillac, « Le juge Garzón acquitté dans le procès sur le franquisme », Le Figaro, 27 février 2012.
-
[38]
Intervention de Me Enrique Vila dans l’émission « Espejo público » d’Antena 3 du 26 janvier 2011.
-
[39]
Association nationale des victimes d’adoptions irrégulières.
-
[40]
Voir par exemple Sandrine Morel, « Espagne : le premier procès des “bébés volés” s’achève sans condamnation », Le Monde, 8 octobre 2018.
-
[41]
Sur la question, voir notamment Anthony Berthelier, « Sans Franco, que faire de la colossale Valle de los Caídos? », Huffington Post. Repéré le 2 décembre 2019 à : https://www.huffingtonpost.fr/entry/sans-franco-que-faire-de-la-colossale-valle-de-los-caidos_fr_5db04432e4b08cfcc3255a45.
-
[42]
Voir notamment Olga R. Santamartín, « El 54% opina que no es el momento de exhumar a Franco », ElMundo.es, 15 juillet 2018. Repéré le 2 décembre 2019 à : https://www.elmundo.es/espana/2018/07/15/5b4a2a39ca4741d7728b45ce.html.
Bibliographie
- Allocution de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des juifs durant la deuxième guerre mondiale et sur les valeurs de liberté, de justice et de tolérance qui fondent l’identité française, Paris le 16 juillet 1995, https://www.elysee.fr/jacques-chirac/1995/07/16/allocution-de-m-jacques-chirac-president-de-la-republique-sur-la-responsabilite-de-letat-francais-dans-la-deportation-des-juifs-durant-la-deuxieme-guerre-mondiale-et-sur-les-valeurs-de-liberte-de-justice-et-de-tolerance-qui-fondent-lidentite-franca
- Assemblée générale des Nations unies, « Principes de coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité », Résolution 3074 (XXVIII), 3 décembre 1973, p. 1, https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/PersonsGuilty.aspx.
- Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 828 (1984) relative aux disparitions forcées, https://rm.coe.int/09000016807975de.
- Boletín Oficial del Estado, n° 336, 3 décembre 1940.
- Boletín Oficial del Estado, n° 186, 4 août 1976, p. 15097. Repéré à : https://boe.vlex.es/vid/real-decreto-ley-amnistia-257350918.
- « Des experts au mausolée de Franco en vue d’éventuelles exhumations », Le Figaro, 23 avril 2018, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/04/23/97001-20180423FILWWW00187-des-experts-au-mausolee-de-franco-en-vue-d-eventuelles-exhumations.php (consulté le 25 janvier 2018).
- Discours du roi aux Cortes, 22 novembre 1975 (ABC, 23 novembre 1975).
- « El Rey recupera el apoyo de los españoles a la Monarquía », El Mundo, 15 juin 2016, https://www.elmundo.es/espana/2015/06/15/557dc06f22601d30648b457e.html
- « Garzon : “condamnation déplorable” », Le Figaro, 9 février 2012, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/02/09/97001-20120209FILWWW00682-garzon-condamnation-deplorable.php.
- « Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales », El País, 18 novembre 2008.
- « Instrumento de ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York, el 19 de diciembre de 1966 », Boletín Oficial del Estado, no. 103, 30 avril 1977, p. 9337-9338.
- Ley 46/1977, de 15 de octubre de 1977 de Amnistia, Boletín Oficial del Estado, no. 248, 17 octobre 1977, https://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-24937-consolidado.pdf.
- Memoria del Fiscal del Tribunal Supremo, 1977, p. 61.
- Organisation des Nations unies, Rapport du Comité des droits de l’homme, vol. 1, suppl. no. 40, A/64/40, New York, 2009, p. 43-48.
- « Pollution au chlordécone aux Antilles : “C’est la reconnaissance de la responsabilité de l’État dans ce scandale sanitaire majeur qui nous motive” », France info, 14 octobre 2019, https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/tribune-pollution-au-chlordecone-aux-antilles-cest-la-reconnaissance-de-la-responsabilite-de-letat-dans-ce-scandale-sanitaire-majeur-qui-nous-motive_3657477.html.
- Rapport du Secrétaire général des Nations unies, Rétablissement de l’État de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, Conseil de sécurité des Nations unies, 23 août 2004 (S/2004/616), par. 8, archive.ipu.org/splz-f/unga07/law.pdf.
- Altozano, Manuel, « La Audiencia suspende la apertura de fosas tras un tenso debate en la Sala Penal », El País, 8 novembre 2008.
- Baby, Sophie, « Sortir de la guerre civile à retardement : le cas espagnol, » Histoire@Politique, no. 3, novembre-décembre 2007, p. 3
- Bozonnet, Jean-Jacques, « Le juge Baltasar Garzon sur la sellette de la Cour suprême espagnole », Le Monde, 6 octobre 2019.
- Cruz, Marisa, « El Gobierno aparcará la exhumación de Franco », El Mundo, 12 mai 2017.
- D’Halluin, Nine, « Espagne : Pedro Sanchez veut retirer Franco de son mausolée », Le Figaro, 19 juin 2018.
- De Prémonville, Antoine, « Chronopathie », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, no. 10, 2013. Repéré le 2 octobre 2019 à : http://journals.openedition.org.docelec.u-bordeaux.fr/ccec/4631.
- González de Tena, Francisco, Niños invisibles en el cuarto oscuro, Madrid, Editorial Tébar, 2012.
- Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1991.
- Joinet, Louis, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques, Rapport final en application de la décision 1996/119 de la Sous-Commission, Nations unies, E/CN.4/Sub.2/1997/20 et E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.
- Juliá, Santos et José Carlos Mainer, El aprendizaje de la libertad. 1973-1986: la cultura de la transición, Madrid, Alianza, 2000, p. 45 et s.
- López Díaz, María José, et Manuel J. Albert, « Las exhumaciones tropiezan con los alcaldes de Almería y Córdoba », El País, 1er novembre 2008.
- Martín Villa, Rodolfo, « La seguridad interior en la transición, » dans Real Academia de Historia, Veinticino Años de Reinado de S.M. Don Juan Carlos I, Madrid, Real Academia de Historia / Espasa Calpe, 2002, p. 569-621.
- Osorio, Alfonso, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelone, Planeta, 1980.
- Toharia, José Juan, « ¿Monarquía? ¿República? », El País, 22 décembre 2011, https://blogs.elpais.com/metroscopia/2011/12/monarquia-republica.html
- Wahnich, Sophie, « Allemagne, Italie, France. Le devenir de la valeur “justice” dans la justice de transition en Europe occidentale », Mouvements, no. 53, 2008, p. 176.
- Wolton, Thierry, « Exhumation de Franco : “Le gouvernement Sánchez a aussi des arrière-pensées idéologiques” », Le Figaro, 24 août 2018.