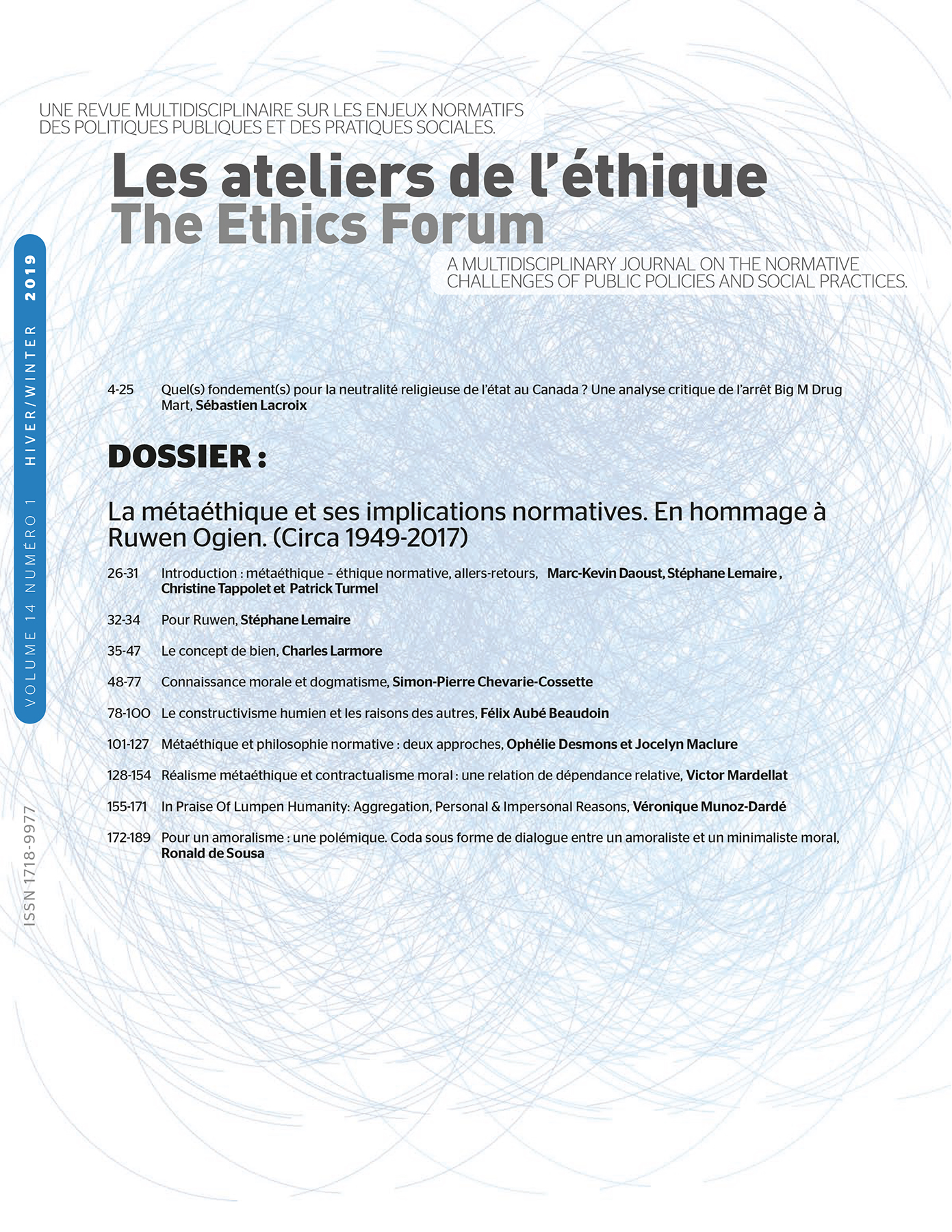Abstracts
Résumé
Dans cette contribution, nous nous demandons dans quelle mesure l’opposition entre contractualisme et conséquentialisme se joue sur le plan métaéthique. Nous montrons d’abord qu’il est possible d’aboutir au conséquentialisme à partir des prémisses métaéthiques du contractualisme moral – à savoir le réalisme sur les raisons. Nous réfutons ensuite l’idée que le traitement contractualiste du problème de l’agrégation présupposerait des jugements conséquentialistes. Cela nous invite à conclure, d’abord, que la relation entre contractualisme moral et réalisme métaéthique est une relation de dépendance relative. Mais cela implique aussi, plus généralement, qu’il serait faux de soutenir que nos convictions morales de premier ordre seraient toujours totalement déterminées par nos croyances métaéthiques – de même qu’il serait faux de soutenir qu’elles en seraient toujours parfaitement indépendantes.
Abstract
In this paper, I aim to understand to what extent the opposition between contractualism and consequentialism is rooted in metaethical premises. I first show that consequentialism is compatible with the metaethical premises of moral contractualism, that is, realism about reasons. I then refute the claim that the way in which contractualism deals with the issue of aggregation would presuppose consequentialist judgments. This leads me to conclude, first, that the relationship between moral contractualism and metaethical realism is one of relative dependence. But this also implies, more broadly, that it would be wrong to regard our first order moral convictions as being always wholly determined by our metaethical beliefs—just as it would be wrong to claim that the former are always completely independent from the latter.
Article body
1. INTRODUCTION
S’il y a bien une opposition de fond qui parcourt l’ensemble de la philosophie morale et politique normative contemporaine – qu’elle anime les débats portant sur la définition des droits individuels, divise les égalitaristes contemporains, ou éclaire les enjeux des batailles que se livrent les défenseurs et les pourfendeurs de prohibitions morales absolues à l’encontre de certaines actions, comme le meurtre d’un innocent –, c’est celle qui oppose éthiques déontologiques et éthiques conséquentialistes. Un bon indicateur de la centralité de cette opposition dans le champ de l’éthique normative est le fait que, comme le notait T. M. Scanlon en introduction de son célèbre article « Contractualisme et utilitarisme », « pour un très large éventail de gens, l’utilitarisme est la conception vers laquelle ils se sentent attirés lorsqu’ils tentent de produire une analyse théorique de leurs croyances morales. Dans le champ de la philosophie morale, l’utilitarisme représente une position qu’il faut affronter si l’on souhaite l’éviter ».[1] C’est en effet parce que l’utilitarisme est une théorie morale conséquentialiste que, dans les termes de Philippa Foot, il « hante même ceux d’entre nous qui ne veulent pas y croire », l’élément conséquentialiste de cette théorie étant « l’une des raisons principales pour lesquelles l’utilitarisme semble si convaincant ».[2] Résumant ce double constat – à savoir, d’une part, que l’opposition au conséquentialisme serait l’enjeu des principaux débats actuels dans le champ de l’éthique normative et, d’autre part, que cette opposition rendrait compte de la fascination qu’exerce sur nous l’utilitarisme –, Korsgaard écrit :
Aux yeux des générations futures, la philosophie morale du vingtième siècle ressemblera pour bonne part à une lutte visant à échapper à l’utilitarisme. Nous ne semblons parvenir à réfuter une doctrine utilitariste que pour nous trouver en proie à une autre doctrine de ce type. Je crois que c’est parce qu’un élément fondamental de la perspective conséquentialiste envahit et fausse encore notre pensée : l’idée que l’affaire de la morale est la production de quelque chose. […] L’objet de la morale n’est pas ce que nous devons produire, mais la manière dont nous devons nous rapporter les uns aux autres.[3]
La dernière phrase de ce passage met le doigt sur ce qui, du moins pour Korsgaard, distingue fondamentalement le conséquentialisme du déontologisme : les conséquentialistes conçoivent la philosophie morale comme une entreprise théorique dont l’objet, sinon unique, du moins principal, serait de nous dire quelles conséquences nous devons produire au moyen de nos actes, alors que les partisans d’une éthique déontologique, s’ils ne jugent certes pas qu’il faille tout bonnement cesser de s’intéresser aux conséquences de nos actions,[4] attribuent à celles-ci une importance mineure en comparaison de la question, pour eux fondamentale, de savoir quel type de relation nous devons adopter les uns vis-à-vis des autres. En d’autres termes, quels que soient les critères auxquels se réfèrent les conséquentialistes pour attribuer telle ou telle valeur à l’une ou l’autre des conséquences de nos actions, ils se rejoignent pour considérer que c’est à l’aune de la valeur de leurs conséquences (certaines ou probables) que nos actions doivent être jugées. Au contraire, quelle que soit la manière dont les partisans d’une éthique déontologique conçoivent l’idéal relationnel auquel l’agent moral doit aspirer, ils s’accordent pour dire que, si les conséquences de nos actions importent, ce n’est que dans la mesure où elles ont des implications pour le type de relation que nous entretenons avec celles et ceux qui sont affectés par elles.
Étant donné la centralité de l’opposition entre le conséquentialisme et la déontologie dans le champ de l’éthique normative, il est intéressant de nous demander si cette opposition ne prendrait pas sa source sur le plan métaéthique. Afin d’aborder la question de la nature de la relation entre métaéthique et éthique normative, notre démarche consistera à partir, non pas de telle ou telle théorie métaéthique, afin par exemple d’en éprouver les implications normatives, mais plutôt de la question de l’opposition au conséquentialisme, pour voir si celle-ci repose, et si oui dans quelle mesure, sur des prémisses métaéthiques.
Les deux théories morales retenues pour conduire cet examen sont le contractualisme scanlonien et le conséquentialisme (sous quelque forme que ce soit). Les raisons de ce choix de la théorie contractualiste plutôt que d’une autre théorie déontologique sont doubles. Premièrement, comme nous le verrons plus loin, nous estimons qu’il est possible d’aboutir au conséquentialisme à partir des prémisses métaéthiques du contractualisme, à savoir le réalisme sur les raisons[5] : si tel est bien le cas, et que cela n’atténue pas la dimension anti-conséquentialiste du contractualisme, alors on ne saurait soutenir que l’opposition, centrale dans le champ de l’éthique normative, entre déontologie et conséquentialisme se jouerait entièrement sur le plan métaéthique.
Deuxièmement, le contractualisme accorde une importance fondamentale à la relation de reconnaissance mutuelle, puisque c’est l’attrait que revêt pour nous ce type de relation – et la douloureuse culpabilité que nous éprouvons envers autrui lorsque nous avons dégradé notre relation interpersonnelle – qui rend compte de l’importance que nous attachons au fait d’éviter de commettre des actions qui sont moralement injustes au sens où la théorie contractualiste l’entend (c’est-à-dire des actions qui ne sont pas idéalement justifiables auprès d’autrui).[6]
Scanlon contraste cette analyse substantielle de la motivation morale avec les analyses formelles, qui cherchent à expliquer pourquoi nous devons nous soucier d’agir moralement sans faire référence à des fins ou à des valeurs particulières (comme la valeur que nous attachons d’après lui au fait de partager avec autrui une relation de justifiabilité mutuelle) : la stratégie des kantiens consiste ainsi à montrer que, dans la mesure où nous sommes des agents rationnels, nous ne pouvons que reconnaître l’autorité pratique de l’impératif catégorique. Scanlon reproche à cette stratégie de ne pas pouvoir nous dire de manière adéquate pourquoi nous aurions tort de ne pas nous soucier de vivre conformément aux préceptes de la moralité. D’après lui : « la force particulière des exigences morales semble bien différente de celle […] de principes de la logique », et « la faute consistant à échouer à être mû par ces exigences ne semble pas être une forme d’incohérence ».[7] Ainsi, dans la théorie contractualiste, l’idéal relationnel de la justifiabilité interpersonnelle permet de répondre aussi bien à la question de savoir pourquoi telle ou telle action est moralement prohibée ou autorisée (nous développerons ce point plus loin) qu’à celle de savoir pourquoi nous devrions nous soucier de respecter les préceptes de la moralité.
Par contraste, la réponse des conséquentialistes à la question de la motivation morale consiste à dire que nous aurions tort de ne pas nous soucier d’agir moralement parce que cela reviendrait à nier que nous devions agir de telle manière à maximiser le bien et à minimiser le mauvais, ou parce que cela reviendrait à dire que, alors que nous sommes en position de rendre le monde meilleur grâce à nos actes, cela n’aurait pas d’importance. Comme beaucoup l’ont noté,[8] il semble difficile de résister à cette idée, qui réside au coeur de la doctrine conséquentialiste : quiconque rejette le conséquentialisme semble nous dire, ou bien que la morale exige de nous que nous produisions moins de bien que nous le pouvons, ou que nous empêchions moins de mal d’advenir qu’il nous est possible de le faire – c’est la position déontologique, telle que les conséquentialistes la présentent, la jugeant « paradoxale »[9] –, ou bien que cet objectif moral (rendre le monde meilleur), si c’est bien ce que la morale nous demande, n’a aucune espèce de valeur ou d’importance – ce serait la position de l’amoraliste, telle que perçue dans la perspective conséquentialiste.
En dépit de l’importance primordiale que le contractualisme attache à la question de « la manière dont nous devons nous rapporter les uns aux autres » – qui en fait une doctrine non conséquentialiste, si l’on préserve l’analyse korsgaardienne de l’opposition entre la déontologie et le conséquentialisme –, certains auteurs ont soutenu que la procédure contractualiste n’était pas en mesure de justifier certains jugements moraux largement partagés – comme l’idée, que Scanlon lui-même semble vouloir défendre, que si nous ne pouvons secourir que l’un ou l’autre de deux groupes de personnes qui toutes seraient menacées par un même danger, il nous faudrait, ceteris paribus, sauver le groupe le plus nombreux – sans devoir pour cela présupposer, à telle ou telle étape du raisonnement, un jugement conséquentialiste. Il importe donc d’examiner ce verdict, puisque s’il est vrai (c’est la deuxième raison du choix du contractualisme dans cette enquête), alors l’opposition entre contractualisme et conséquentialisme perd en force, ce qui pourrait être expliqué par le fait que ces deux doctrines partagent des prémisses métaéthiques communes.
2. LE RÉALISME MÉTAÉTHIQUE SCANLONIEN
L’essence de la position métaéthique de Scanlon repose sur trois thèses. La première porte sur l’objet même du champ de la métaéthique contemporaine : par opposition aux questions qui étaient centrales dans les débats métaéthiques qui s’étendaient de la première moitié du siècle dernier à la fin des années 1970, les métaéthiciens contemporains – et Scanlon avec eux – ne s’intéressent pas uniquement à la valeur de vérité des jugements moraux, mais plus généralement à la valeur de vérité des jugements normatifs (c’est-à-dire des jugements qui portent sur nos raisons de croire, d’agir ou d’adopter une attitude quelconque).[10] En d’autres termes, nous ne nous demandons plus d’abord et avant tout si nos jugements moraux prétendent ou peuvent être vrais, si les propriétés morales fondamentales existent, ou encore comment nous pourrions savoir que tel jugement moral serait vrai et que tel autre serait faux ; nous nous demandons plutôt si le jugement que, dans une situation donnée, un agent (et tout agent se trouvant dans des circonstances similaires) a raison d’entreprendre l’action x, peut être vrai, comment nous pourrions le savoir, etc. Puisque les jugements moraux de premier ordre sont des jugements normatifs d’un type particulier, en ce qu’ils portent ultimement sur les raisons que, d’un point de vue moral, nous avons d’éviter de commettre tel acte ou d’adopter telle attitude, ces interrogations – que l’on pourrait qualifier de métanormatives plutôt que de métaéthiques –, quoique plus larges que les questions métaéthiques traditionnelles, entretiennent avec l’éthique normative la même relation que ces dernières : un jugement moral est un jugement normatif d’un type particulier dont on se demande s’il peut être vrai, comment nous pouvons le savoir, etc.
Deuxièmement, Scanlon soutient que les questions ontologiques ou métaphysiques n’ont aucun sens lorsqu’elles sont posées à l’extérieur du domaine particulier – par exemple l’algèbre ou la morale – qui porte sur les entités – les nombres ou le bien et le juste – dont nous nous demandons si elles existent. Cette thèse est explicitée par une autre thèse, à savoir que « la question de la valeur de vérité des jugements qui portent sur un domaine, dans la mesure où ils n’entrent pas en conflit avec les jugements portant sur un autre domaine, est adéquatement réglée (settled) par les standards [de raisonnement] du domaine sur lequel elle porte ».[11] Comme le note Scanlon, cette thèse est à la fois épistémologique et substantielle : « Dans la lecture substantielle, les considérations qui règlent la question sont celles qui font que la réponse à cette question est vraie ou correcte. Dans la lecture épistémologique, les considérations qui règlent cette question sont les choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer comme sur des preuves de ce qu’une réponse est correcte. »[12] Cela signifie que, pour savoir si certaines entités existent – et donc pour répondre à des interrogations d’ordre ontologique ou métaphysique –, il convient de voir si les standards de raisonnement qui portent sur le domaine auquel appartiennent ces entités nous conduisent à conclure, lorsque nous les respectons scrupuleusement, à l’existence de ces entités. (À la question de savoir s’il existe un nombre premier entre 17 et 23, nous pouvons répondre par l’affirmative en citant 19, en montrant sur la base de multiplications qu’« il n’existe pas deux nombres plus petits que 19 tels que, lorsqu’on les multiplie, on obtienne 19 ».[13])
Pour Scanlon, un domaine n’existe que si les standards de raisonnement qui nous permettent de formuler des jugements corrects sur l’existence des entités qui le composent forment un ensemble cohérent et n’entrent pas en conflit avec les standards de raisonnement qui sont propres à un autre domaine. (Prenons l’exemple de la relation entre les domaines de la science et de la religion : si les croyances d’un théiste en l’existence d’une entité divine capable d’intervenir dans le cours des choses et des actions humaines sont incompatibles avec ses croyances scientifiques sur la causalité naturelle, il peut en venir à réviser ses croyances religieuses afin de dissiper cette incompatibilité entre les deux domaines ainsi conçus.)[14] Ainsi, dire qu’une entité quelconque existe – par exemple les nombres – signifie, d’abord, que le domaine qui porte sur une entité de ce type – l’algèbre – existe lui-même, étant constitué par un ensemble cohérent de standards de raisonnement qui sont compatibles avec les standards de raisonnement qui portent sur d’autres domaines, et, ensuite, que ces entités existent dès lors que les standards de raisonnement du domaine en question nous en donnent l’assurance. Cette thèse est celle du réalisme quiétiste scanlonien : la question de l’existence n’a de sens que lorsqu’elle est posée à l’intérieur du domaine qui porte sur l’entité dont on questionne l’existence. C’est pourquoi, pour Scanlon, le fait que les raisons, les propriétés morales ou les nombres n’existent pas au sens où les objets du monde naturel existent (ils n’ont pas de coordonnées spatio-temporelles, ne sont pas soumis aux lois de la causalité naturelle, etc.) n’invite pas à conclure à leur inexistence : cela signifie plutôt que les raisons, les propriétés morales, les nombres et les objets naturels existent tous d’une manière différente, qui est propre chaque fois au domaine auquel ils appartiennent respectivement. Il n’y a donc pas qu’un seul mode d’existence, tel que toute entité qui n’existerait pas sur ce mode échouerait à exister en un sens plus robuste (c’est-à-dire indépendant de la question de l’existence telle que posée au sein d’un domaine quelconque) : si l’existence des propriétés morales n’est pas incompatible avec une vision scientifique du monde, c’est parce que la question de leur existence doit être posée dans les termes mêmes du raisonnement moral, qu’il convient de ne pas confondre avec la question que nous posons lorsque nous statuons sur l’existence des montagnes et des rivières.
Troisièmement, Scanlon considère que les propriétés fondamentales du domaine normatif sont les raisons, non les désirs, et qu’il serait par ailleurs erroné de croire que nos raisons découlent toujours nécessairement des exigences structurelles de la rationalité ou de nos motivations subjectives préexistantes. Il y a dans cette troisième thèse trois idées distinctes mais néanmoins liées. Sur la première, notons que, si le fait qu’Anne désire manger un sorbet à la framboise ou écouter Parsifal peut certes constituer une bonne raison pour elle de le faire, ces désirs reposent eux-mêmes sur des raisons : en effet, si elle a de tels désirs, c’est parce que la fraîcheur et la saveur du sorbet d’un côté, la profondeur du drame et la beauté extatique de la musique de Wagner de l’autre, lui semblent constituer de bonnes raisons de déguster le sorbet ou d’écouter Parsifal. Si elle en venait à réviser les jugements qu’elle porte sur les qualités respectives du sorbet et de l’opéra de Wagner, elle modifierait automatiquement l’envie qu’elle nourrit à leur endroit (si on la suppose rationnelle). Si nos désirs constituent parfois eux-mêmes des raisons (le fait qu’Anne ait envie d’un sorbet à la framboise peut être une raison pour moi de lui en offrir un, si je juge que j’ai de bonnes raisons de vouloir lui faire plaisir), ils présupposent donc toujours des jugements normatifs portant sur nos raisons d’avoir tel ou tel désir. C’est en ce sens que, pour Scanlon, les éléments les plus fondamentaux du domaine normatif sont les raisons et non les désirs.[15]
Sur le deuxième point, notons que les raisons qu’a Anne de vouloir écouter Parsifal ne sont pas nécessairement produites par un souci de préserver une certaine cohérence avec les attitudes qu’elle adopte par ailleurs : ses raisons n’ont rien à voir avec le fait que, si elle ne nourrissait qu’un faible intérêt pour le drame de Wagner, Anne se montrerait irrationnelle dans la mesure où cela serait incompatible avec le fait qu’elle voue une admiration sans bornes au Parzival du Minnesänger Wolfram von Eschenbach ou aux derniers écrits de Nietzsche sur Wagner. En d’autres termes, Scanlon refuse de faire reposer tout jugement du type « Anne a raison d’écouter Parsifal » sur un jugement du type « Anne serait irrationnelle de ne pas avoir l’intention d’écouter Parsifal », certains jugements du premier type (des jugements normatifs substantiels) ne pouvant être obtenus à partir de jugements du second type (des jugements normatifs structurels). Admettons qu’il soit possible de fonder l’une des raisons pour lesquelles Anne devrait vouloir écouter Parsifal à partir du jugement structurel selon lequel il serait irrationnel pour elle d’adopter l’attitude contraire compte tenu de sa passion pour le Parzival de Wolfram von Eschenbach. Dans un tel cas, nous pourrions dire, d’abord, que si c’est principalement en raison d’un tel souci de cohérence entre ses diverses attitudes qu’Anne souhaite écouter Parsifal, cette motivation, si elle venait à la confier à un ami wagnérien, paraîtrait ridicule aux yeux de ce dernier (voire peut-être offensante, si l’on tient compte de l’admiration quasi religieuse que certains vouent aux drames de Wagner), puisqu’elle ne répond en rien aux qualités propres à cet opéra qui font qu’il mérite d’être écouté. Nous pourrions ensuite nous demander pour quelles raisons Anne devrait chérir l’écrit du Minnesänger, c’est-à-dire, non pas en quoi il serait irrationnel de sa part de ne pas l’apprécier, mais plutôt quels sont les traits distinctifs de l’ouvrage qui méritent son admiration (et la nôtre). Il semble donc que certaines questions normatives substantielles ne puissent être évitées ou reléguées au second plan à côté de la question des exigences structurelles de la rationalité. Cette thèse revient à rejeter, au profit du réalisme métaéthique, le constructivisme kantien sur les raisons défendu par Korsgaard, dont l’objectif principal, tel que Scanlon le conçoit, serait de « montrer que tous les jugements normatifs valides » ont pour fondement « des jugements de normativité structurelle sur ce que nous devons faire si nous ne sommes pas irrationnels ».[16]
Ce deuxième point s’accorde avec le troisième, à savoir la défense par Scanlon de l’existence des raisons externes. Partant de l’idée qu’il ne serait pas vraisemblable d’expliquer pourquoi nous avons agi de telle ou telle manière en citant une raison qui en réalité nous laisse indifférents, Bernard Williams[17] conclut que des jugements normatifs qui énonceraient des prescriptions pratiques nous laissant totalement froids et qui seraient incapables de motiver notre action ne peuvent qu’être erronés. Cela revient à nier l’existence des raisons externes, qu’il définit comme celles qu’un sujet rationnel ne pourrait pas reconnaître, ou celles par lesquelles il ne pourrait pas être mû, en raisonnant de manière correcte à partir d’éléments motivationnels préexistants. Scanlon rejette cette thèse au motif qu’il importe de ne pas confondre la question de savoir ce qui est effectivement susceptible de motiver un agent avec celle de savoir par quelles raisons il devrait être motivé, qu’il en soit ou non capable compte tenu de ses motivations préexistantes. La négation par Williams de l’existence des raisons externes et la tentative par Korsgaard de fonder tout jugement normatif sur les exigences structurelles de la rationalité ont certes l’avantage de nous permettre de dire à un adversaire dans un débat que, s’il ne peut pas être cohérent pour lui de rejeter tel ou tel jugement normatif étant donné les croyances et les attitudes qu’il adopte par ailleurs, alors il doit changer de position et accepter ce jugement (ou réviser les attitudes susdites). Scanlon rétorque cependant qu’il n’y a pas lieu de penser que ce en vertu de quoi un jugement normatif est correct doive nécessairement coïncider avec ce en vertu de quoi il ne serait pas cohérent de la part de notre adversaire dialectique de le nier. Comme il l’écrit, « le simple fait que l’on ne puisse pas rejeter en toute cohérence un jugement sur des raisons étant donné que l’on a un certain désir, une certaine intention ou une autre attitude ne suffit pas pour régler la question. On peut toujours se demander pourquoi l’on devrait avoir ces attitudes – c’est-à-dire si elles peuvent être justifiées de manière adéquate ».[18]
3. DU RÉALISME MÉTAÉTHIQUE AU CONTRACTUALISME ET AU CONSÉQUENTIALISME
Le contractualisme scanlonien est la théorie selon laquelle la permissibilité morale de nos actions dépend de la justifiabilité du principe qui autorise ces actions auprès de chacune des personnes pouvant être affectées par elles. Le conséquentialisme, quant à lui, est l’idée que notre devoir moral serait toujours d’agir de manière à produire les meilleurs états de choses (states of affairs) tels que jugés d’un point de vue impersonnel. Aucune de ces deux doctrines n’est incompatible avec le réalisme métaéthique exposé dans la section précédente.
Tout d’abord, elles reconnaissent toutes deux l’existence des raisons externes. Dans la perspective contractualiste, le fait qu’une action soit injustifiable auprès d’autrui constitue une raison conclusive pour tout agent de ne pas l’entreprendre, qu’il soit ou non capable, en raisonnant de manière correcte à partir de dispositions motivationnelles préexistantes, d’être motivé par cette raison – c’est-à-dire qu’il accorde ou non de la valeur à l’idéal relationnel de la reconnaissance mutuelle tel que compris dans les termes de la théorie contractualiste. Si, par exemple, Jeanne est incapable de comprendre en quoi le fait que Julie ait de sérieuses objections à l’encontre du meurtre qu’elle s’apprête à commettre constitue une raison conclusive pour elle de ne pas la tuer, cette raison n’en disparaît pas pour autant : en effet, l’incapacité de Jeanne à saisir l’importance de l’objection de Julie lui fait dire que le fait que Julie ait cette objection ne constitue pas en réalité une raison pour elle de ne pas la tuer,[19] ce qui revient à nier la thèse centrale du contractualisme – selon laquelle la permissibilité morale de nos actions dépend de la justifiabilité auprès d’autrui du principe qui les autorise – plutôt qu’à l’invalider.
Pour un conséquentialiste, toute personne qui n’agirait pas constamment avec pour objectif la production des états de choses qui, d’un point de vue impersonnel (et non du point de vue de ses propres intérêts), sont les meilleurs d’entre tous ceux qu’elle est en position de faire advenir, serait coupable de ne pas répondre adéquatement aux raisons d’agir qui découlent de la valeur de tel ou tel état de choses – et cela qu’elle puisse ou non être conduite, sur la base d’un raisonnement correct qui prendrait pour point de départ des dispositions motivationnelles déjà ancrées en elles, à apprécier la valeur intrinsèque des états de choses. Un bon indicateur de la reconnaissance de l’existence des raisons externes par le conséquentialisme est le fait que Williams[20] ait objecté à l’utilitarisme (et au conséquentialisme en général) qu’il détruirait l’intégrité de l’agent en ce qu’il ferait dépendre la légitimité de n’importe lequel de ses projets et de ses engagements personnels du degré de promotion, par ce projet ou cet engagement, de l’objectif conséquentialiste de la production des meilleurs états de choses : en d’autres termes, non seulement le conséquentialiste soutient que, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, nous avons pour devoir de toujours nous efforcer de produire les meilleures conséquences telles qu’évaluées d’un point de vue impersonnel, mais cette doctrine aboutit aussi à l’idée que la valeur de nos projets de vie et de nos engagements personnels les plus profonds devrait toujours être mesurée à l’aune de la visée des meilleures conséquences.
Ensuite, ce qui, pour l’une ou l’autre doctrine, justifie notre raison d’agir, ou bien de manière idéalement justifiable auprès d’autrui, ou bien de telle sorte à maximiser le bien, n’est pas l’idée qu’une indifférence à l’égard d’une raison de l’un ou l’autre type serait le signe d’une irrationalité de l’agent : la raison pour laquelle nous devons produire les meilleures conséquences, d’après les conséquentialistes, est que ce sont, précisément, les meilleures conséquences, et cette raison n’est pas fondée dans un jugement de normativité structurelle. Pour savoir pourquoi le contractualisme nous assigne l’objectif de vivre en accord avec les préceptes de la justifiabilité mutuelle, et pourquoi le conséquentialisme nous enjoint de nous soucier d’abord et avant tout des conséquences impersonnelles de nos actes, il convient de voir comment ces deux théories conçoivent respectivement le domaine (l’éthique normative) qui concerne les jugements moraux que l’une ou l’autre tient pour valides en ce qu’ils seraient justifiés par des standards de raisonnement que celle-ci ou celle-là regarde comme adéquats.
Si le domaine de l’éthique normative existe, c’est qu’il existe un ensemble cohérent de standards de raisonnement qui, d’une part, ne sont pas incompatibles avec les standards de raisonnement qui portent sur d’autres domaines, et qui, d’autre part, nous permettent de répondre à la question à la fois substantielle et épistémologique de la valeur de vérité de nos jugements moraux de premier ordre. La question sur laquelle contractualistes et conséquentialistes s’opposent est celle de savoir quels standards de raisonnement sont les plus adéquats pour nous donner l’assurance que certains jugements moraux sont vrais là où d’autres sont faux : pour les uns, nos jugements moraux sont valides dès lors qu’ils sont justifiables auprès d’autrui en vertu de leur compatibilité avec des principes que nul ne pourrait raisonnablement rejeter, alors que pour les autres, ils sont valides à partir du moment où ils s’accordent avec l’objectif consistant à toujours agir de telle sorte à produire les meilleures conséquences telles que jugées d’un point de vue impersonnel. Ce désaccord signifie, d’une part, que ces théories soutiennent l’une et l’autre que les propriétés sur lesquelles portent nos jugements moraux de premier ordre (le juste et l’injuste, par exemple) existent et que les standards de raisonnement qu’il convient selon l’une ou l’autre de respecter afin d’éprouver la validité de ces jugements forment un ensemble cohérent, et, d’autre part, que ces théories ne partagent pas la même compréhension de ce que pourrait être une appréciation adéquate des valeurs au respect desquelles la vie morale est dédiée.
Bien que le domaine d’application du conséquentialisme soit plus étendu que celui du contractualisme, qui se demande uniquement de quelle manière il convient d’interagir avec autrui afin de respecter sa valeur en tant que créature rationnelle, le conséquentialisme émet évidemment des prescriptions qui portent sur le domaine de la moralité interpersonnelle, de sorte que, même si les conséquentialistes ne sont pas tenus d’accepter la thèse de la fragmentation de la moralité[21] – d’après laquelle l’idée de ce qui est moralement mal ou injuste (wrong) prend un sens différent selon qu’elle concerne notre relation à autrui, à la nature, ou aux animaux –, contractualisme et conséquentialisme offrent bel et bien des analyses contradictoires d’un même domaine, à savoir celui qui porte sur ce que nous nous devons les uns aux autres. La valeur centrale au sein de ce domaine est celle de la personne humaine.
C’est à partir de là que contractualisme et conséquentialisme s’opposent. Pour les conséquentialistes, reconnaître la valeur de la personne humaine, c’est répondre adéquatement au fait que les individus ont un bien (que certains actes leur sont bénéfiques et que d’autres leur nuisent), tandis que pour les contractualistes, l’important est que les individus, en plus d’avoir des intérêts au regard desquels certaines actions leur sont bénéfiques là où d’autres leur sont nuisibles, ont eux-mêmes des raisons. Pour les premiers, nos raisons d’agir, d’un point de vue moral, résident dans le fait que telle action causerait un dommage ou un préjudice à autrui là où telle autre tournerait à son avantage ou favoriserait l’avancement de ses intérêts : puisque la personne humaine a de la valeur, nous sommes tenus d’éviter, autant que faire se peut, d’épouser des lignes de conduite qui nuiraient aux intérêts des autres. La valeur morale de nos actes, pour le conséquentialisme, réside donc entièrement dans la valeur de leurs conséquences pour autrui : plus ils sont bénéfiques pour les individus qui nous entourent, meilleurs sont nos actes, et plus ils leur sont nuisibles, moins ils sont bons. Lorsque les intérêts des diverses personnes qui peuvent être affectées par nos actions entrent en conflit, il convient donc d’agir de telle sorte à satisfaire les intérêts du plus grand nombre, puisque cela revient à produire les conséquences qui sont les meilleures, non pas du point de vue de telle ou telle personne – certainement pas du point de vue de celles dont les intérêts seront sacrifiés –, mais du point de vue impersonnel qui considère la valeur qui est intrinsèque à l’état de choses dans lequel les bénéfices produits par notre action sont maximisés et les dommages minimisés. Agir moralement, c’est donc, pour le conséquentialisme, agir de telle sorte à produire le meilleur état de choses, c’est-à-dire celui qui maximise l’objectif de la satisfaction des intérêts du plus grand nombre.
Cette perspective impersonnelle est rejetée par le contractualisme. Pour cette théorie, en effet, la valeur de la personne humaine réside dans le fait qu’elle est capable, en tant que créature rationnelle,[22] de comprendre, de former et d’évaluer des jugements portant sur des raisons. Ce qui importe, ce n’est donc pas de produire les meilleures conséquences telles que jugées d’un point de vue impersonnel, mais d’interagir avec autrui d’une manière à laquelle il ne pourrait pas raisonnablement s’opposer en son propre nom. Respecter la valeur de la personne humaine, c’est donc tenir compte des raisons qu’autrui peut avoir de s’opposer à ce que j’interagisse avec lui de telle ou telle manière. Pour Scanlon, le fait d’agir de manière injustifiable, en plus de nuire aux intérêts d’autrui, revient aussi à faire fi du fait qu’autrui est en mesure d’apprécier le peu de cas que j’accorde à ses raisons de s’opposer à ce que je le traite de telle ou telle façon : en d’autres termes, agir de manière injustifiable, c’est mépriser la valeur d’autrui en tant que créature rationnelle. Une action est donc juste, pour le contractualisme, si elle est autorisée par un principe qu’il ne serait pas raisonnable pour autrui de rejeter, en supposant qu’il se soucie lui aussi d’interagir avec nous de manière idéalement justifiable.
Malgré les défauts évidents d’une présentation aussi succincte et schématique du conséquentialisme et du contractualisme, nous pouvons apprécier la profondeur de l’opposition qui existe entre ces deux théories. D’un côté, nous devrions avoir pour objectif de produire les états de choses qui sont les meilleurs d’un point de vue impersonnel, alors que de l’autre, ce n’est pas tant à la valeur impersonnelle d’un état de choses qu’il faut être sensible qu’aux raisons des autres, et en particulier aux objections qu’ils peuvent formuler en leur propre nom contre les actions que nous nous proposons d’entreprendre. Bien que le principe fondamental du conséquentialisme – que l’on pourrait résumer par la maxime « agis toujours de telle sorte à maximiser le bien » ou « agis toujours de telle sorte à produire les conséquences qui, d’un point de vue impersonnel, sont les meilleures » – soit rejeté par la théorie contractualiste – dont le principe fondamental peut être résumé par la maxime « n’agis jamais de manière injustifiable » ou « n’agis jamais d’une manière qui serait prohibée par un principe que nul ne pourrait raisonnablement rejeter » –, le conséquentialisme est compatible avec les positions métaéthiques de Scanlon.
En effet, rien dans l’idée que nous aurions pour devoir moral de maximiser le bien ne nie l’existence des raisons externes, ne suppose que tous les jugements normatifs valides doivent être fondés sur des jugements normatifs structurels, ni ne conteste la primauté des raisons sur les désirs. De plus, nous avons abouti au principe conséquentialiste à partir d’une certaine caractérisation de la valeur qui est centrale dans le domaine de l’éthique normative, sans que cela ait impliqué de remettre en cause l’ontologie scanlonienne des domaines et des entités qui les composent. Pour répondre à la question de la valeur de vérité du jugement selon lequel il serait injuste de la part de Jeanne de tuer Julie, il suffit au conséquentialiste de montrer que cette action échoue à maximiser le bien ou à minimiser le mal en ce qu’elle nuit aux intérêts vitaux de Julie. Nul besoin pour lui d’ajouter que la propriété morale de l’injustice qu’il attribue à cette action existerait en un sens plus robuste que lorsqu’il dit que le fait que le raisonnement qui a abouti à conclure à l’existence de cette propriété respecte le principe conséquentialiste suffit pour savoir que cette action est injuste.
4. LES CONTRAINTES PERSONNELLE ET INDIVIDUELLE
Si les arguments qui précèdent sont convaincants, le conséquentialisme n’est pas incompatible avec les prémisses métaéthiques du contractualisme. Cela semble faire pencher la balance en faveur de la thèse d’une dépendance partielle ou relative entre réalisme métaéthique et contractualisme moral : en effet, si l’adoption du réalisme métaéthique de Scanlon est une condition nécessaire pour que nous soyons contractualistes plutôt que, par exemple, kantiens ou partisans d’une théorie de l’erreur, elle ne constitue pas une condition suffisante pour que nous soyons contractualistes plutôt que conséquentialistes. Cependant, la thèse de la dépendance absolue entre métaéthique et éthique normative – à savoir l’idée que nos convictions morales de premier ordre seraient toujours entièrement déterminées par nos croyances métaéthiques – ne peut être écartée définitivement que si l’opposition entre contractualisme et conséquentialisme est bien réelle, puisque, dans le cas contraire, il serait possible de soutenir que cette opposition serait atténuée en raison de la compatibilité entre le conséquentialisme et les prémisses métaéthiques du contractualisme.
Certains auteurs estiment pourtant que la justification contractualiste de certains principes moraux présuppose un jugement conséquentialiste. Avant d’essayer de montrer, dans les deux prochaines sections, qu’il n’en est rien, nous devons voir au préalable quel type de considérations autrui peut légitimement invoquer à titre d’objections contestant la validité d’un principe d’action donné. Nous nous concentrerons en particulier sur les contraintes personnelle et individuelle[23] : la première stipule que l’on ne saurait contester la permissibilité morale d’une action (telle que le contractualisme comprend cette notion) sur la base de considérations qui seraient déconnectées des intérêts des personnes humaines, et la seconde exclut de la délibération contractualiste toute objection qui ferait référence aux intérêts des groupes plutôt qu’à des intérêts individuels.
Tout d’abord, puisque c’est la valeur de la personne humaine de chacun qui doit être respectée dans la relation de reconnaissance mutuelle, une objection à un principe moral, pour être pertinente d’un point de vue contractualiste, ne saurait être impersonnelle, c’est-à-dire ne pas prendre pour fondement la manière dont ce principe affecte des intérêts humains. Si inonder le Grand Canyon ou recouvrir le mont Blanc d’ordures ménagères témoignerait certes d’un manque de respect pour la valeur qui est intrinsèque à ces merveilles naturelles, Hadrien ne saurait rejeter un principe autorisant Lucie à s’adonner à ces activités au motif qu’elles représenteraient un manquement à ce que Lucie lui doit : après tout, c’est la valeur de ces paysages somptueux et des espèces qui y vivent qu’elle peine à apprécier en se proposant de les dégrader et de les mettre en danger, non la valeur d’Hadrien en tant que personne. Pour qu’une action soit moralement injuste au sens où l’entend la théorie contractualiste, elle doit consister en un écart par rapport à ce qui est dû à chacun : pour que la dégradation du mont Blanc fasse preuve d’un mépris non seulement envers les chefs-d’oeuvre naturels mais aussi envers la personne d’Hadrien, il faut que l’intérêt que ce dernier prend à ce que le mont Blanc demeure immaculé soit tel que toute dégradation du mont Blanc porterait nécessairement une atteinte injustifiable à l’intérêt susmentionné. En d’autres termes, une action est moralement injuste dans le sens où le contractualisme l’entend si et seulement si autrui peut raisonnablement s’opposer à la manière dont le principe qui autorise cette action nous permettrait de traiter ses propres intérêts. Une objection à la validité contractualiste d’un principe moral ne peut donc être impersonnelle.
Au moment de la rédaction de What We Owe to Each Other, Scanlon estimait que les considérations agrégatives devaient être comprises comme des raisons impersonnelles d’un type particulier[24] : il pensait en effet que, puisque personne ne jouit soi-même de la somme des bénéfices produits par une action qui serait justifiée par un raisonnement agrégatif[25] (qui additionnerait les unes aux autres les réclamations personnelles qui toutes comptent en faveur de l’adoption d’un même principe), la seule manière de faire entrer la considération des nombres dans notre raisonnement moral serait d’attribuer de la valeur à la somme des bénéfices individuels, et donc de considérer qu’un état de choses dans lequel les intérêts du plus grand nombre seraient satisfaits serait meilleur d’un point de vue impersonnel. Puisque ce qui importe est d’interagir avec autrui d’une manière qui soit compatible avec les réclamations raisonnables qu’il peut formuler au nom de ses propres intérêts, un raisonnement agrégatif de ce type est exclu par la procédure contractualiste. En d’autres termes, en plus de ne faire référence qu’aux intérêts de personnes humaines, une objection à la justifiabilité interpersonnelle d’une action doit être individuelle. (Nous verrons dans l’avant-dernière section de ce texte que Scanlon considère aujourd’hui que, si les objections à un principe moral doivent toujours être personnelles et individuelles pour passer le test contractualiste, la prise en compte du nombre de personnes susceptibles d’être affectées par l’une ou l’autre de deux actions considérées a peut-être un autre rôle à jouer dans l’évaluation de la validité du principe qui autorise l’une d’entre elles et prohibe l’autre.)
Scanlon considère que ces deux contraintes – qui ensemble stipulent qu’une objection à un principe moral ne peut être raisonnable que si elle peut être avancée par un individu au nom de ses intérêts personnels – permettent à sa théorie d’offrir une solution de rechange claire à l’utilitarisme et au conséquentialisme en général.[26] Derek Parfit a pourtant suggéré que, étant donné certaines implications contre-intuitives de la contrainte individuelle – sur lesquelles nous reviendrons dans les prochaines sections –, celle-ci devait être abandonnée, ajoutant qu’un tel abandon ne serait pas incompatible avec la thèse centrale du contractualisme, à savoir l’idée que la justice de nos actions dépend de leur justifiabilité auprès de chacune des personnes qu’elles affectent : d’après Parfit, en effet, l’idée de « principes que nul ne pourrait raisonnablement rejeter » n’implique pas que nos raisons de rejeter des principes doivent être individuelles, puisqu’« il ne semble pas déraisonnable de rejeter un principe en faisant référence aux dommages que ce principe imposerait à un groupe de personnes ».[27] En d’autres termes, l’abandon de la contrainte individuelle ne toucherait pas au coeur de la théorie contractualiste, à savoir la connexion entre, d’un côté, le respect de la valeur de la vie humaine et, de l’autre, le fait de modeler notre comportement sur des principes que nul ne pourrait raisonnablement rejeter.
Pour Michael Otsuka, la justification de la contrainte individuelle réside en ce qu’elle nous préserve contre la tyrannie de la majorité qui émergerait si les principes moraux pouvaient être imposés collectivement par la force combinée de la défense par le plus grand nombre de principes contre lesquels pèsent les objections individuellement bien plus fortes d’une petite minorité.[28] Mais si la théorie contractualiste a d’autres ressources pour contrer cette tyrannie de la majorité tout en évitant les implications contre-intuitives de la contrainte individuelle, pourquoi garder cette dernière ?
Cette objection contre la contrainte individuelle se méprend à la fois sur sa justification et sur sa centralité dans la théorie contractualiste. Qu’elle nous préserve contre une telle tyrannie de la majorité – qu’elle interdise, dans le fameux exemple de Scanlon, la poursuite de la diffusion de la finale de la coupe du monde de football parce que l’intérêt que prend chacun des millions de téléspectateurs à la regarder est de peu de force, pris isolément, en comparaison de l’intérêt que prend Jones à ce que cessent les douloureuses électrocutions qu’une poursuite de la diffusion du match impliquerait qu’il continue à subir[29] – compte sans aucun doute en faveur de cette contrainte, mais ce n’est pas, fondamentalement, ce qui la justifie.[30] Selon notre interprétation, la contrainte individuelle découle directement de l’idée de la justifiabilité auprès de chacun. En effet, il nous semble que nous ne saurions nous justifier auprès d’autrui sur la base de considérations auxquelles il ne serait pas raisonnable d’exiger qu’il soit sensible.[31] Or, puisque, comme le note Scanlon, aucun individu ne jouit lui-même de la somme des bénéfices qu’un raisonnement agrégatif nous demanderait de conférer à un groupe au détriment des intérêts d’une personne isolée, la considération agrégative qui nous ferait favoriser les intérêts du groupe ne peut qu’être l’idée qu’il serait meilleur, d’un point de vue impersonnel, de satisfaire les intérêts du plus grand nombre – cela maximiserait le bien ou produirait les meilleures conséquences, telles qu’évaluées d’un point de vue impersonnel. Mais puisque ce type de jugement impersonnel n’a rien d’évident, et qu’il est rejeté par quiconque (ou presque) n’est pas conséquentialiste, exiger de la personne isolée qu’elle accepte comme justifiée notre volonté de satisfaire les intérêts du groupe plutôt que les siens sous couvert que cela maximiserait le bien ne saurait être raisonnable, puisque cela reviendrait à supposer que cette personne doive être conséquentialiste. Étant donné que ce n’est que dès lors que l’on est convaincu par l’objectif conséquentialiste de la promotion des meilleurs états de choses que l’on peut être sensible à une justification de ce type, et que l’idée que nous devrions nous soucier de la qualité impersonnelle des états de choses – plutôt que, par exemple, des objections qu’autrui peut m’adresser en son propre nom – ne va pas de soi,[32] nous ne saurions faire entrer de considérations agrégatives dans nos justifications. (De plus, si la validité du conséquentialisme pouvait être présupposée dans le cadre d’un argument contractualiste – c’est ce qu’impliquerait le fait d’exiger d’autrui qu’il soit mû par des considérations agrégatives –, alors le contractualisme n’offrirait pas de véritable solution de rechange au conséquentialisme.) En conséquence, le respect de la valeur d’autrui exclut que les raisons sur la base desquelles nous devons justifier nos actions soient agrégatives : en d’autres termes, la contrainte individuelle découle des idées de base de la théorie contractualiste.
5. LE DOCTEUR ET SES PATIENTS
Dans cette section et la suivante, nous allons examiner les raisons pour lesquelles la justification contractualiste de certains jugements moraux devrait, comme certains le pensent, présupposer des jugements conséquentialistes. Prenons d’abord le cas d’un docteur qui dispose d’un médicament qui peut servir soit à guérir un individu d’une maladie mortelle s’il l’ingurgite en totalité, soit à guérir cinq autres patients d’un même mal s’il est partagé en cinq parts égales. Ne pouvant sauver tout le monde, le docteur se demande s’il doit sauver le groupe de cinq personnes ou le patient isolé.[33]
Les contractualistes estiment, comme les conséquentialistes, que, dans cette situation, le médecin devrait s’occuper d’autant de patients qu’il lui est possible d’en soigner, c’est-à-dire cinq. Cela rend-il la théorie conséquentialiste ? Nous pensons que non, pour les raisons suivantes. La théorie serait conséquentialiste si le jugement selon lequel le médecin doit sauver le plus grand nombre, soit reposait sur l’idée qu’un état de choses dans lequel le plus grand nombre d’individus survit est meilleur d’un point de vue impersonnel, soit présupposait que la combinaison des raisons individuelles des cinq patients contrebalance (pèse plus dans la balance des raisons que) la raison du patient isolé. Un raisonnement du premier type est exclu par la contrainte personnelle et, si le second n’est certes pas incompatible avec la contrainte individuelle – l’idée étant ici que le poids de la combinaison des raisons individuelles des cinq patients serait plus important que celui de la raison du patient isolé, non que les cinq patients pourraient défendre ce principe au nom des intérêts du groupe qu’ils forment[34] –, une justification contractualiste du devoir qu’aurait le médecin de venir en aide aux cinq patients n’a pas besoin, comme nous le verrons, de présupposer un tel raisonnement.
Commentant cet exemple, Elizabeth Anscombe écrit :
Supposons que je sois le médecin, et que je n’utilise pas du tout le médicament. À qui est-ce que je cause un tort ? Aucun d’eux ne peut me dire : « Tu me le dois. » Car […] si l’un peut le dire, tous le peuvent ; mais si j’ai utilisé le médicament, il y en a au moins un que je laisse repartir les mains vides, et il ne peut pas me dire que je le lui devais. Toutefois, si je ne l’ai donné à personne, tous peuvent me le reprocher. Il était là, prêt à subvenir à un besoin humain, et aucun besoin humain n’a été satisfait. Donc n’importe lequel d’entre eux peut me dire : tu aurais dû l’utiliser afin d’assister ceux qui en avaient besoin ; ils ont donc tous été traités injustement. Mais s’il a été utilisé pour [le patient isolé], dans la quantité dont il avait besoin pour rester en vie, personne n’a de raison valable de m’accuser de lui avoir causé un tort. Pourquoi, simplement parce qu’il est l’un des cinq qui auraient pu être sauvés, est-il traité injustement s’il n’est pas sauvé, si le médicament a été donné à quelqu’un qui en avait besoin ? Quelle est sa réclamation, si ce n’est que ce dont il avait besoin lui revienne plutôt que d’être gaspillé ? Mais le médicament n’a pas été gaspillé. Il n’a donc pas été traité injustement. Qui l’a donc été ? Et si personne n’a été traité injustement, quel préjudice ai-je commis ?[35]
D’après Anscombe, le fait que chacun des six patients ait besoin du médicament (ou d’une partie de celui-ci) pour rester en vie suffit pour établir que personne ne serait raisonnable d’exiger que le médicament lui revienne à lui plutôt qu’aux autres. De plus, étant donné que le docteur est en mesure de répondre aux besoins vitaux d’au moins l’un de ses patients, il serait injustifiable de sa part de gaspiller le médicament, étant donné l’importance que la morale attache à la satisfaction des intérêts humains, surtout lorsqu’ils sont si urgents. Chacun peut donc (i) exiger que le médicament lui revienne plutôt que d’être gaspillé, (ii) sans toutefois avoir un droit spécial de le consommer lui plutôt que les autres. Pour Anscombe, cela implique (iii) que le devoir du médecin serait simplement de ne pas gaspiller le médicament : il est donc libre de choisir à quel groupe de patients le distribuer, par exemple en tirant au sort[36] – en termes contractualistes, quelle que soit sa décision, tant qu’il utilise le médicament pour soigner quelqu’un, personne ne peut raisonnablement s’y opposer, et aucun des patients n’est donc victime d’une injustice.
Ce que le contractualisme conteste dans ce raisonnement est l’idée que, bien que personne ne puisse effectivement raisonnablement réclamer le médicament pour soi plutôt que pour les autres, la seule réclamation qu’il serait raisonnable de la part de chacun des six patients de formuler envers le docteur serait qu’il ne gaspille pas ce médicament : le contractualisme ne rejette ni (i) ni (ii), mais l’idée que (i) et (ii) impliqueraient (iii). Le passage de (i) et (ii) à (iii) suppose (ii)’, soit qu’il n’y aurait qu’une seule manière pour le docteur de causer un tort à un patient qui aurait besoin du médicament pour survivre, à savoir gaspiller ce médicament. Si (i) et (ii) suffisent pour établir (ii)’, alors ils impliquent aussi (iii). Mais le contractualisme conteste la validité de (ii)’, à savoir que tout ce que chacun des six individus peut raisonnablement exiger ne saurait excéder la demande que le médicament ne soit pas gaspillé – qu’il lui revienne plutôt que d’être gaspillé (et non plutôt que d’être consommé par autrui). Que personne ne puisse réclamer le médicament pour soi plutôt que pour les autres ne suffit pas pour établir (ii)’. L’individu isolé, en effet, ne serait pas raisonnable, ou bien d’insister pour que le docteur le sauve lui plutôt que les autres, ou bien de dire que le docteur ne devrait pas plus aux cinq de les sauver eux plutôt que lui : dans le deuxième cas, cela reviendrait à dire que le docteur aurait le droit d’agir comme si quatre des patients du groupe de cinq n’avaient pas besoin du médicament.
Le principe qu’Anscombe tient pour valide – le médecin a le devoir de sauver l’un ou l’autre groupe indifféremment – est correct dans un cas opposant la réclamation d’un individu à la réclamation égale d’une autre personne. Si une personne, A, nécessite mes soins pour survivre, alors il ne m’est pas permis de les lui refuser, en l’absence d’une justification suffisante. Le fait qu’une autre personne, B, ait également besoin de mon assistance, et que je ne puisse sauver les deux, constitue (dans la plupart des cas) une justification suffisante pour ne pas sauver A, dans le sens où je ne dois pas plus à A de le sauver qu’à B (et réciproquement). En d’autres termes, les réclamations de chacun, étant égales, se neutralisent l’une l’autre : à partir du moment où B entre en scène, le principe sur lequel A peut raisonnablement insister n’est donc plus que je devrais lui venir en aide, simpliciter, mais que je dois lui venir en aide plutôt que de n’aider personne. C’est aussi ce que je dois à B. Dans l’exemple discuté par Anscombe, cependant, C, D, E et F peuvent être secourus en même temps que B. La raison pour laquelle je dois leur venir en aide à eux plutôt qu’à A est que, si je décidais d’aider A, je ne tiendrais tout simplement pas compte de ce que ces autres individus ont tout autant besoin de mon aide que A et B : cela reviendrait à faire fi des raisons qu’ils ont de m’appeler à l’aide. S’il n’y avait que C aux côtés de B, mon devoir envers C (et B) serait de rejeter, au profit des intérêts de C et de B, le principe selon lequel mon seul devoir serait de sauver l’un ou l’autre groupe de manière indifférente. Le principe sur lequel C peut raisonnablement insister est plus exigeant que le principe qui interdit simplement mon refus de venir en aide à quiconque, puisque ce principe n’est valide qu’en présence de réclamations contradictoires se neutralisant l’une l’autre. En d’autres termes, la réclamation de C, étant équivalente à celles de A et de B, et pouvant être satisfaite en même temps que celle de B, brise le lien d’indifférence ou de symétrie qui stipulait que, ne devant pas plus à A qu’à B de le sauver lui plutôt que l’autre, mon devoir était simplement d’aider l’un ou l’autre indifféremment : la question de savoir à qui je dois venir en aide est tranchée par la réclamation de C, car celle-ci, contrairement à celles de A et de B qui se neutralisent mutuellement, n’est défaite par aucune autre réclamation opposée. Pour le dire autrement : en l’absence de justification suffisante, C doit être soigné, et ce que je dois à A (à savoir : « soigner soit A soit B ») ne peut pas être regardé comme une justification suffisante pour ne pas honorer la réclamation de C, puisque celle-ci peut être satisfaite en même temps que celle de B, et donc sans que cela viole ce qui est dû à A. De plus, la raison pour laquelle je dois secourir D, E et F en plus de B et de C est tout simplement que leurs réclamations à eux ne sont pas contradictoires avec celles de B et de C.[37]
Dire que (ii)’ est réfutable implique aussi que, si le médecin venait en aide au patient qui a besoin de l’intégralité du médicament pour survivre, il traiterait alors injustement chacun de ses six patients – et non aucun d’entre eux, comme le soutient Anscombe. Il est pour sûr peu probable que le patient qui aurait ainsi été secouru proteste : la validité de tel ou tel principe ne dépend toutefois pas de la probabilité que les personnes qu’ils affectent s’y opposent effectivement, mais plutôt du fait qu’il ne serait pas déraisonnable pour eux d’avancer une objection décisive à l’encontre de ce principe. Comme l’écrit Rahul Kumar, ce qui doit importer aux yeux de A n’est pas simplement d’être sauvé, puisqu’il n’y a pas que les conséquences (ici, sa survie) qui importent aux yeux des contractualistes : il importe aussi que « le fait qu’il soit sauvé soit compatible avec la reconnaissance, dans la décision de savoir qui doit être sauvé, de l’intérêt légitime que tous ceux dont la vie est en jeu dans cette situation prennent à être sauvés ».[38] Si une telle reconnaissance est incompatible avec la décision de sauver A plutôt que les cinq autres, alors A n’a pas été sauvé par respect pour sa valeur en tant que personne humaine : s’il reconnaît qu’il a de bonnes raisons d’entretenir avec les autres patients une relation de reconnaissance mutuelle, alors il peut nourrir un ressentiment légitime à l’égard du médecin au motif que, ayant été sauvé au détriment des réclamations légitimes de ces derniers, il doit la vie à une injustice – c’est-à-dire à une action qui transgresse les valeurs auxquelles il croit et qui, de surcroît, n’exprime aucun respect pour sa valeur en tant que personne humaine.[39]
6. LES DEUX GROUPES DE VACANCIERS
Si l’argument avancé dans la section précédente est valide, alors l’idée que le contractualisme devrait présupposer un raisonnement conséquentialiste afin de défendre le principe selon lequel le médecin devrait sauver autant de patients qu’il lui est possible d’en secourir est fausse. Comme le dit Anscombe, si personne n’a été traité injustement, alors l’action n’est pas injuste : ce qui compte, c’est que personne ne puisse raisonnablement s’opposer, au nom de ses intérêts personnels et individuels, au principe considéré. La distinction entre contractualisme et conséquentialisme tient donc toujours, et avec elle l’idée que le réalisme métaéthique et le contractualisme moral entretiendraient une relation de dépendance partielle.[40]
Cependant, comme l’a observé Véronique Munoz-Dardé, nous pouvons douter qu’il soit possible de défendre en ces mêmes termes le principe exigeant que l’on sauve le plus grand de deux groupes de personnes faisant toutes face à un péril équivalent lorsque ces deux groupes contiennent chacun au moins deux individus.[41] Pour qu’un argument du type de celui qui a été avancé précédemment puisse fonctionner ici, il faudrait en effet agréger au préalable les réclamations qui sont internes à chaque groupe afin de pouvoir établir que nous ne devrions pas plus à l’un qu’à l’autre groupe de lui venir en aide à lui plutôt qu’à l’autre, et ainsi de montrer que la réclamation que pourrait avancer la personne additionnelle du groupe le plus nombreux – la première personne dont la réclamation ne serait pas neutralisée par la réclamation symétrique d’un membre de l’autre groupe – « briserait le lien » qui nous lie également à ces deux groupes.
Supposons que deux groupes de vacanciers contenant cinq personnes pour l’un, vingt pour l’autre, se trouvent respectivement sur deux îlots qui sont sur le point d’être submergés par la marée montante : l’idée que, dans le cas où nous ne pourrions les secourir tous, nous devrions sauver le groupe le plus nombreux parce que la sixième personne de ce groupe pourrait nous adresser une réclamation qui ne serait neutralisée par aucune des réclamations des cinq personnes du premier groupe, ayant elles-mêmes toutes été neutralisées par les réclamations des cinq premières personnes du groupe le plus nombreux, devrait nécessairement présupposer l’agrégation des cinq premières raisons issues de chaque groupe, puisque sans cela la réclamation de la sixième personne du second groupe ne saurait aboutir au rejet du principe selon lequel nous devrions sauver l’un ou l’autre groupe indifféremment.[42] Le contractualiste peut alors soit renoncer à la contrainte individuelle afin de justifier le principe selon lequel nous devrions sauver le plus grand nombre (SGN) – au prix de renoncer à l’un de ses éléments les plus distinctifs –, soit réfuter SGN.[43]
Pour contrer cette objection, nous proposons de reconstruire autrement l’échange des raisons qui a cours entre les vacanciers et les secours. Plutôt que de considérer que la question de savoir à qui venir en aide serait tranchée par un seul principe, envisageons la situation comme impliquant une pluralité de principes : cette perspective nous permettra de dissiper l’idée qu’il serait évident que les cinq premières réclamations de chaque groupe doivent être agrégées afin que la réclamation de la sixième personne du second groupe puisse nous délier de notre devoir de sauver indifféremment l’un ou l’autre groupe. Exposant l’idée d’un holisme sur la justification morale, Scanlon écrit :
Supposons, par exemple, que nous considérions un principe définissant nos obligations d’aider ceux qui sont dans le besoin. Il semblerait qu’il s’agisse d’une situation dans laquelle des considérations de bien-être sont, de manière plus que probable, prédominantes. Mais afin d’être en position d’aider quelqu’un, un agent doit avoir le droit de disposer des ressources nécessaires, et doit être libre de toute obligation qui lui interdirait d’agir comme donner de l’aide le requiert. […] Pour comprendre la portée du principe proposé (l’éventail des actions qu’il peut exiger), nous devons donc présupposer un système de droits. Ce que cela illustre est le fait qu’un contractualisme raisonnable, comme la plupart des autres doctrines, inclura un holisme sur la justification morale : lorsque nous évaluons un principe, nous devons en tenir d’autres pour préétablis (fixed). Cela ne veut pas dire que ces autres principes sont au-delà de toute question, mais simplement qu’ils ne sont pas remis en question à cet instant.[44]
Supposons que, dans le cas de nos vacanciers, l’un de ces principes nous recommande de répondre à la première réclamation émanant de l’un ou l’autre groupe indifféremment. Une fois ce principe relégué à l’arrière-plan de notre délibération (nous devons aider soit A, soit B), nous pouvons nous demander ce qu’impliquerait la réclamation de la deuxième personne du premier groupe (C) : en l’absence d’une justification suffisante, nous devons secourir C. Le principe qui nous recommande d’aider ou bien A ou bien B n’est pas une justification suffisante pour ne pas aider C, puisque secourir C ainsi que l’autre personne qui se trouve sur son îlot (A) ne revient pas à transgresser le principe que nous avions relégué à l’arrière-plan : en sauvant C et A, nous sauvons bien l’un ou l’autre de A et de B. Cependant, la réclamation de la deuxième personne du second groupe (D) neutralise la réclamation de C et constitue une justification suffisante s’opposant à ce que l’on doive sauver C et A simpliciter : nous avons donc maintenant deux principes, que nous pouvons reléguer tous deux à l’arrière-plan de notre délibération, l’un recommandant que l’on vienne en aide soit à A, soit à B, l’autre soit à C, soit à D. Nous pouvons alors nous tourner vers la réclamation de la troisième personne du premier groupe… et ainsi de suite jusqu’à la réclamation de la sixième personne du second groupe. Lorsque nous considérons cette réclamation, cinq principes – que l’on ne remet pas en question à cet instant – nous recommandent la même chose : venir en aide à l’un ou l’autre de deux vacanciers dont les réclamations identiques et conflictuelles se neutralisent. Puisque les personnes auxquelles il s’agit de venir en aide chaque fois sont réparties en deux groupes, et que venir en aide à A est compatible avec venir en aide à C, E, G et I, notre devoir moral, tel que défini par ces principes, est de venir en aide à l’un ou l’autre groupe de cinq personnes. La réclamation de la sixième personne du second groupe (K) devant être satisfaite en l’absence d’une justification suffisante, et le fait que nous devions venir en aide à l’un ou l’autre groupe indifféremment – comme l’établit le croisement des cinq principes que nous tenons pour préétablis au moment où nous considérons la réclamation de K – n’étant pas une raison suffisante pour ne pas secourir K, notre devoir est de venir en aide à K ainsi qu’aux dix-neuf autres vacanciers qui se trouvent sur le même îlot – comme le justifie le raisonnement exposé dans la section précédente.
Cette manière d’aborder la question dissipe l’idée qu’il serait nécessaire, pour défendre SGN dans un cas comme celui-ci, d’agréger les réclamations internes à chaque groupe pour que la réclamation de la personne additionnelle puisse faire pencher la balance en faveur du groupe le plus nombreux. Cette idée semble bien naturelle si l’on suppose que notre délibération a pour objet la validité d’un seul principe : ce principe porte sur une pluralité de réclamations identiques, il suffit donc de les additionner jusqu’à ce que la balance des raisons soit en équilibre, puis bascule en faveur de SGN grâce à la raison de la personne additionnelle. En dissipant cette évidence, notre reconstruction du tie-breaking argument a le mérite d’envisager le cas de A par rapport à B et C de la même manière que le cas de 5 par rapport à 20 : la raison pour laquelle nous avons tendance à penser que la défense de SGN ne présupposerait de jugement conséquentialiste que dans le second cas vient de ce que l’on se demande, dans le cas de A par rapport à B et C, « est-ce que je dois à C de le sauver ? », alors que notre question serait, dans le cas de 5 par rapport à 20, « est-ce que je dois à ces vingt personnes de les sauver ? », cette question invitant intuitivement une réponse positive fondée sur un calcul agrégatif. Il nous semble que notre stratégie évite cette différence de traitement : une fois que l’on sait ce que l’on doit à A et à B (sauver l’un ou l’autre), à C et à D (idem), …, ce que l’on doit à K tranche en faveur de SGN.[45]
Scanlon n’a pas abandonné la contrainte individuelle. Il maintient toujours qu’une objection à un principe moral doit être individuelle. Ce qu’il autorise aujourd’hui, c’est simplement que les nombres aient un rôle à jouer dans la détermination du caractère plus ou moins raisonnable de l’objection que les individus peuvent avancer en leur propre nom contre des principes moraux.[46] À propos du cas de nos vacanciers, il écrit :
On pourrait dire que, alors qu’il serait raisonnable pour une personne du plus grand groupe de rejeter un principe permettant que l’on sauve le plus petit nombre, il ne serait pas raisonnable pour une personne du plus petit groupe de rejeter un principe exigeant que l’on sauve le plus grand nombre. Ce n’est pas parce qu’un individu dans le plus grand groupe aurait une raison plus forte d’être sauvé que la raison correspondante de quelqu’un appartenant au plus petit groupe, mais parce qu’il est déraisonnable d’insister dessus [déraisonnable de la part du membre du plus petit groupe d’insister pour être sauvé] étant donné qu’il y a tant d’individus qui ont des objections contre [cette insistance].[47]
Ce passage est compatible avec la stratégie que nous avons adoptée : SGN n’est pas justifié par l’idée qu’il serait mieux, d’un point de vue impersonnel, que plus de vies soient épargnées, mais par le fait que les membres du plus petit groupe ne seraient pas raisonnables d’insister sur un principe qui les favoriserait au détriment des membres du plus grand groupe,[48] et donc au mépris du fait qu’il n’existe pas de justification suffisante pour rejeter la réclamation (non neutralisée) de K. Si SGN est justifiable, c’est parce que les membres du plus petit groupe ne seraient pas raisonnables de s’y opposer étant donné que nous devons répondre à la réclamation légitime de K.[49]
7. CONCLUSION
Deux leçons peuvent être tirées des arguments précédents. La première porte sur l’articulation entre le réalisme métaéthique et la théorie morale contractualiste de Scanlon. La seconde, plus générale, concerne la nature de la relation entre métaéthique et éthique normative.
Dans les limites d’une présentation schématique qu’il nous est impossible de raffiner davantage ici, la relation entre métaéthique et éthique normative peut être conçue de trois manières différentes. À l’une des deux extrémités du spectre, nous pouvons envisager que la relation entre métaéthique et éthique normative soit une relation de dépendance absolue, au sens où nos convictions métaéthiques constitueraient des conditions à la fois nécessaires et suffisantes à l’adoption de telle ou telle doctrine d’éthique normative. Songeons par exemple à un partisan de la théorie de l’erreur de J. L. Mackie,[50] qui serait bien forcé d’admettre que tout jugement relatif à la permissibilité ou à l’impermissibilité morale de nos actions ne peut qu’être faux, réfutant ainsi aussi bien les jugements moraux qui épousent nos inclinations conséquentialistes que ceux qui s’accordent avec nos sentiments déontologiques.
À l’autre extrémité du spectre se trouve l’idée que la métaéthique et l’éthique normative seraient entièrement indépendantes l’une de l’autre, et donc que nos croyances métaéthiques n’auraient aucune incidence sur nos jugements moraux de premier ordre. Étant donné l’incompatibilité entre le non-cognitivisme d’un côté (qu’il prenne la forme d’une théorie de l’erreur ou du fictionnalisme)[51] et le contractualisme ou le conséquentialisme de l’autre, cette idée ne semble pas défendable. Un fictionnaliste estimant par exemple qu’une théorie morale conséquentialiste est fausse, mais qu’elle doit être préservée à titre d’utile fiction, n’est pas lui-même conséquentialiste, puisqu’un conséquentialiste croit fermement que les deux notions fondamentales de l’éthique, à savoir le bien (the good) et le juste (the right), existent et que certains des jugements que nous formons lorsque nous attribuons à telle ou telle action la propriété d’être juste en tant qu’elle maximise le bien ou produit les conséquences qui, d’un point de vue impersonnel, sont les meilleures, sont vrais.
À mi-chemin entre ces deux extrémités, nous pourrions encore soutenir que la métaéthique et l’éthique normative entretiennent une relation de dépendance partielle ou relative. Cela signifierait que nos convictions métaéthiques seraient des conditions nécessaires mais non suffisantes pour déterminer à la fois le contenu et le type de justification des thèses d’éthique normative que nous voulons défendre. (Par exemple, beaucoup ont douté de ce que la « théorie triple » de Derek Parfit,[52] qui établit une convergence entre kantisme, conséquentialisme de la règle et contractualisme, ferait converger ces deux dernières théories avec une doctrine véritablement kantienne : si l’on renonce au constructivisme métaéthique sur les raisons, en quoi est-on encore kantien ?) Si c’est là la nature de la relation entre métaéthique et éthique normative, il faut en conclure que les dilemmes moraux de premier ordre auxquels nous nous heurtons (par exemple sur l’agrégation, la permissibilité morale de l’avortement, le dilemme du tramway ou encore le paradoxe de la déontologie) ne sauraient être dénoués une fois pour toutes par le métaéthicien.
La première leçon que nous tirons des analyses qui précèdent est que si, comme nous avons essayé de le montrer, le conséquentialisme est compatible avec les prémisses métaéthiques du contractualisme moral sans que cela n’atténue l’opposition entre ces deux doctrines d’éthique normative, l’idée que le tie-breaking argument incorporerait un jugement conséquentialiste ou agrégatif étant fausse, alors la relation entre réalisme métaéthique et contractualisme moral est une relation de dépendance relative. S’il était impossible d’aboutir au conséquentialisme à partir du réalisme sur les raisons défendu par Scanlon, il ne serait pas absurde de supposer que l’opposition entre contractualisme et conséquentialisme prend sa source dans la métaéthique. Mais si nous avons raison de croire que le conséquentialisme est compatible avec le réalisme métaéthique scanlonien, alors la thèse d’une relation de dépendance absolue entre réalisme métaéthique et contractualisme moral est exclue, le réalisme métaéthique étant tout au plus une condition nécessaire, mais non suffisante, pour que nous soyons contractualistes. Les débats qui opposent contractualistes et conséquentialistes ne sont donc pas entièrement du ressort du métaéthicien : embrasser le réalisme métaéthique exclut sans doute le kantisme ou la théorie de l’erreur, mais cela ne saurait suffire pour dénouer l’opposition entre contractualisme et conséquentialisme. Il serait donc faux de considérer que l’affrontement, central dans le champ de l’éthique normative, entre déontologie et conséquentialisme, se jouerait entièrement dans la métaéthique.
Cette première leçon a des implications plus générales sur la nature de la relation entre métaéthique et éthique normative. En effet, si la thèse d’une dépendance relative entre réalisme métaéthique et contractualisme moral ne vaut certes pas pour la relation entre métaéthique et éthique normative en général[53] – aucun argument dans ce qui précède ne visait à établir que nos croyances morales de premier ordre seraient toujours déterminées de manière nécessaire mais non suffisante par nos convictions métaéthiques, comme si ces dernières étaient toujours à la fois incompatibles avec un certain nombre de croyances morales et compatibles avec plusieurs autres –, elle réfute toutefois l’idée, à titre de contre-exemple, que le contenu de nos jugements moraux de premier ordre serait toujours entièrement déterminé par nos croyances métaéthiques. Il se peut que certaines croyances métaéthiques déterminent, à titre de conditions à la fois nécessaires et suffisantes, nos convictions morales – nous l’avons dit, un partisan de la théorie de l’erreur croit que tout jugement moral est faux –, mais il ne peut s’agir ici d’une généralité. On ne saurait donc prétendre résoudre l’ensemble des débats qui animent le champ de l’éthique normative dans la métaéthique : certains d’entre eux échappent, dans une certaine mesure du moins, au métaéthicien.
Appendices
Notes
-
[1]
Scanlon, T. M., « Contractualisme et utilitarisme », traduit par Jean-Fabien Spitz, dans T. M. Scanlon, L’Épreuve de la tolérance. Essais de philosophie politique, Paris, Hermann Éditeurs, 2018, p. 167.
-
[2]
Foot, Philippa, « Utilitarianism and the virtues », Mind, vol. 94, 1985, p. 196. (Toute traduction d’un extrait dont les références sont données en anglais est personnelle.)
-
[3]
Korsgaard, Christine, « The reasons we can share: An attack on the distinction between agent-relative and agent-neutral values », Social Philosophy and Policy, vol. 10, n°1, 1993, p. 24-25.
-
[4]
Comme l’écrit Rawls : « Il faudrait noter que les théories déontologiques sont définies comme étant des théories non téléologiques, et non pas comme des doctrines qui caractériseraient ce qui est juste dans les institutions et les actes indépendamment des conséquences. Toute doctrine éthique digne de considération tient compte des conséquences dans son évaluation de ce qui est juste. Celle qui ne le ferait pas serait tout simplement absurde, irrationnelle. » Rawls, John, Théorie de la justice, Paris, Éditions Points, 2009, traduit par Catherine Audard, p. 55-56. Lorsqu’il écrit que les doctrines déontologiques ne sont pas téléologiques, Rawls entend par là qu’elles ne définissent pas le juste comme la maximisation du bien (cf. ibid., p. 50).
-
[5]
Voir, en particulier, Scanlon, T. M., « Metaphysics and morals », Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, vol. 77, n° 2, 2003, p. 7-22, Scanlon, T. M., Being Realistic About Reasons, Oxford, Oxford University Press, 2014, et Scanlon, T. M., « Normative realism and ontology: reply to Clarke-Doane, Rosen, and Enoch and McPherson », vol. 46, n° 6, 2017, p. 877-897.
-
[6]
La traduction des termes « right », « wrong », « rightness » et « wrongness » est délicate. Puisque, pour savoir si une action est « right » dans le sens où elle n’outrepasse pas les limites raisonnables de ce que nous pouvons exiger les uns des autres, le contractualisme recommande de s’intéresser à sa justifiabilité interpersonnelle, on ne peut traduire « right » par « justifiable » ou « wrong » par « injustifiable », sans quoi la théorie deviendrait tautologique ou circulaire. Par ailleurs, puisque, pour la théorie contractualiste, ce qui explique qu’une action soit moralement « wrong » n’est pas le fait qu’elle ne produise pas les meilleures conséquences ou qu’elle ne maximise pas le bien, contrairement à ce que soutiennent les conséquentialistes, on ne saurait traduire « right » par « bon » ou « bien », ni « wrong » par « mauvais » (bad) ou « mal » (evil) – dans ce dernier cas, nous ferions de surcroît dépendre la « rightness » et la « wrongness » d’une action du caractère plus ou moins vertueux de l’intention de l’agent qui l’accomplit, alors que pour Scanlon la qualité de l’intention des agents n’entre pas en jeu dans l’évaluation de la permissibilité morale de leurs actions. En outre, traduire « rightness » par « rectitude morale » nous éloigne de la question, centrale dans le contractualisme, du rapport à autrui, et donne l’impression que tout ne serait qu’affaire de respect de règles. Traduire l’expression « the morality of right and wrong » par « la moralité du juste et de l’injuste » peut induire certains lecteurs en erreur, en les conduisant à croire à tort que le contractualisme serait ni plus ni moins une théorie de la justice distributive ou de la justice des institutions sociales ; malgré cette réserve, c’est la traduction qui nous semble la plus adéquate : un manquement à ce que je dois à autrui est une injustice, que ce devoir porte sur la répartition des richesses communes ou non. (Notons que Tim Scanlon s’est montré favorable à cette traduction lors de la journée d’étude organisée en novembre 2017 à l’EHESS sur le manuscrit de son livre Why Does Inequality Matter?, Oxford, Oxford University Press, 2018.) Traduire « a wrong » par « un tort » et « rightness » par « permissibilité morale » convient également.
-
[7]
Scanlon, T. M., What We Owe to Each Other, Cambridge, Harvard University Press, 1998, p. 151.
-
[8]
Par exemple, Scheffler, Samuel, « Introduction », dans Samuel Scheffler (dir.), Consequentialism and its Critics, Oxford, Oxford University Press, 1988, p. 1-13.
-
[9]
Voir sur ce point Scheffler, Samuel, The Rejection of Consequentialism. A Philosophical Investigation of the Considerations Underlying Rival Moral Conceptions, Oxford, Oxford University Press, 1993 (édition révisée), ch. 4.
-
[10]
Scanlon, T. M., Being Realistic About Reasons, op. cit., p. 1, et Scanlon, T. M., “Wrongness and Reasons: A Re-Examination”, Oxford Studies in Metaethics, vol. 2, p. 5.
-
[11]
Scanlon, T. M., Being Realistic About Reasons, op. cit., p. 19.
-
[12]
Scanlon, T. M., « Normative realism and ontology: Reply to Clarke-Doane, Rosen, and Enoch and McPherson », art. cit., p. 883-884.
-
[13]
Ibid., p. 877.
-
[14]
Ibid., p. 886.
-
[15]
Nous résumons ici à grands traits l’une des thèses principales du premier chapitre de T. M. Scanlon, What We Owe to Each Other, op. cit., p. 17-77.
-
[16]
Scanlon, T. M., « Metaphysics and morals », art. cit., p 15.
-
[17]
Williams, Bernard, « Internal and external reasons », dans Russ Shafer-Landau et Terence Cuneo, Foundations of Ethics: An Anthology, Oxford, Blackwell Publishing, 2007, p. 292-298.
-
[18]
Scanlon, T. M., Being Realistic About Reasons, op. cit., p. 13.
-
[19]
Voir les remarques avancées par Scanlon dans le cadre d’une autre discussion, dans T. M. Scanlon, What We Owe to Each Other, op. cit., p. 288.
-
[20]
Williams, Bernard, « A critique of utilitarianism », dans J. J. C. Smart et Bernard Williams, Utilitarianism. For and Against, Cambride, Cambridge University Press, 1973, p. 108-117.
-
[21]
Scanlon, T. M., What We Owe to Each Other, op. cit., p. 171-177.
-
[22]
Ibid., p. 103-107.
-
[23]
Ibid., p. 189-247.
-
[24]
Scanlon, T. M., “Contractualism and justification”, version manuscrite d’un texte à paraître dans un ouvrage collectif qui sera publié chez De Gruyter par la Lauener Library of Analytical Philosophy, p. 29.
-
[25]
Scanlon, What We Owe to Each Other, op. cit., p. 230.
-
[26]
Kumar, Rahul, « Contractualism on the shoal of aggregation », dans R. Jay Wallace, Rahul Kumar et Samuel Freeman (dir.), Reasons and Recognition. Essays on the Philosophy of T. M. Scanlon, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 129.
-
[27]
Parfit, Derek, « Justifiability to each person », dans Philip Stratton-Lake, On What We Owe to Each Other, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, p. 72-73.
-
[28]
Otsuka, Michael, « Saving lives, moral theory, and the claims of individuals », Philosophy & Public Affairs, vol. 34, 2006, p. 130.
-
[29]
Scanlon, T. M., What We Owe to Each Other, op. cit., p. 235.
-
[30]
Comme l’a défendu Kumar dans « Contractualism on the shoal of aggregation », art. cit., p. 131-138. Notre argument pour défendre la centralité de la contrainte individuelle dans la théorie contractualiste est différent, mais complémentaire par rapport à celui de Kumar, qu’il nous est impossible de présenter ici. Notons toutefois que, contrairement à ce que soutiennent Kumar et Parfit, nous pensons que la contrainte individuelle découle directement de l’idée de la justifiabilité à autrui.
-
[31]
Cette remarque ne doit pas être confondue avec une réfutation de l’existence des raisons externes. L’idée n’est pas qu’une raison ou une considération à laquelle il est impossible qu’autrui attache de l’importance en raisonnant correctement sur la base de dispositions motivationnelles préexistantes ne saurait lui offrir de justification valide. Il s’agit plutôt de dire que le fait que l’importance ou la pertinence de certaines considérations (par exemple la valeur impersonnelle d’un état de choses) soit en débat et ne fasse pas l’unanimité implique que l’on ne saurait présupposer que de telles considérations ont de la valeur dans les justifications que nous offrons à autrui, puisqu’il se peut très bien que ce dernier n’y soit pas lui-même sensible, et ce, pour de bonnes raisons.
-
[32]
Comme l’a magistralement montré Foot dans « Utilitarianism and the virtues », art. cit.
-
[33]
Foot, Philippa, « The problem of abortion and the doctrine of the double effect », dans Philippa Foot, Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 24. Cet exemple est discuté en détail dans Taurek, John M., « Should the numbers count? », Philosophy & Public Affairs, vol. 6, n° 4, 1977, p. 293-316.
-
[34]
C’est ainsi qu’Otsuka comprend le raisonnement contractualiste. Voir Otsuka, Michael, « Scanlon and the claims of the many versus the one », Analysis, vol. 60, n° 3, 2000, p. 288-293, et l’éclairante réponse de Kumar dans Kumar, Rahul, « Contractualism on saving the many », Analysis, vol. 61, n° 2, 2001, p. 165-170.
-
[35]
Anscombe, Elizabeth M., « Who is wronged? Philippa Foot on double effect: One point », The Oxford Review, n° 5, 1967, p. 16-17.
-
[36]
C’est la conclusion défendue (par une autre voie) par Taurek dans « Should the numbers count? », art. cit.
-
[37]
Nous avons ici résumé le tie-breaking argument que Scanlon expose dans What We Owe to Each Other, op. cit., p. 229-241.
-
[38]
Kumar, « Contractualism on the shoal of aggregation », art. cit., p. 146-147.
-
[39]
En effet, s’il s’était trouvé dans la position de B, il n’aurait pas été soigné par ce médecin, au mépris de sa valeur de personne humaine.
-
[40]
D’après Jeffrey Brand-Ballard et Robert Shaver, le tie-breaking argument a cependant pour effet que le contractualisme est incapable de justifier nos convictions déontologiques dans une situation dans laquelle nous avons le choix entre (a) tuer un innocent et ainsi empêcher que cinq autres innocents ne soient assassinés par d’autres agents, et (b) nous abstenir de tuer un innocent et laisser cinq meurtres se produire. Si cette thèse était valide, elle remettrait en cause l’idée d’une opposition nette entre contractualisme et conséquentialisme, et avec elle la thèse d’une dépendance relative entre réalisme métaéthique et contractualisme moral. Voir Jeffrey Brand-Ballard, « Contractualism and deontic restrictions », Ethics, vol. 114, n° 2, 2004, p. 269-300, et Robert Shaver, « Contractualism and restrictions », Philosophical Studies, vol. 132, n° 2, 2007, p. 293-299. Nous répondons à ces deux textes dans « Contractualism and the paradox of deontology », Philosophical Studies, 2020, https://doi.org/10.1007/s11098-019-01406-w.
-
[41]
Munoz-Dardé, Véronique, « The distribution of numbers and the comprehensiveness of reasons », Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 105, n° 1, 2005, p. 191-217. Notons toutefois que l’une des raisons pour lesquelles Munoz-Dardé a formulé ce doute semble être qu’elle tient le raisonnement d’Anscombe qui a été reconstruit et partiellement rejeté dans la section précédente pour valide : si ce raisonnement était valide – et si aucun des six patients ne devait être injustement traité par le docteur si celui-ci soignait l’un des deux groupes, quel qu’il soit, plutôt que de gaspiller le médicament –, il serait alors nécessaire de recourir à un jugement conséquentialiste ou à une considération agrégative pour justifier le devoir du médecin de sauver le plus grand nombre.
-
[42]
Cette reconstruction du problème, auquel il est lui-même sensible, a été validée par Tim Scanlon dans un courriel du 16 mai 2018 : nous l’en remercions.
-
[43]
Scanlon, “Contractualism and justification”, art. cit., p. 20.
-
[44]
Scanlon, What We Owe to Each Other, op. cit., p. 214.
-
[45]
Rahul Kumar nous a fait remarquer, dans un courriel du 11 mai 2018, que l’idée du holisme s’appliquait normalement à des principes portant sur des droits de nature différente : si l’on suppose que chacun a un droit inaliénable à ses propres organes, il ne m’est pas permis de dépouiller autrui de ses organes afin de les redistribuer aux autres. Comme il en a convenu, rien dans la théorie de Scanlon ne s’oppose toutefois à ce que cette idée soit élargie pour s’appliquer à des principes qui porteraient tous sur une même réclamation (une demande d’assistance). Nous sommes redevables à Kumar pour ses commentaires, qui nous ont permis de clarifier notre argument.
-
[46]
Scanlon, « Contractualism and justification », art. cit., p. 22.
-
[47]
Ibid.
-
[48]
Ibid., p. 23-24.
-
[49]
Nous pensons donc que la position défendue par Scanlon dans « Contractualism and justification » clarifie, plutôt qu’elle ne révise, le tie-breaking argument exposé dans What We Owe to Each Other : cet argument a toujours reposé sur l’idée que, pour reprendre l’exemple de Foot, le patient isolé, A, ne serait pas raisonnable de rejeter un principe exigeant du médecin qu’il sauve les cinq autres patients étant donné que, alors que ces derniers doivent être sauvés à moins que le docteur ne dispose d’une justification suffisante pour ne pas le faire, ce que le docteur doit à A (à savoir sauver soit A, soit B) ne saurait constituer une justification suffisante pour ne pas les sauver, puisque les soigner eux plutôt que A est tout à fait compatible avec le respect de ce qui est dû à ce dernier. En d’autres termes, le tie-breaking argument explicite le rôle que doivent jouer les nombres dans la détermination du caractère plus ou moins raisonnable des objections individuelles et personnelles qui peuvent être avancées contre des principes d’action concurrents.
-
[50]
Mackie, J. L., Ethics. Inventing Right and Wrong, Londres, Penguin Books, 1990.
-
[51]
Songeons par exemple aux analyses exposées dans Richard Joyce, The Myth of Morality, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
-
[52]
Parfit, Derek, On What Matters, vol. 1 et 2, Oxford, Oxford University Press, 2011.
-
[53]
Nous sommes redevables à un rapporteur anonyme pour Les Ateliers de l’éthique/The Ethics Forum de nous avoir invités à clarifier la portée de nos conclusions.