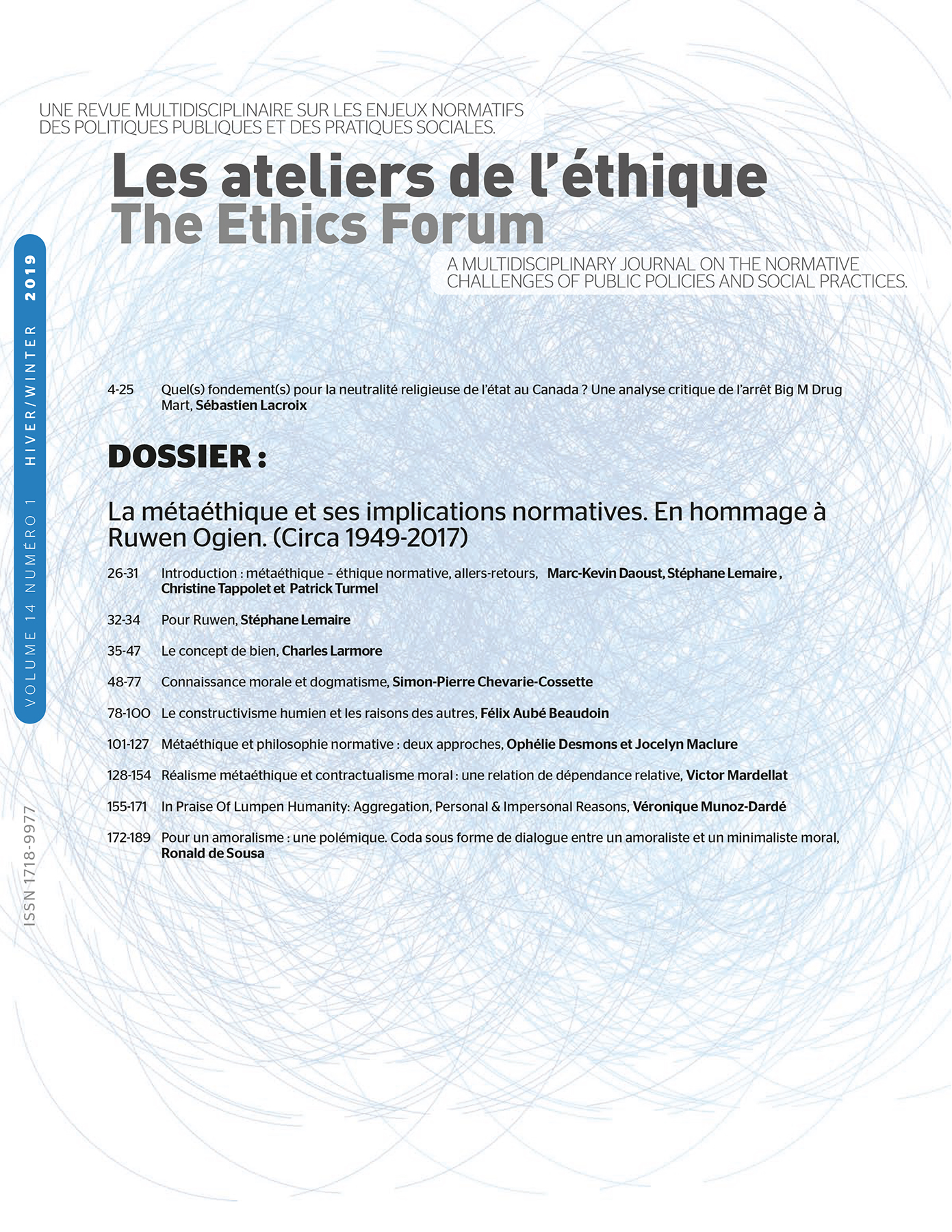Abstracts
Résumé
Dans cet essai, je défends une conception réaliste de la valeur selon laquelle le bon et le mauvais peuvent être un objet de connaissance. C’est à tort, je maintiens que certains aspects fondamentaux de la culture moderne sont censés exclure une telle conception et favoriser plutôt l’idée que nos jugements évaluatifs ne servent au fond qu’à exprimer nos préférences à l’égard des choses dont ils traitent. Mais je montre aussi pourquoi une conception réaliste est à épouser. Cet argument positif procède en deux temps. Je commence par le concept de bien, en soutenant que nous ne pouvons désirer une chose sans supposer (à juste titre ou non) qu’elle est bonne – ce qui signifie, sans supposer qu’il y a une raison de la désirer. Je passe donc ensuite au concept d’une raison. Là, il s’agit de montrer de façon générale que les raisons que nous avons (et non seulement que nous croyons avoir) de penser ceci ou de faire cela existent indépendamment de nos attitudes à leur égard. En effet, l’obstacle majeur qui s’oppose à l’idée que le bon et le mauvais peuvent être un objet de connaissance est l’absence d’une réflexion suffisante sur ce que c’est qu’une raison.
Abstract
In this essay, I defend a realist conception of value according to which good and bad can be an object of knowledge. Certain fundamental aspects of modern culture are wrongly thought, I argue, to exclude such a conception and to favor instead the idea that our evaluative judgments serve in the end only to express our preferences with regard to the things they deal with. But I also show why a realist conception ought indeed to be adopted. This positive argument proceeds in two stages. I begin with the concept of good, arguing that we cannot desire a thing without supposing (rightly or wrongly) that it is good – and that means, without supposing that there is a reason to desire it. I then move to the concept of a reason. There, it is a matter of showing, quite generally, that the reasons we have (and not merely the reasons we believe we have) to think this or to do that exist independently of our attitudes toward them. The major obstacle standing in the way of the idea that good and bad can be an object of knowledge is, in fact, the lack of adequate reflection about the nature of reasons.
Article body
Dans un de ses premiers écrits de philosophie morale, sa longue introduction à un recueil d’essais sur le réalisme moral, Ruwen Ogien a fait montre d’une grande sympathie pour ce courant philosophique.[1] Il a conservé, je crois, une telle sympathie tout au long de sa vie, même s’il se consacrait davantage – dans son éthique minimale – aux questions d’éthique normative qu’aux questions métaéthiques. Il suivait avec intérêt mes propres efforts pour développer une version du réalisme moral axée sur une conception réaliste de la nature des raisons, bien qu’il crût sans doute qu’elle devenait trop métaphysique. J’essayais de le convaincre que mon rejet de l’orthodoxie naturaliste était au contraire éminemment raisonnable. Dans le présent essai, je tente d’expliquer mon approche d’une façon aussi accessible que possible, en la situant par rapport à certaines tendances de la culture moderne.[2] J’aurais aimé qu’il soit là pour le lire. Je le dédie à sa mémoire et à la mémoire de nos discussions si animées.
I
L’une des notions philosophiques les plus répandues dans la société contemporaine tout entière est l’idée que le bien et le mal, voire le bon et le mauvais plus généralement, n’ont rien d’objectif. Ils ne sauraient constituer un objet possible de connaissance. Quand nous disons que quelque chose est bon ou mauvais, nous ne pouvons pas, suppose-t-on, légitimement prétendre avoir saisi une propriété réelle de ce dont nous parlons. Nous ne décrivons pas. Nous ne faisons au fond qu’exprimer une certaine attitude positive ou négative à l’égard de la chose en question. Dire que la bienveillance est un bien et le meurtre un mal revient à indiquer que nous approuvons l’une et rejetons l’autre. On admet que certains restent persuadés que de tels énoncés sont destinés à constater des faits. Et que dans le passé – particulièrement à des époques où la religion exerçait un contrôle sur l’esprit humain –, la plupart des gens en étaient persuadés comme si cela allait de soi. Mais selon l’opinion courante, il s’agit d’une illusion fondamentale, dont on se félicite de ne plus être prisonnier. C’est une tâche essentielle de la philosophie que de critiquer des illusions. Or, notre époque se veut elle-même philosophique – réfléchie et désabusée – et l’une des illusions supposées qu’elle se vante d’avoir surmontées est que le bon et le mauvais en tant que tels, en plus de nos attitudes à leur égard, font partie du monde réel.
Je ne partage pas moi-même cette conviction commune. Elle me paraît en fait intenable. Dans les réflexions suivantes, je me propose d’examiner de quel côté se trouve l’illusion en réalité.
L’idée-noyau que je viens d’esquisser a pris parmi les philosophes des formes autrement sophistiquées, surtout dans les différentes versions du courant philosophique qu’on appelle aujourd’hui justement l’expressivisme. Les oeuvres de Simon Blackburn et d’Allan Gibbard en sont les exemples les plus célèbres.[3] Leur thèse de base est que la fonction de nos énoncés évaluatifs n’est pas de décrire, et pas même de décrire nos propres attitudes. Elle est de les exprimer. Car si ces énoncés servaient à raconter ce que nous ressentons, le conflit entre deux prises de position contraires – « mentir pour épargner la sensibilité d’un autre est parfois une bonne chose », « mentir pour cette raison n’est jamais une bonne chose » – s’évanouirait au profit de deux rapports sur l’état d’esprit où chacun se trouve – « moi, Marie, je l’approuve », « moi, Pierre, je ne l’approuve pas » –, rapports qui ne sont pas en conflit en tant que tels. Le conflit consiste dans l’incompatibilité des deux attitudes elles-mêmes qui ont été exprimées et des engagements opposés qu’elles entraînent. Mais l’expressivisme s’est développé bien au-delà de ce point de départ.
Ainsi a-t-on fait valoir que si nos énoncés moraux se présentent d’ordinaire comme valables non seulement pour autrui autant que pour nous-mêmes mais aussi indépendamment de tout désir qu’on se trouve avoir de faire ce qu’ils prescrivent, l’impartialité et l’inconditionnalité qu’ils revendiquent ne sont que l’expression de préférences d’un ordre supérieur, visant à régler de la façon indiquée nos propres désirs ainsi que ceux d’autrui. Dire que la bienveillance est un bien et le meurtre un mal reviendrait plus exactement à exprimer notre adhésion à la règle selon laquelle tout le monde, nous-mêmes y compris, doit sans exception approuver l’une, rejeter l’autre, et agir en conséquence. Bref, la thèse distinctive de l’expressivisme est que le contenu proprement évaluatif de nos jugements évaluatifs – c’est-à-dire abstraction faite de leur contenu empirique – est épuisé par les différentes sortes de désirs et de préférences qui s’y expriment. Il n’y aurait rien dans l’objet lui-même de ces jugements, rien dans ce dont ils traitent, qui corresponde au bon ou au mauvais, au bien ou au mal, qu’ils évoquent. Par conséquent, ce qu’ils expriment ne saurait être au sens strict des croyances, la nature d’une croyance consistant, entre autres, en ce qu’on tient pour vrai ce qu’elle affirme et la vérité consistant à son tour en ce que les choses sont telles qu’on les conçoit.
Dans certains contextes, la conséquence que les énoncés évaluatifs ne peuvent être ni vrais ni faux s’avère pourtant assez gênante. On veut, par exemple, pouvoir raisonner à partir de prémisses concernant ce qu’on tient pour bon ou mauvais, mais un raisonnement n’est valable que si ses prémisses, à supposer qu’elles soient vraies, constituent une raison d’accepter la conclusion comme vraie aussi. Aussi des expressivistes, pour pouvoir néanmoins parler de la vérité d’énoncés évaluatifs, ont-ils souvent eu recours à une théorie déflationniste de la vérité.[4] C’est une théorie selon laquelle dire qu’une proposition p est vraie revient simplement à dire que p, l’utilité du prédicat vrai ne consistant qu’en ce qu’il nous permettrait d’affirmer des propositions que nous ne voulons pas ou ne pouvons pas énoncer (« je n’ai pas entendu ce que Philippe a dit, mais ce qu’il dit est toujours vrai »). Une telle analyse est pourtant inadéquate puisque la nature véritable de la vérité – la vérité-correspondance à laquelle je viens de faire allusion – reste implicite dans la notion de dire que p sur laquelle elle s’appuie. Le sens pertinent de dire dans ces cas est « affirmer », et en affirmant que p (au lieu de le supposer ou de le rêver, par exemple) on asserte que les choses sont réellement telles que cet énoncé p les représente. En maintenant que les énoncés évaluatifs n’expriment pas de croyances à propos de qualités correspondantes de leur objet, l’expressivisme ne peut donc pas légitimement s’accorder le droit de les considérer comme capables d’être vrais ou faux.
Évidemment, l’opinion courante ne se lance pas dans des subtilités du genre de celles que je viens de résumer. Il n’empêche que la notion que la morale ou plus généralement l’évaluation ne soient qu’une affaire d’attitudes est un refrain bien connu à notre époque.
On aurait assurément tort de croire que l’ubiquité de cette notion vient de l’influence exercée par la philosophie sur le grand public. Certains arguments en faveur de l’expressivisme sont assez spécifiques à la philosophie. Je pense en particulier à l’idée (appelée internalisme motivationnel) selon laquelle nos jugements évaluatifs à propos des options devant nous, contrairement à nos jugements empiriques, ne sont pas inertes d’un point de vue motivationnel, qu’ils comportent d’ordinaire l’inclination à nous comporter conformément à ce qu’ils disent être bon ou mauvais, ce qui s’explique, dit-on, si ces jugements évaluatifs ne servent pas à décrire des faits, mais plutôt à exprimer nos préférences. J’examine plus loin cet argument important. Il ne relève pourtant pas du genre d’idées qui sont à l’origine de l’ascendant de la conception expressiviste. Les sources de cette conception sont plus générales. Elles font partie des conditions de l’époque moderne et sont à ce titre également responsables du grand crédit dont jouit l’expressivisme dans le milieu spécial des philosophes.
Voici les conditions modernes dont je parle. Il y a tout d’abord la facilité apparente avec laquelle on entre en désaccord sur des questions concernant ce qui est bon ou mauvais, surtout dans une société ouverte où chacun se sent plutôt libre de dire ce qu’il pense. Le contraste avec les sciences empiriques, qui arrivent habituellement à des résultats incontestés, semble indiquer que les jugements de valeur ne peuvent pas constituer une forme de connaissance. Puis, il y a l’affaiblissement de la foi religieuse, combiné avec la persistance de la notion, héritée de la tradition chrétienne, que Dieu seul peut fonder l’objectivité des valeurs. Il paraît s’ensuivre que nous avons toujours été nous-mêmes l’auteur des valeurs que nous avons embrassées. Et finalement, il y a la montée d’une conception naturaliste du monde qui, s’inspirant des succès immenses des sciences modernes, ne tient pour réel que ce qui fait partie de la nature en tant qu’elle se prête à l’investigation scientifique. Le monde ainsi conçu comme l’ensemble des faits physiques et psychologiques n’a pas de place pour le bon ou le mauvais, l’obligatoire ou le défendu, propriétés qui ne sauraient consister que dans la projection d’attitudes d’approbation ou de désapprobation sur une réalité en soi entièrement neutre. Pour ces trois raisons, ce n’est pas un accident si le noyau de la théorie expressiviste des jugements évaluatifs et moraux se retrouve aussi bien dans une grande partie de l’opinion courante que dans l’un des courants principaux de la philosophie contemporaine.
Or, je suis persuadé que la conception expressiviste, aussi répandue qu’elle soit et aussi adaptée qu’elle semble aux conditions du monde moderne, est fondamentalement fausse. Nos jugements évaluatifs, et nos jugements moraux en particulier, ne servent pas seulement à exprimer nos préférences, quelque impartiales ou inconditionnelles qu’elles soient, à l’égard des choses dont ils traitent. Ils font cela sans aucun doute. Mais ils prétendent aussi, à juste titre, décrire le réussi ou le manqué, le bien ou le mal, appartenant à leur objet lui-même. C’est d’ailleurs précisément parce qu’ils tiennent ainsi leur objet pour bon ou mauvais qu’ils expriment à son égard une attitude positive ou négative. Même de simples jugements de goût, tels que « cette glace vanille-fraise est bonne », n’y font pas exception, puisqu’ils expriment un penchant pour leur objet en raison du plaisir que nous croyons cet objet capable de nous donner. Sa capacité de nous procurer du plaisir est ce qui fait que cette glace nous paraît quelque chose de bon et que nous désirons par conséquent la manger. Tout jugement évaluatif suppose qu’il y a des aspects de son objet qui, le rendant bon ou mauvais, justifient le désir ou l’aversion pour l’objet qu’il peut exprimer aussi.
II
Pour défendre cette conception réaliste de la valeur, je vais présenter un argument en deux temps. Tout en commençant par le concept de bien, je vais passer au concept d’une raison. Car l’obstacle fondamental qui s’oppose à l’idée que le bon et le mauvais peuvent être un objet de connaissance, obstacle qui explique pourquoi les trois conditions modernes que je viens d’énumérer paraissent favoriser la conception expressiviste, est à mon avis l’absence d’une réflexion suffisante sur ce que c’est qu’une raison. En particulier, il y a le fait que les raisons que nous avons de penser ceci ou de faire cela existent indépendamment de notre attitude à leur égard. Il faut donc préciser que le terme de raison, étant ambigu, est à entendre dans la suite au sens de « raison valable » et non au sens de « motif », des motifs consistant en notre conception des raisons valables de faire ceci ou cela.
Commençons par la question suivante : qu’est-ce que désirer telle ou telle chose, désirer entendu au sens général de vouloir ? (J’utilise d’ailleurs les deux termes de désir et de préférence aussi de façon presque interchangeable.) Mon point de départ pour répondre à cette question est une donnée élémentaire de l’expérience. Il n’est pas possible de désirer quelque chose sans supposer qu’il y ait quelque raison de le désirer. Le désir n’a jamais le caractère d’un fait brut, d’une impulsion aveugle qui nous arrive de nulle part. Il est toujours une réponse à quelque aspect de son objet qui le rend désirable et nous attire. Impossible – pour choisir un exemple extrême – de vouloir allumer toutes les radios dans les parages sans considérer une radio allumée comme attrayante à quelque égard, que ce soit pour écouter des infos ou de la musique ou pour chasser le silence.[5] Or, ce qu’il y a une raison de désirer, c’est justement ce qui vaut comme bon. En tenant une chose, une action ou une institution sociale pour bonne, nous supposons que les individus concernés, nous-mêmes ou autrui, ont une raison de la désirer. Tout comme nous supposons qu’il y a une raison d’éviter ou de refuser ce que nous tenons pour mauvais.
On a parfois soutenu, en s’inspirant de la téléologie d’Aristote, que l’essence de ce qui est bon consiste dans le fait qu’il réalise sa fin, qu’il fonctionne conformément à sa nature.[6] Une telle définition, faisant dépendre tout ce qui est bon de l’existence de quelque fin objective constituant la nature même de la chose, me semble de ce fait assez problématique et certainement farfelue quand il s’agit d’une bonne glace vanille-fraise. Plus terre-à-terre et convaincante, et aussi plus utile dans ce contexte, est l’idée que je viens d’évoquer, à savoir que le bon est ce qu’il y a une raison de désirer. Car il en découle, étant donné les remarques précédentes, que nous ne pouvons désirer une chose, que ce soit pour nous-mêmes ou pour autrui, que dans la mesure où nous la regardons comme bonne. Le désir se dirige vers ce qui nous paraît bon. C’est là aussi une doctrine bien connue d’Aristote, mais une doctrine bien plus plausible.[7] Elle se laisse accepter indépendamment de la conception téléologique du bien qu’il a pu embrasser par ailleurs. Il est vrai que de nombreux philosophes modernes, à commencer par Hobbes et Spinoza mais jusqu’à nos jours, ont rejeté cette doctrine en soutenant au contraire que le bon et le mauvais que nous trouvons dans des choses ne sont que la projection de nos désirs.[8] Une telle conception a pourtant l’inconvénient majeur qu’elle fait du désir un élan immotivé.
Évidemment, nous pouvons désirer une chose sans qu’il y ait vraiment une raison de la désirer. Mais cela vient du fait que nous pouvons en général nous tromper en croyant avoir une raison (une raison valable) de faire ceci ou cela. Aussi peut-il nous sembler exister une raison de désirer la chose – c’est pourquoi nous la désirons – alors qu’il n’y en a pas. C’est-à-dire, elle nous paraît bonne alors qu’elle ne l’est pas en réalité. D’où il ressort, inversement, que nous pouvons avoir une raison de désirer une chose sans nous en rendre compte. Elle constitue alors pour nous un bien, même si nous ne la désirons pas. Étant donné ces platitudes, ne s’ensuit-il pas que le bon et le mauvais possèdent la sorte d’indépendance à l’égard de nos attitudes qui fait d’eux quelque chose de réel, un objet possible de connaissance ? Et n’en faut-il pas conclure que l’expressivisme se trouve par là réfuté ? Car en tenant une certaine chose pour bonne, nous entendons nous appuyer sur des raisons que nous avons en fait de la désirer et non sur des raisons que nous croyons seulement avoir sans en avoir véritablement. Nous supposons, en la désirant, qu’elle est réellement de nature à mériter d’être désirée.
III
On pourrait objecter que cette réfutation de l’expressivisme a été trop rapide. J’ai fait dépendre la réalité du bien de l’indépendance des raisons à l’égard de nos désirs. Mais qu’est-ce qu’une raison en général, et peut-elle vraiment exister indépendamment de nos désirs ou de nos préférences ? Des philosophes de tendance expressiviste ont développé leur propre analyse de la nature des raisons, analyse destinée à montrer qu’elles ne possèdent pas le genre d’indépendance que j’ai évoqué. Si cette analyse est juste, le fait d’avoir une raison de désirer une chose n’impliquerait pas en fin de compte que la notion qu’elle est par conséquent bonne soit autre chose qu’une projection de nos préférences.
Voici l’essentiel de leur position.[9] En disant que X nous donne une raison de faire Y – que le temps qu’il fait nous donne, par exemple, une raison de porter un parapluie –, nous ne visons pas, dit-on, à constater quelque fait, à savoir le fait qu’une telle raison existe, puisqu’il n’y a pas de faits de ce genre. Les raisons ne font pas partie de la réalité elle-même. Nous ne faisons qu’exprimer notre adoption d’une norme (disons la norme de ne pas venir au travail tout mouillé) qui exige de traiter X, le temps qu’il fait, comme une raison de faire Y, soit de porter un parapluie. C’est nous qui déterminons, sur la base des règles selon lesquelles nous préférons agir, ce qui vaut comme une raison. L’insuffisance d’une telle analyse devrait pourtant être évidente. Nous ne pouvons pas adopter une norme ou une règle sans supposer que nous ayons une raison de l’adopter. Ou si nous le pouvions, notre adoption serait arbitraire et la norme ou la règle adoptée ne saurait conférer aucune autorité à la raison qu’elle prétend indiquer. Une telle raison ne serait en conséquence aucune raison du tout. Aussi cette approche, même si elle fait appel à l’adoption de quelque norme de deuxième ordre pour fournir la raison d’adopter la norme en question, ne peut-elle jamais arriver à rattraper l’objet – la nature d’une raison – qu’elle prétend analyser. Car l’adoption de cette norme d’ordre supérieur serait également arbitraire si elle ne s’appuyait pas sur ce qu’on tenait pour quelque raison de l’adopter.[10]
On a aussi proposé une façon différente de montrer que les raisons n’existent pas indépendamment de nos désirs. Cette analyse est destinée à renforcer, non pas tant la théorie expressiviste des jugements évaluatifs que la conception naturaliste du monde qui est, en fait, à sa base. Il sera donc utile de l’examiner également, puisqu’en fin de compte c’est ce naturalisme qu’il faut contester. Que quelque fait dans le monde constitue pour nous une raison de faire ceci ou cela se réduit, disent certains, à ce qu’il permettrait à l’action en question de satisfaire quelque désir que nous avons.[11] La nature d’une raison consisterait dans la capacité causale d’un fait physique ou psychologique de contribuer à la satisfaction de l’un de nos désirs. Une première difficulté est la suivante. Même si une action particulière nous aiderait à satisfaire quelque désir, cela ne constitue pour nous une raison d’agir ainsi qu’à condition que nous ayons une raison de satisfaire ce désir, la possession d’un désir ne nous donnant pas d’elle-même une raison de le satisfaire. Si nous n’avons pas de raison de satisfaire un certain désir, nous n’avons pas non plus de raison de faire ce qui nous permettrait de le satisfaire. Lancer des rumeurs contre mon plus grand ennemi pourrait être le moyen parfait pour assouvir le désir de vengeance qui me ronge, mais est-ce que j’ai par conséquent une raison de le faire ? Cela est douteux. Il est exact que tout désir, comme je viens de le souligner, repose sur le fait de voir quelque raison de désirer ce dont il s’agit. Il ne faut pourtant pas confondre la raison qui rend un objet désirable avec une raison de satisfaire le désir ainsi engendré. Que nous nous sentions attirés par une chose n’implique pas que nous devions la poursuivre. Mais il y a un second défaut encore plus évident dans l’analyse proposée. Comme tout désir est une réponse à ce qui dans son objet paraît nous donner une raison de le désirer, il est manifeste que les raisons ne se laissent pas expliquer par des désirs. Ce serait présupposer ce qu’il s’agit d’expliquer.
Que ces deux genres d’analyse s’avèrent insuffisants, il fallait en effet s’y attendre. Car le propre d’une raison est d’être essentiellement normatif, alors que le désir est quelque chose de psychologique, un état d’esprit passager ou durable. En général, une raison – je parle, il faut le noter, des raisons elles-mêmes et non de nos idées des raisons que nous avons, idées qui peuvent ou non s’accorder avec leur objet et qui sont, elles, de nature manifestement psychologique –, une raison donc consiste en ce qu’un certain fait (ou ensemble de faits) dans le monde compte en faveur de quelque possibilité de pensée ou d’action que nous sommes en mesure d’adopter.[12] On dit parfois, en abrégé, que la raison de porter un parapluie est qu’il pleut. Mais, en réalité, c’est que la pluie compte en faveur du port d’un parapluie. (Nous pourrions, après tout, admettre le fait qu’il pleut tout en contestant qu’il nous donne une raison de porter un parapluie.) Or, quoique les faits sur lesquels reposent des raisons, sans y être réductibles, soient de nature physique ou psychologique, la relation de compter en faveur de – en d’autres termes, de justifier – n’est aucunement de cette nature. Elle est de caractère normatif. En général, avoir une raison de faire ceci ou cela signifie que l’on devrait le faire, toutes choses égales d’ailleurs. Car même lorsque la raison de le faire – d’aller nager, par exemple, parce qu’on a du temps libre – est suffisante sans être décisive de sorte qu’il serait faux de dire qu’on devrait aller nager, c’est parce qu’il y a dans ce cas d’autres options, comme d’aller courir, qui sont tout aussi justifiées : on devrait certes profiter de son temps libre, mais la façon de le faire compte peu. Ainsi devient-il évident que toute tentative d’analyser ce qu’est une raison en la réduisant à un ensemble de faits physiques et psychologiques est condamnée à l’échec. Mais, il devient également évident que, dans la mesure où nous supposons qu’il existe des raisons de penser ceci ou de faire cela, nous devons supposer que le monde, au sens de la totalité de ce qui existe, comprend, en plus des faits physiques et psychologiques, des faits normatifs aussi.
Cette conclusion ontologique va certainement à l’encontre de l’image du monde naturaliste, aujourd’hui régnante, selon laquelle le réel se réduit à des faits physiques et psychologiques. J’y reviens. Il ne faut pourtant pas se faire une idée exagérée de ce qu’elle implique. Les raisons n’habitent pas quelque royaume au-delà des faits empiriques. Elles ont un caractère non seulement normatif mais aussi relationnel, consistant dans la façon dont des faits empiriques comptent en faveur de certaines de nos possibilités. Il n’existerait pas de raisons s’il n’existait pas les faits physiques et psychologiques dont elles dépendent. C’est parce qu’il pleut qu’on a une raison de porter un parapluie. Il n’en existerait pas non plus s’il n’y avait pas des êtres comme nous, qui n’ont pas simplement des possibilités (comme des pierres ou des plantes, qui n’ont manifestement pas de raisons), mais des possibilités parmi lesquelles ils peuvent choisir à la lumière de faits qui leur paraissent pertinents. Nous, les humains, ne sommes au demeurant pas les seuls à posséder des possibilités de ce genre ; les animaux supérieurs en possèdent aussi à des degrés différents, de sorte qu’ils peuvent, eux aussi, voir des raisons d’agir d’une manière ou d’une autre, comme mon chien qui m’apporte un bâton quand il en trouve un qui lui paraît intéressant. Il est clair que le monde en soi, c’est-à-dire abstraction faite de notre propre existence ou de l’existence de tels êtres, ne contiendrait pas de raisons. (C’est d’ailleurs pourquoi le bon et le mauvais y seraient également absents.) Il n’en reste pas moins que les raisons qu’il y a de penser ceci ou de faire cela existent indépendamment, sinon de notre existence, du moins de nos attitudes à leur égard, car nous pouvons toujours nous tromper à leur sujet. Aussi relationnelles qu’elles soient, les raisons sont par conséquent quelque chose de réel. Elles font elles-mêmes – en plus de nos idées à leur propos – partie du monde tel qu’il est réellement, tel qu’il peut être l’objet de notre connaissance. Cela signifie, entre autres, qu’à proprement parler il n’y a pas vraiment de mauvaises raisons. Il n’existe que des raisons valables. Ce qu’on appelle communément de mauvaises raisons, ce sont des conceptions mauvaises ou erronées de raisons qu’on suppose exister en réalité.
IV
Revenons maintenant au concept de bien. Ce qui est bon, ai-je dit, c’est ce que nous avons une raison de désirer. Le réalisme des raisons que je viens de défendre implique ainsi un réalisme à l’égard du bon et du mauvais. Qu’une chose soit bonne ou mauvaise est une propriété réelle de cette chose, quoiqu’elle en soit en même temps une propriété relationnelle consistant en ce que certaines propriétés empiriques de la chose nous donnent une raison de la désirer.
Il faut pourtant être clair sur la portée d’un tel réalisme des valeurs. Il n’exclut pas que parfois la raison de désirer une chose, tout en reposant sur quelques-unes de ses propriétés empiriques, fasse aussi référence essentiellement à quelque aspect de notre propre personne ou culture qui n’est pas partagé avec le reste de l’humanité. Si je trouve que cette glace vanille-fraise est bonne ou qu’il est bon de confesser ses péchés au prêtre, la raison que je vois de désirer en manger ou de vouloir me confesser dépend du fait que ce parfum me fait régulièrement plaisir ou du fait (supposons, du moins) que je suis membre de l’Église catholique. D’autres individus n’auraient pas tort de croire qu’en ce qui les concerne, de telles choses ne sont pas du tout bonnes. Dans les cas de ce genre, le réalisme débouche sur un certain relativisme. La glace ou la confession n’est quelque chose de bon que relativement aux particularités de l’individu ou d’une tradition culturelle. Le vrai contraire d’une conception réaliste du bon et du mauvais n’est pas ce genre de relativisme, mais plutôt la sorte de subjectivisme qui réduit les jugements évaluatifs à l’expression des états d’esprit de ceux qui les font.
Il n’est toutefois pas difficile d’imaginer des cas où la réalité de ce qui est bon ou mauvais transcende tout relativisme. Il suffit que la raison de désirer la chose en question soit valable quelles que soient nos particularités psychologiques ou nos appartenances sociales ou culturelles. Parfois il s’agit d’une raison qui dépend de facteurs qui sont partagés par toute l’humanité. Il n’y a rien de relatif, par exemple, dans le fait qu’il soit bon d’avoir assez à manger pour rester en vie puisque chacun en a naturellement besoin. Parfois, en revanche, la raison de désirer quelque chose est indépendante de tout facteur de ce genre. Ainsi est-il bon, en l’absence d’un devoir supérieur, de tenir ses promesses quel que puisse en être le désagrément. C’est une façon d’agir à l’égard des autres que chacun devrait vouloir faire sienne puisqu’il s’agit de leur témoigner le respect qui leur est dû comme à des êtres qu’on ne devrait pas simplement manipuler pour avancer ses propres intérêts. La conception réaliste du bien qui s’impose comprend non seulement des biens relatifs, mais aussi des biens universels, des biens faisant partie de ce qu’on appelle le bien humain.
V
Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi les considérations qui semblent favoriser une conception subjectiviste des valeurs ne sont pas convaincantes. Prenons l’argument philosophique assez technique mentionné plus haut, argument s’appuyant sur le soi-disant internalisme motivationnel. Nos jugements évaluatifs à propos de nos propres options ne sont pas, il est vrai, de nature à nous laisser indifférents. Ils nous disposent d’ordinaire à nous comporter conformément à ce qu’ils évoquent comme bon ou mauvais. Mais il ne s’ensuit pas que leur fonction soit simplement d’exprimer nos désirs ou nos préférences au lieu de décrire des faits. En soutenant que quelque chose est bon ou mauvais, ces jugements disent en effet qu’il y a une raison de le désirer ou de l’éviter, et la reconnaissance du fait qu’il y a une raison de faire ceci ou cela est en général de nature à nous motiver à le faire. Elle l’est plus précisément dans la mesure où nous sommes rationnels : un être parfaitement rationnel, ne souffrant par exemple d’aucune faiblesse de la volonté, serait un être dont la nature même le conduit à se comporter conformément aux raisons de penser ou d’agir qu’il voit.
Aussi nos jugements sur de telles raisons, et partant nos jugements évaluatifs en particulier, possèdent-ils à la fois les deux directions d’ajustement entre l’esprit et le monde par lesquelles on distingue communément les croyances, qui doivent correspondre au monde, des désirs, qui sont satisfaits lorsque le monde correspond à eux. L’expressivisme veut répartir ces deux fonctions entre les jugements descriptifs d’un côté et les jugements évaluatifs de l’autre. Mais cela est trop simple. En tant que nos jugements évaluatifs entendent décrire des raisons de faire ceci ou cela, ils s’ajustent à ce qu’ils déclarent exister (direction d’ajustement esprit-monde). Mais en tant que ce sont des raisons qu’ils décrivent, ils entendent en même temps que l’individu en question ajuste son comportement aux raisons de vouloir ou d’agir qu’ils disent exister (direction d’ajustement monde-esprit). Dans la mesure où il est rationnel, l’individu ne peut pas reconnaître qu’il a une raison de faire ceci ou cela tout en y restant indifférent.
Nous sommes également en état de comprendre pourquoi les trois conditions de l’époque moderne dont j’ai dit au début qu’elles ont conduit tant de gens en général à embrasser le noyau de l’expressivisme n’ont pas réellement la signification qu’on leur suppose. Le foisonnement de désaccords moraux, regardé souvent comme un signe de l’incapacité de la morale de constituer une forme de connaissance, s’étend-il partout ou porte-t-il plutôt, comme je suis enclin à le croire, sur des questions de détail ou d’application ? Prenons comme exemple la controverse autour de l’avortement. Tout le monde est d’accord que commettre un meurtre est mal. La dispute porte sur la question de savoir si, ou dans quelle période de la grossesse, l’avortement est à considérer comme un meurtre.[13] En outre, la prolifération de désaccords moraux, pour autant qu’elle est encouragée aujourd’hui par la pratique de la tolérance et par le droit à la différence, repose sur un accord sur certains principes moraux concernant la liberté individuelle. Il n’y a pas que des différends. Certes, des différends sont loin d’être rares, surtout, me semble-t-il, lorsqu’il s’agit d’appliquer à des questions concrètes des principes moraux qui sont, eux, tenus en commun. Mais cela ne suffit pas à mettre en cause l’idée que le bien et le mal sont des propriétés réelles, pouvant devenir un objet de connaissance. En abordant des questions concernant ce qui est bon ou mauvais dans des situations concrètes, on doit s’appuyer sur son sens de la pertinence. Il s’ensuit que des individus ayant des expériences de vie différentes sont susceptibles de soupeser différemment les diverses raisons – certaines concernant des faits empiriques, certaines ayant trait à d’autres considérations morales – qui se trouvent en jeu. Dans la mesure néanmoins où l’on peut être poussé à réfléchir aux raisons qu’on voit de les soupeser comme on le fait, rien n’empêche, du moins en principe, qu’on réussisse à régler la dispute. En effet, on ne peut même pas croire qu’il s’agisse d’une dispute, et non d’une simple divergence de préférences, sans supposer qu’il existe en fin de compte une solution correcte.
Quant aux deux autres conditions de l’époque moderne que j’ai mentionnées, c’est la défense précédente de l’objectivité de la valeur, défense basée sur un réalisme des raisons, qui montre qu’elles n’ont pas les implications supposées.
L’affaiblissement de la foi religieuse et l’acceptation accrue d’un monde sans Dieu sont deux phénomènes incontestables, et peut-être regrettables. Mais qu’est-ce qu’ils ont à faire avec la nature ou avec les fondements de la morale ? Ce n’est pas comme si ceux qui croient en l’existence de Dieu pouvaient, en toute logique, tenir Dieu pour l’auteur des principes de la morale, puisque cela retirerait tout sens à l’idée que Dieu lui-même est juste. Le christianisme nous a pourtant légué la notion, toujours répandue, que s’il n’y a pas de Dieu qui soit l’auteur des valeurs, c’est nous-mêmes qui le sommes. Je suis tenté, moi-même, de m’exclamer, en variant le vers de Lucrèce, « tant la théologie chrétienne a pu persuader de maux intellectuels ! ».[14]
Et finalement, la conception naturaliste du monde, conception selon laquelle il n’existe que ce qui peut devenir un objet des sciences naturelles, à savoir des faits empiriques, physiques ou psychologiques, ne se contredit-elle pas elle-même en tant qu’elle présume qu’il y a de bonnes raisons de l’embrasser ? En effet, la science peut servir d’autant moins de critère suffisant de ce qui est réel que les résultats scientifiques ne comptent comme valables que dans la mesure où les preuves invoquées à leur appui constituent en fait des raisons de les accepter. Qu’il existe des raisons de penser et d’agir et qu’elles soient de nature intrinsèquement normative mettent en évidence les limites de la conception naturaliste.
Or, une fois admis que des raisons existent indépendamment de nos attitudes à leur égard, il ne reste plus d’obstacle à admettre que le bon et le mauvais peuvent être aussi des objets de connaissance. Car le bon et le mauvais sont ce qu’il y a des raisons de désirer ou d’éviter, et ils font donc partie du réel également.
Appendices
Notes
-
[1]
Ruwen Ogien, « Qu’est-ce que le réalisme moral ? », dans Ruwen Ogien, (dir.), Le réalisme moral, Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 3-194.
-
[2]
Cet essai est une version abrégée du premier chapitre d’un livre, Comment vivre sa vie, qui va paraître chez Odile Jacob.
-
[3]
Voir, par exemple, Simon Blackburn, Ruling Passions, Oxford, Clarendon Press, 1998; Allan Gibbard, Wise Choices, Apt Feelings, Cambridge, Harvard University Press, 1990.
-
[4]
C’est la stratégie de Gibbard dans un ouvrage ultérieur, Thinking How to Live, Cambridge, Harvard University Press, 2003, p. x, 182-183.
-
[5]
Cet exemple vient de Warren Quinn, « Putting rationality in its place », dans son livre Morality and Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, chapitre XII.
-
[6]
Voir Aristote, Physique, p. 195a24-26, et Éthique à Nicomaque, p. 1097b24-1098a18.
-
[7]
Aristote, Éthique à Eudème, p. 1235b25-27 : « L’objet du désir et l’objet du souhait est ou le bien ou le bien apparent. Et c’est pourquoi le plaisant est l’objet du désir, car il est un bien apparent. » Voir aussi De Anima, p. 433a27-29, et Métaphysique, p. 1072a27-30.
-
[8]
Hobbes, Léviathan, I.vi.7 ; Spinoza, Éthique, vol. III, proposition 9, scolie (voir aussi la scolie de la proposition 39).
-
[9]
Voir Gibbard, Wise Choices, Apt Feelings, p. 163.
-
[10]
Dans son ouvrage ultérieur, Thinking How to Live (p. 181, 189-191), Gibbard substitue dans son analyse la notion d’adopter un plan à celle d’adopter une norme. Mais cette modification n’élimine pas la difficulté. Si nous regardons X comme une raison de faire Y parce que nous avons adopté un plan d’action qui l’exige, c’est seulement dans la mesure où nous croyons avoir une raison d’adopter le plan en question. Si l’adoption du plan était arbitraire, un pur caprice, la décision de traiter X comme une raison de faire Y serait également arbitraire, ce qui veut dire que nous ne pourrions pas regarder X comme une telle raison.
-
[11]
Voir Mark Schroeder, Slaves of the Passions, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 29.
-
[12]
À maints égards, l’analyse suivante rejoint les conceptions développées ces dernières années par des philosophes tels que Derek Parfit et T. M. Scanlon. Je me distingue pourtant d’eux dans la mesure où je n’hésite pas, comme on le verra, à poursuivre jusqu’au bout les implications métaphysiques d’une théorie réaliste des raisons. Voir mon article « Morals and metaphysics », European Journal of Philosophy, vol. 21, no 4, décembre 2013, p. 665-675.
-
[13]
Il faut souligner qu’ici je parle de cette dispute en tant qu’elle relève de la morale. Quant à la question politique de l’avortement, elle me paraît beaucoup plus simple. Dans la mesure où des gens raisonnables et de bonne foi se trouvent en désaccord sur le caractère moral de l’avortement, l’État doit, autant que possible, laisser aux individus eux-mêmes la liberté de décider de leur propre conduite.
-
[14]
Lucrèce, De rerum natura, I.101 : « Tantum religio potuit suadere malorum. »