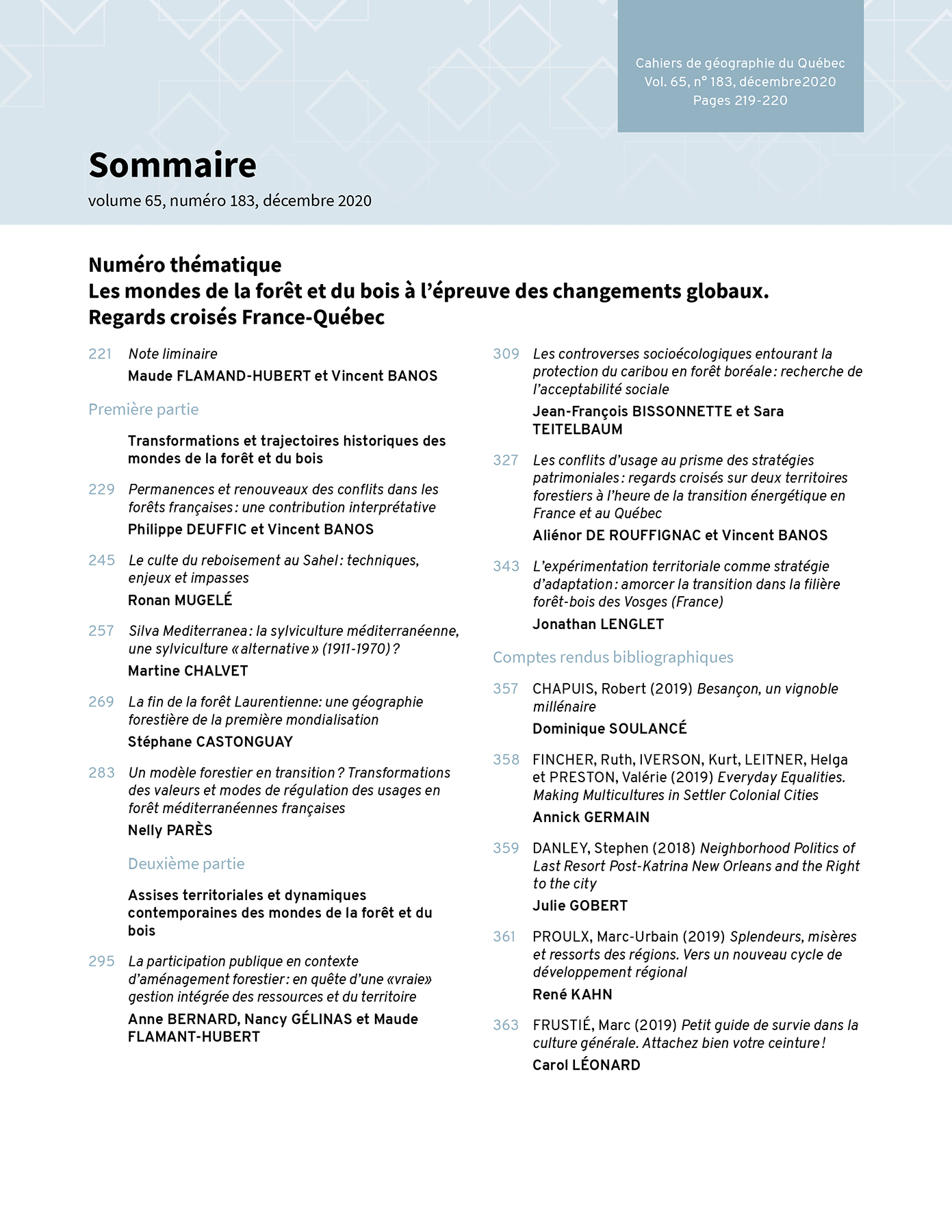Résumés
Résumé
Depuis quelques années, la gestion des forêts françaises fait l’objet de critiques environnementales et sociales au point de déclencher des enquêtes parlementaires. Cette augmentation de la conflictualité reste cependant à confirmer tant l’histoire des forêts françaises est émaillée de controverses. Assumant une perspective sociohistorique et interprétative, nous faisons l’hypothèse que certaines tensions et certains facteurs explicatifs traversent le temps sans pour autant être reproduits à l’identique. Cette grille de lecture met en lumière l’influence contemporaine de l’écologisation partielle de la gestion forestière, ainsi que des modes de socialisation plus distanciés des acteurs et usagers de la forêt, d’une gouvernance inachevée et d’une confiance très relative dans les autorités épistémiques. Pour tenter d’atténuer ces conflits, qui apparaissent autant comme des troubles de l’ordre social que des occasions de régulation, les forestiers sont partagés entre trois types de solutions très différentes : tenter de faire accepter les méthodes de gestion, améliorer la communication, changer les méthodes de sylviculture.
Mots-clés :
- Conflit,
- environnement,
- forêt,
- perception,
- gouvernance,
- acceptabilité,
- mobilisation sociale
Abstract
In recent years, the management of French forests has been the subject of environmental and social criticism to the point of triggering parliamentary inquiries. This increase in conflictuality has yet to be confirmed since many controversies have spanned the history of French forests for centuries. Through a socio-historical and interpretative perspective, we hypothesize that the current tensions are both the product of this history and of the updating of explanatory factors such as a partial greening of forest management, more distant modes of socialization of forest actors and users, incomplete governance, and a very relative confidence in epistemic authorities. To try to mitigate these conflicts, which appear as much as disturbances of the social order as opportunities for regulation, foresters are divided between three very different types of solutions: trying to gain acceptance for management methods, improving communication, and changing silvicultural methods.
Keywords:
- Conflict,
- environment,
- forest,
- perception,
- governance,
- acceptability,
- social mobilization
Resumen
Desde hace algunos años, la gestión de los bosques franceses es objeto de críticas medio-ambientales y sociales, hasta incitar encuestas parlamentarias. Este incremento conflictivo deberá confirmarse, pues la historia de los bosques franceses está adornada de controversias. A partir de una perspectiva socio-histórica e interpretativa, planteamos la hipótesis según la cual ciertas tenciones y factores explicativos atraviesan el tiempo, sin reproducirse idénticamente. Esta tabla de lectura alumbra la influencia contemporánea de la acción ecológica parcial de la gestión forestal, de los modos de socialización alejados de actores y usuarios del bosque, de una gobernancia incompleta y de una confianza muy relativa en las autoridades epistémicas. Por tratar de atenuar esos conflictos, que parecen conflictos de orden social y de ocasiones de regulación, los silvicultores están divididos entre tres soluciones muy diferentes: tratar de hacer aceptar los métodos de gestión; mejorar la comunicación; cambiar los métodos de silvicultura.
Palabras clave:
- Conflicto,
- medio ambiente,
- bosque,
- percepción,
- gobernancia,
- aceptabilidad,
- movilización social
Corps de l’article
Introduction
« Coupes rases », « industrialisation », « malforestation », la gestion des forêts françaises fait l’objet depuis 2015 de critiques récurrentes sur diverses tribunes médiatiques (Vidalou, 2017 ; Drouet, 2018 ; D’Allens, 2019). Cette poussée de fièvre éditoriale suscite des questions au regard des résultats d’une enquête menée en 2015 auprès d’un échantillon représentatif de la population française (Cordellier et Dobrée, 2017). Alors que 26 % des participants à l’enquête affirment que les coupes rases détruisent la forêt, 68 % d’entre eux se disent tout à fait ou assez satisfaits de l’entretien et de l’aménagement de la forêt, et 11 % seulement considèrent l’exploitation des bois comme une menace.
Si cette photographie de l’opinion française invite à la prudence, il serait hasardeux de réduire les tensions actuelles à un simple artefact médiatique. Ces tensions ont en effet conduit au lancement d’une commission d’enquête parlementaire[1], ainsi que d’une mission gouvernementale sur la forêt et le bois (Cattelot, 2020) et même à une proposition de loi visant à encadrer les coupes rases (Assemblée nationale, 2020). Le diagnostic de la situation est d’autant plus difficile à établir que certains conflits forestiers ne sont ni médiatisés ni inscrits aux programmes politiques et qu’ils ne constituent plus vraiment, en France, un objet de recherche en sciences sociales.
À défaut d’un inventaire, nous proposons de dégager, en partant d’une analyse bibliographique et sociohistorique, des facteurs de permanence ou de changement susceptibles d’expliquer les dynamiques conflictuelles au sein de la forêt française. Prolongeant les travaux de Decoq et al. (2016) sur les liens entre savoirs et pouvoirs qui se structurent au XIXe siècle autour du rôle « environnemental » des forêts, nous faisons l’hypothèse que les conflits actuels sont partiellement lestés de leur passé et que certaines de leurs dimensions explicatives traversent le temps, sans toutefois être reproduites à l’identique. Après avoir défini le terme « conflit », nous utiliserons des travaux fondateurs en sociologie sur les conflits forestiers au XIXe siècle afin de proposer une grille d’interprétation de leurs causes structurelles : rapports humain/nature/forêt, mode de « socialisation à la forêt », organisation de la gouvernance et place des savoirs forestiers. Puis nous discuterons la pertinence de cette grille d’interprétation à l’aune de nos propres travaux et d’autres études de cas contemporaines. Enfin, nous verrons quels modes de résolution des conflits sont mis en oeuvre aujourd’hui par les acteurs du secteur forestier.
Les conflits en forêt : définition et apports analytiques de l’approche sociohistorique
Conflit, tensions, quelques précisions
L’acception la plus générique du terme « conflit » nous vient de la sociologie des organisations, qui définit le conflit comme un antagonisme entre individus ou groupes dans la société (ou entre sociétés) qui survient quand une décision ne peut être prise par les procédures habituelles (Rui, 2011). Eckerberg et Sandström (2013) précisent cette définition en évoquant une incompatibilité d’idées, de croyances, de comportements, de rôles, d’intérêts, de désirs ou de valeurs parmi des individus ou des groupes évoluant au sein d’un même territoire et dont l’un de ces groupes empêche l’autre de réaliser ses objectifs. Différents niveaux de conflictualité existent également : le conflit est manifeste et ouvert dans le cas d’une révolution, d’une guerre ou d’une grève. Il peut aussi exister à l’état latent, à bas bruit, sans visibilité médiatique ni accès aux arènes de décisions publiques, et se rapprocher d’autres notions comme celles de troubles ou de controverses. Ce gradient de conflictualité amène Torre et al. (2016) à distinguer les tensions – phénomènes qui se limitent à des oppositions distantes entre groupes sociaux – des conflits qui engagent les protagonistes à travers une menace comme une action juridictionnelle, la médiatisation du conflit, la confrontation verbale ou physique ou la production d’actions coercitives. Le conflit se définit aussi par une dimension substantielle, liée aux caractéristiques de « l’objet du problème », valeurs, intérêts, idéologies, etc. ; une dimension procédurale, liée aux modes de décision, au degré de transparence et d’inclusion des parties adverses dans les discussions ; et une dimension relationnelle, liée aux rapports de pouvoir, au degré de confiance entre protagonistes, etc. (Walker et Daniels, 1997).
Si, pour certains sociologues comme Durkheim ou Parsons, les conflits constituent un dysfonctionnement à réguler, d’autres, comme Simmel (2003 [1908]), considèrent que le conflit n’est pas qu’une pathologie de l’ordre social. Il peut être un moment positif, voire nécessaire, pour faire évoluer les règles et les routines instituées. Il participe de la socialisation des individus et des groupes, structure et régule les relations collectives, et renforce leur identité sociale. Les conflits démontrent de manière contre-intuitive leurs effets intégrateurs en se posant comme une des modalités de construction et de cadrage de l’action collective (Mormont, 2006).
Matériaux et méthodes
Simmel nous rappelle que les conflits actuels éclatent souvent sur la base de conflits anciens, mis en sourdine, délégitimés ou considérés comme réglés par les groupes dominants. Ces controverses de longue portée se caractérisent par des points d’origine discutés, une clôture souvent incertaine, et posent la question de la logique d’enquête la plus appropriée. Pour Chateauraynaud (2015), l’analyse chronologique permet de déceler des phases de crise et d’accalmie et d’organiser ainsi une première périodisation à des fins analytiques.
Nous avons donc réalisé une analyse bibliographique et sociohistorique adossée aux recherches majeures effectuées par des sociologues et historiens spécialistes des questions forestières en France dans les années 1980-1990, tels que Bernard Kalaora, Raphaël Larrère, Olivier Nougarède et Robert Ballion. Cet héritage scientifique est d’autant plus important qu’il constitue une des rares lectures sociologiques des conflits forestiers et des effets sociaux des politiques forestières en France sur une période allant du XIXe siècle à la fin des années 1980. Ce corpus a été complété par des travaux qu’ont menés des historiens et géographes du Groupe d’histoire des forêts françaises (GHFF). L’ensemble de ces travaux offre une perspective historique très complète des tensions et conflits en forêt au cours des deux derniers siècles, mais l’apport analytique en a rarement été relevé. Nous proposons donc d’en extraire une grille d’interprétation qui permette de repérer des facteurs de conflictualité récurrents.
Pour tester la pertinence et l’adéquation de cette grille d’interprétation à l’analyse des conflits contemporains, nous remobilisons et croisons des recherches réalisées au cours de ces 20 dernières années. Si nos travaux empiriques ne sont pas tous spécifiquement axés sur la question des conflits, ils abordent néanmoins des problématiques à l’origine de nombreuses controverses, qu’il s’agisse de l’impact de la sylviculture sur les paysages et l’environnement (Deuffic et Lewis, 2012), des usages récréatifs (Dehez, 2012), des processus de concertation (Candau et Deuffic, 2011) et de la recomposition sociale des territoires forestiers (Mora et Banos, 2014), des stratégies d’adaptation au changement climatique (Banos et Deuffic, 2020) ou des politiques environnementales liées à la biodiversité (Deuffic et al., 2012) et au bois-énergie (Banos et Dehez, 2017). Basée sur une relecture et une mise en dialogue originales de données produites au cours de différents projets de recherche, cette analyse est complétée par des études d’autres chercheurs qui ont abordé des aspects complémentaires tels que la question de l’enrésinement dans le Morvan (Moriniaux, 1999), les usages et représentations de la forêt des Landes de Gascogne (Ribereau-Gayon, 2011) ou la mise en oeuvre conflictuelle du réseau d’espaces naturels protégés Natura 2000 (Fortier et Alphandéry, 2005).
La forêt, espace et tensions éternelles et renouvelées
L’approche sociohistorique montre que les conflits sont quasiment consubstantiels aux rapports forêt-société. Elle nous permet d’établir quatre ruptures successives dans la relation entre forestiers et usagers.
Définir l’intérêt général à la place des communautés locales
L’ordonnance de 1669 et le Code forestier de 1827 amènent une de ces ruptures originelles. Ces textes réglementaires posent les bases d’une relation forestiers/société fondée sur une asymétrie de pouvoir – propre à l’époque – qui limite radicalement les droits d’usage (récolte du bois de chauffage, pacage du bétail, cueillette, etc.) au nom d’un catastrophisme environnemental (Larrère et Nougarède, 1993). Si quelques forestiers inspirés par l’approche sociologique de Pierre Guillaume Frédéric le Play militent pour une meilleure inclusion des communautés locales dans les politiques d’aménagement (Kalaora et Savoye, 1986), l’administration des Eaux et Forêts opte pour le rapport de force. Les révoltes paysannes dans les Alpes et la Guerre des demoiselles, dans les Pyrénées, opposent ainsi défenseurs de l’activité agropastorale et agents de l’administration, chaque côté s’accusant mutuellement de nuire à l’activité de l’autre, voire à l’intérêt général (Larrère et al., 1980). Si ces tensions diminuent à la fin du XIXe siècle, c’est essentiellement dû à l’exode rural qui vide les montagnes de leurs agriculteurs, laissant le champ libre aux forestiers. Tout au long du XIXe siècle, voire du XXe, s’ajoutera ou se substituera – selon le contexte – à cet argument d’autorité celui de l’exemplarité, les forestiers se voyant comme les garants de l’ordre social et de l’intérêt général à long terme (Decoq et al., 2016).
Nouveaux rapports à la nature et nouveaux publics
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une deuxième rupture a lieu entre les autorités forestières et les élites artistiques et intellectuelles. Rassemblées autour des « peintres de Barbizon », celles-ci font de la forêt le symbole d’une nature à protéger (Kalaora, 1993) et obtiennent la création des premières réserves artistiques, entre 1853 et 1861. Ce mouvement amorce une dissociation progressive entre les schèmes techniques et utilitaristes de la forêt promus par l’administration forestière et les dimensions artistiques et émotionnelles recherchées par une élite sociale urbaine (Deuffic et Lewis, 2012). Et si les forestiers défendent aussi une vision esthétique (Guinier, 1893), celle-ci reste généralement inféodée à des « besoins de service ».
Cette période voit aussi un investissement des espaces forestiers par un nouveau public citadin en quête de nature et d’espace récréatif. Conscient de ces nouvelles attentes, Huffel (1910), professeur à l’école forestière de Nancy, propose donc d’aménager les massifs domaniaux situés près des grandes villes en vue d’accueillir ce public. À la suite du développement de l’automobile et de l’urbanisation massive des Trente Glorieuses, la fréquentation des forêts augmente au-delà des seules forêts périurbaines, ce qui ravive les tensions entre forestiers et usagers. Pour Mesnil et Minair (1963 : 584), ingénieurs des Eaux et Forêts dans le Nord, les forestiers ont intérêt à garder le contrôle de l’organisation des loisirs s’ils veulent conserver un rapport de force qui leur soit favorable : « Les touristes mêmes inorganisés constituent une force […]. Or si nous laissons cette force agir sans contrôle, le Service forestier risque tôt ou tard d’être évincé de ses propres forêts, du moins mis en tutelle. » Les Premières instructions sur le rôle des forêts dans la civilisation des loisirs (ministère de l’Agriculture, 1964) proposent ainsi d’éduquer et de canaliser le public dans des « zones d’accueil et de séjour ». Pour Bernard Kalaora (1993), ces aménagements visent surtout à attirer les regards des usagers sur les réalisations que les forestiers ont choisies et à brider la liberté d’initiative des usagers. Plutôt que la fréquentation anarchique d’individus qui prennent la forêt pour un espace de liberté, le forestier favorise la pratique familiale ordonnée et autocontrôlée.
Un gouvernement restreint
Une troisième rupture apparaît à la fin des années 1960 autour des acteurs à impliquer dans la gouvernance des forêts. Les enquêtes de fréquentation (SARES, 1969) montrent en effet que, si une majorité d’usagers plébiscitent les aménagements récréatifs, d’autres sont beaucoup plus réticents. Craignant que l’usager ne soit « à nouveau dominé par d’autres qui auront pensé et décidé pour lui » (Idem : 52), le sociologue Robert Ballion propose la création d’un « conseil d’administration social » de la forêt (1975 : 170). Composée de différentes catégories d’usagers, cette structure serait l’intermédiaire entre les gestionnaires et le public. Alors que ce conseil aurait pu désamorcer de futurs conflits, le directeur de l’Office national des forêts (ONF) de Picardie estime que l’organisation de l’accueil du public revient de manière unilatérale aux forestiers, car ils sont « les seuls à connaître la forêt sous tous ses aspects : écologiques, sylvicoles, cynégétiques et même humains » (Jomier, 1976 : 29). Pour Kalaora, cette position montre que « l’aménagement n’est pas seulement une option technique, elle est avant tout un acte politique » (1976 : 74). En s’érigeant comme définisseur des bonnes pratiques et des attentes légitimes, les forestiers espéraient enlever au public la possibilité de peser sur la gestion forestière. De nouveaux protagonistes vont cependant bouleverser cette stratégie au cours de la décennie suivante.
Montée des enjeux environnementaux et remise en cause des savoirs forestiers
Au XIXe siècle, les savoirs forestiers officiels restent l’apanage de l’administration forestière, qui prône une gestion mathématique et quantitative de la forêt, souvent réduite à l’arbre (Decoq et al., 2016). Si Philibert Guinier introduit un cours de botanique à l’école forestière de Nancy dès 1903, l’écologie n’y entre officiellement qu’en 1992 avec la création d’un poste de professeur en phytoécologie forestière. C’est donc avec un temps de retard que les forestiers vont intégrer les préoccupations environnementales qui se développent pourtant depuis le début des années 1970. Ils sont cependant partagés entre leur volonté d’équiper la forêt pour l’accueil du public et celle visant à en conserver le caractère sauvage, comme l’exprime le chef de centre de l’ONF à Fontainebleau : « L’idéal serait que le touriste, guidé inconsciemment, ne s’aperçoive pas de l’intervention du forestier » (de Buyer, 1970 : 793).
Pour les mouvements écologistes naissants, ces faux-semblants ne sont plus concevables. Ils dénoncent l’intensification et la standardisation des méthodes de sylviculture, incarnées par les coupes rases et les enrésinements (Cauwet et al., 1976). Les forestiers répondent par une stratégie de disqualification de leurs opposants, les traitant de « prophètes », leurs idées de « naïves » et la forêt naturelle de mythe « pernicieux et irréalisable » (Bourgenot, 1973 : 359). Comme avec les peintres de Barbizon, ils concèdent la création de réserves biologiques dont ils gardent cependant le contrôle. Quant à l’impact des travaux sylvicoles, il n’est analysé que sous l’angle visuel, leur euphémisation étant codifiée, au cours des années 1980, sous l’expression « paysagisme d’aménagement » (Breman et al., 1992).
Les recherches en écologie vont cependant remettre en question cette posture et replacer les méthodes de sylviculture et leurs impacts au centre des débats, entraînant une quatrième rupture. La question des pluies acides, les discours alarmistes sur l’extinction massive des espèces et l’émergence de la notion de biodiversité finissent par inscrire les enjeux environnementaux dans les préoccupations politiques, notamment lors de la ratification de la Convention sur la diversité biologique, en 1992.
Si des forestiers militent au sein même du ministère de l’Agriculture, de l’ONF ou d’associations professionnelles pour prendre en compte ces questions, d’autres font preuve de résistance. Dans un article intitulé « Quand l’écologie devient nuisance » (1996), Jean Gadant, ancien chef du service des forêts au ministère de l’Agriculture, regrette « le dangereux abandon du débat international sur la forêt à des théoriciens intégristes de l’environnement » (Idem : 409) et conseille de « laisser faire le coup d’oeil du praticien de la sylviculture » (Idem : 406). Alors que les forestiers auraient pu être des producteurs importants de normes environnementales, neuf des principales organisations syndicales forestières, cynégétiques et agricoles françaises s’opposent à la mise en oeuvre de la directive Habitats et des sites Natura 2000, et obtiennent la division par deux de la superficie initialement prévue au classement (Fortier et Alphandéry, 2005). Malgré ces contre-cadrages, le tournant écologique des années 1990-2000 institue peu à peu l’environnement comme un problème social autour duquel tous les projets sociaux doivent être reformulés pour être légitimes (Kalaora, 2001).
Cette écologisation des questions sociales conduit à une inflexion écologique des normes et des pratiques sociales. En forêt, elle se traduit par la reconnaissance du rôle multifonctionnel des forêts dans la loi de 2001, la promulgation d’une stratégie pour la biodiversité, en 2004, la production d’écolabels et d’indicateurs de gestion durable et des changements de pratiques par les forestiers eux-mêmes, tels que la diminution des traitements phytosanitaires, le maintien de bois morts, la gestion d’habitats remarquables, etc.
La forêt, miroir des changements sociaux
L’analyse sociohistorique des conflits passés invite à relativiser les discours contemporains sur le caractère exceptionnel et nouveau des conflits actuels pour questionner la permanence de certains facteurs structurels. Elle montre que, loin d’évoluer dans un vide social, la forêt est affectée par des tensions et des changements structurels qui traversent la société. Il n’est donc pas surprenant que, dans un contexte de transition sociétale, resurgissent des conflits, pour partie chargés de leur passé, mais aussi différents. La relecture de nos travaux empiriques suggère en effet que nous n’assistons ni à une franche rupture ni à une reproduction à l’identique des dynamiques conflictuelles, mais à un processus d’actualisation et d’ajustement permanent. Nous proposons donc d’analyser cette actualisation des facteurs explicatifs des conflits sous le prisme 1) d’un rapport à la nature débouchant sur une écologisation partielle, 2) d’une socialisation distanciée qui accentue les clivages entre sous-univers sociaux, 3) d’une gouvernance inachevée et 4) d’une remise en cause des autorités épistémiques.
Écologisation : du pessimisme environnemental à la modernisation écologique
Si Decoq et al. (2016) nous invitent à juste titre à nous méfier des anachronismes historiques, nous partageons avec eux l’idée que certaines résonances méritent cependant d’être approfondies. Ils constatent ainsi que le discours environnemental dominant du XIXe siècle sur la protection des forêts ne s’opposait pas aux forces du marché ni au processus de l’industrialisation. Il venait au contraire les renforcer dans une visée de transformation et de rationalisation de la société française.
Or, ce registre de justification n’est guère éloigné de celui employé aujourd’hui par les acteurs politiques et les forestiers pour promouvoir la bioéconomie dans un contexte de menace climatique. En revanche, cette problématisation des enjeux environnementaux diffère de celle qui émerge au cours des années 1970-1990. Alors que le « nouveau paradigme environnemental » (Catton et Dunlap, 1978) mettait en avant les dégradations subies par l’environnement, la modernisation écologique et sa déclinaison sectorielle – la bioéconomie forestière – renversent cette perspective en se focalisant sur les processus d’amélioration environnementale (Boudes, 2017). La modernisation écologique ne voit pas la science moderne et la technique comme les responsables des perturbations écologiques et sociales contemporaines, mais comme des institutions centrales pour la réforme et l’écologisation de l’économie (Mol, 2010).
Avec la modernisation écologique, la prise en compte de l’environnement ne serait donc plus un frein à la production, mais une solution pour mieux produire. Les responsables politiques et économiques forestiers ont saisi cette occasion pour effectuer un tournant productif notable au mitan des années 2010 dans un processus d’« intensification écologique ». Dans le programme national de la forêt et du bois 2016-2026 (PNFB), la bioéconomie est ainsi présentée comme une occasion de développement économique (bois de construction, bois-énergie, chimie verte, etc.) légitimée au nom d’objectifs environnementaux globaux comme l’atténuation du changement climatique, le stockage du carbone et la production d’énergie renouvelable (MAAF, 2016). Par cette posture, on entend faire rimer économie et écologie, et on suggère une dépolitisation et un dépassement de la crise écologique sans rupture et sans changement, tout en espérant une neutralisation des rapports sociaux et des conflits afférents (Rudolf, 2013).
Cela n’est pas évident au vu des ambiguïtés de la bioéconomie, laquelle oscille entre préservation des écosystèmes et industrialisation du vivant considéré comme un ensemble de briques élémentaires à optimiser (Pahun et al., 2018). Comme avec la notion de multifonctionnalité, la bioéconomie accentue le surinvestissement et les contradictions dont la forêt fait l’objet depuis 20 ans, à savoir combler le déficit commercial, pourvoir des emplois en milieu rural et jouer un rôle central dans la transition énergétique, tout en préservant la biodiversité et l’accueil de publics très divers. Or, les conflits de légitimité ne se négocient plus seulement entre une fonction de production, d’une part, et environnementale, d’autre part, mais aussi entre les fonctions environnementales elles-mêmes. Vu comme un moyen de réduire la consommation des énergies fossiles, l’effort de mobilisation de la récolte du bois suscite, entre autres, des interrogations en termes d’effets sur la biodiversité (Deuffic et Lyser, 2012). Nos travaux montrent aussi que les promesses d’une redynamisation des territoires ruraux par une filière bois locale compétitive et écologiquement responsable sont remises en question au vu des difficultés industrielles de la première transformation (scieries, papeteries) et de l’intensification des modes de gestion et d’exploitation des ressources forestières (Banos et Dehez, 2017).
L’institutionnalisation de la modernisation écologique aurait aussi pu affaiblir les mouvements sociaux écologistes, cantonnés à un rôle d’accompagnateurs actifs et d’observateurs critiques (Boudes, 2017). Si des organisations non gouvernementales environnementales (ONGE) comme France Nature Environnement n’opposent effectivement pas production et protection de l’environnement, d’autres[2] sont plus réticentes. Celles-ci regrettent que la modernisation écologique ne se traduise que par des aménagements et des innovations techniques visant surtout des gains de productivité et militent, au contraire, pour un bouleversement profond de la structure économique. Sous le terme « malforestation », ils dénoncent la transformation des massifs forestiers en « usines à bois » et l’uniformisation des peuplements aux dépens de forêts diversifiées ; ils s’interrogent aussi sur les réels bénéficiaires de la bioéconomie (D’Allens, 2019). Aux critiques classiques sur les coupes rases et les enrésinements (Moriniaux, 1999), nos travaux ajoutent que ces pratiques introduisent de nouvelles problématiques environnementales comme le raccourcissement des rotations, la disparition des « vieilles forêts », les effets des labours profonds sur la faune et la flore du sol, la récolte des souches et rémanents, etc. Ces ONGE doutent aussi de la sincérité de l’engagement environnemental des acteurs de la filière forestière, dont les actions ne leur semblent pas toujours à la hauteur des enjeux, les accusant de greenwashing ou de sophisme environnemental (Ribereau-Gayon, 2011).
Enfin, la question climatique amplifie ces critiques dont la puissance normative appelle à un réexamen des méthodes de sylviculture et à la nécessité d’une transition, voire d’une transformation plus radicale de la gestion forestière. Les porteurs de revendications environnementales bousculent ainsi la hiérarchie des valeurs en reléguant au second plan la performance économique au profit de notions postmatérialistes telles que celles de bien commun, d’éthique et de responsabilité environnementale et sociétale, de « naturalité », etc. Ils bousculent également les rapports de force traditionnels, car le mouvement écologique est devenu en 20 ans une force politique de gouvernement tant au niveau local que national.
De la communauté locale aux socialisations plurielles
L’analyse sociohistorique souligne que les conflits trouvent aussi leur origine dans une divergence progressive des visions du monde entre groupes sociaux. Ces divergences s’expliquent en partie par la recomposition des acteurs au sein des espaces ruraux et l’évolution de leur processus de socialisation. La socialisation désigne le double mouvement par lequel une société se dote d’acteurs capables de s’intégrer, d’une part, et de produire une action autonome, d’autre part (Dubet et Martuccelli, 1996). Elle se caractérise donc à la fois par une intériorisation et une distanciation vis-à-vis des normes sociales.
Dans le cas des sociétés traditionnelles du XIXe siècle, l’acteur de la communauté était soumis à la collectivité, forgé par elle, peu capable de s’en détacher et dépourvu d’espace d’initiative individuelle. Ce mode de socialisation favorisait des représentations sociales partagées concernant les usages légitimes des espaces agropastoraux et forestiers. Avec la distanciation des modes de socialisation qui prévaut dans les sociétés contemporaines, l’individu acquiert plus d’autonomie, intègre de nouveaux cercles de réflexion et d’action qui peuvent l’amener à s’interroger sur les normes en vigueur (Berger et Luckmann, 1996).
Les usages et les manières légitimes de gérer la forêt ne vont ainsi plus de soi et peuvent être plus facilement remis en question. Sachant qu’aujourd’hui, de 80 à 90 % de la population française se concentre dans des aires urbaines, la socialisation de cette population à la forêt ne s’est généralement pas faite dans le cadre des sociétés rurales. Accusés à tort ou à raison d’ignorer les us et coutumes des populations locales, les néoruraux déstabilisent parfois les arrangements traditionnels en matière de chasse, de cueillette des champignons, de promenade (Banos et Candau, 2006). Ils renouvellent aussi constamment les activités de pleine nature en développant des formes plus sportives et plus ludiques, investissant les espaces hors sentiers, de jour comme de nuit (Granet, 2020). De fait, 68 % des Français considèrent la forêt d’abord comme un espace de nature, la fonction de production n’apparaissant qu’en sixième position, à 39 % (Cordellier et Dobrée, 2017).
Les processus de socialisation fonctionnent toutefois dans les deux sens. Les populations dites rurales sont aussi en partie imprégnées des schèmes d’interprétation de la nature venus de la ville et des médias, au point de délaisser des pratiques traditionnelles comme la chasse. Il est donc réducteur de considérer les conflits actuels comme une réminiscence d’un clivage rural/urbain. L’acquisition, la transmission et le partage des schèmes culturels sont en effet plus complexes et pluriels que cela, et le contexte actuel de transition sous l’effet de menaces globales comme le changement climatique génère de nouveaux clivages, en termes d’usages à prioriser y compris dans le domaine environnemental (Mora et Banos, 2014).
Le profil sociologique des propriétaires forestiers et les modes de socialisation à la forêt ont aussi fortement évolué, épousant les changements démographiques structurels de la population française. Plus âgés et plus urbains, un quart des propriétaires forestiers ne se rendent jamais dans leur forêt (MAAF, 2014). Nos travaux montrent aussi que les sociabilités entre propriétaires forestiers sont moins ancrées au sein des territoires, du fait de l’éloignement géographique, et moins actives que par le passé, hormis au sein de collectifs spécifiques (Deuffic et al., 2018).
Les processus de socialisation ont eux-mêmes beaucoup évolué. Jusqu’après la Seconde Guerre mondiale, la majorité des propriétaires forestiers étaient éduqués à la forêt dès leur enfance au sein même des communautés rurales. Ce mode de socialisation primaire fournissait un stock partagé et commun de représentations et de valeurs. Aujourd’hui, nos travaux montrent que la socialisation des nouvelles générations de propriétaires à la forêt s’effectue souvent à l’âge adulte, depuis la ville et selon des supports de formation très divers. Les plus motivés s’inscrivent dans des groupes de vulgarisation technique, d’autres suivent simplement l’actualité sur Internet ou s’abonnent à des revues de vulgarisation forestière (Lawrence et al., 2020).
Mais cette forme de socialisation dite secondaire, plus diversifiée et malléable, peut être plus aisément mise entre parenthèse (Berger et Luckmann, 1996). Si ce processus d’individualisation et de distanciation émancipe les forestiers des liens sociohistoriques qui les unissent au reste de la société rurale, il entraîne aussi une perte de stabilité et de repères collectifs. L’identification de ces forestiers à une ambition commune telle que promue par le PNFB devient ainsi encore plus relative : si 66 % des propriétaires forestiers sont attachés à leur forêt, 34 % seulement visent la production de bois (MAAF, 2014), ce qui pose question sur leur volonté et leur capacité à utiliser plus de bois et à être « un acteur de la bioéconomie », comme le PNFB les y exhorte pourtant. Ce décalage crée aujourd’hui des tensions au sein même du monde forestier. Certains propriétaires sont stigmatisés, vus comme des forestiers « passifs », accusés de ne pas participer à l’effort de mobilisation, de faire perdurer le morcellement de la propriété en refusant de vendre leurs parcelles et d’être attentistes vis-à-vis des stratégies d’adaptation (Deuffic et al., 2018).
Du gouvernement à la gouvernance : des processus de concertation à la peine
Si l’établissement d’un ordre législatif et réglementaire au cours du XIXe siècle génère une grande asymétrie de pouvoir au profit de l’administration forestière, les contestations des années 1970 ouvrent la voie à une transition d’un gouvernement centré sur les forestiers à une gouvernance multiacteurs (Sergent et al., 2018). Avec l’adossement de la convention d’Aarhus à la constitution française, la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement devient théoriquement la norme. Pourtant, l’élaboration des politiques forestières reste un processus cloisonné, centralisé autour des services forestiers de l’État et des professionnels du secteur forêt bois (Ibid.) Et même si les logiques de type command and control cèdent de plus en plus la place à des arrangements négociés et des outils du type soft law, la production normative issue de ces processus dits de démocratie participative montre que les participants ne disposent pas des mêmes droits, des mêmes ressources et du même poids dans la négociation.
En revanche, les professionnels de la forêt bénéficient toujours d’un accès privilégié aux cénacles de décisions ultimes – en l’occurrence le ministère de l’Agriculture en charge des forêts – ce qui leur permet de contrôler en partie les décisions politiques. Notre recherche sur le travail politique effectué par des scientifiques et des ONGE visant à obliger les propriétaires forestiers à augmenter le taux de bois mort en forêt pour des motifs environnementaux montre ainsi que les organisations forestières ont réussi à limiter radicalement les seuils dans les référentiels de gestion publics (directives ONF) et privés (écocertification du Programme de reconnaissance des certifications forestières [PEFC]) (Deuffic et al., 2016). Il en est de même pour le développement du bois-énergie, secteur où les organisations forestières ont réussi non seulement à canaliser l’arrivée de nouveaux concurrents issus des filières de l’énergie, mais aussi à renforcer leurs positions et à capter d’importants investissements financiers grâce à un intense travail politique en amont et en aval des politiques de transition énergétique (Banos et Dehez, 2017). La multiplication des instances de concertation n’est pas non plus un gage de paix sociale (Torre et al., 2016). Vu la dimension procédurale des conflits, le succès ou l’échec des négociations dépend de la qualité des échanges et du niveau d’écoute entre protagonistes.
Ainsi, au plan national, la rédaction du PNFB a suscité quelques tensions entre le ministère en charge des forêts et l’Autorité environnementale, celle-ci regrettant que « beaucoup de recommandations émises à l’occasion d’un cadrage préalable de l’évaluation environnementale stratégique n’aient pas été reprises et sans pour autant en expliquer les raisons » (CGEDD et AE, 2016 : 4). Cette difficulté à dialoguer sereinement et à atténuer les asymétries de pouvoir se retrouve aussi au niveau local. Instaurées en 2001, les chartes forestières de territoires visaient à faire dialoguer les porteurs d’enjeux dans une même enceinte. Nous avons montré que, dans certains cas, la qualité des débats et d’écoute a permis de définir un projet commun mêlant les objectifs productifs, environnementaux et sociaux de manière équilibrée (Candau et Deuffic, 2011). Dans d’autres cas, les acteurs forestiers ont redéfini les problèmes et les solutions sans nuire à leurs intérêts et délégitimé, voire bloqué, les discussions qui contrevenaient de façon significative à leurs intérêts (Buttoud et al., 2011). De fait, si la gouvernance multiacteurs s’est généralisée, elle atteint ses limites dès lors que les débats portent sur les actes concrets de gestion, l’intérêt général s’effaçant alors devant la défense du droit de propriété.
Du forestier omniscient à la crise de légitimité des autorités épistémiques
Tout au long des XIXe et XXe siècles, l’administration forestière s’est appuyée sur la rationalité des sciences biophysiques et sur l’économie pour justifier son action, notamment le reboisement en montagne, quitte à s’arranger parfois avec les faits (Larrère, 1981). Au cours des Trente Glorieuses, ce processus de rationalisation et d’optimisation de la production mené par les sciences forestières permet d’obtenir des gains de productivité indéniables dans la plupart des forêts françaises. En tant qu’autorité épistémique, les scientifiques détiennent alors le monopole de la définition légitime des problèmes, au point d’apparaître parfois omniscients (Decoq et al., 2016), et quand survient une crise, la faute est souvent imputée à la nature. La répétition des crises environnementales ébranle toutefois ce schéma de légitimation de la science, de la technique et du marché en remettant en question la vision prométhéenne des tenants du progrès et de la logique marchande. La foi dans la science se mue petit à petit en illusion du contrôle car, si les scientifiques sont toujours sollicités pour leur expertise, le progrès devient à la fois la solution et la cause du problème, y compris en forêt (Banos et Deuffic, 2020).
De façon plus générale, le panel des producteurs de référentiels du secteur forêt-bois s’est élargi, bousculant les équilibres institutionnels et politiques classiques. À un niveau global, on assiste à l’internationalisation des producteurs de normes économiques et juridiques dans le domaine forestier (Redd+, marché du carbone) et environnemental (Convention sur la diversité biologique, Pacte vert pour l’Europe) sans qu’il y ait toujours une mise en cohérence des politiques publiques. Par rapport aux années 1970, les porteurs de revendications ont aussi évolué. À côté des précurseurs comme le Fonds mondial pour la nature, Greenpeace ou France Nature Environnement, de nouvelles organisations sont apparues au niveau national, telles que Canopée - Forêts vivantes, SOS Forêts, le Réseau pour les alternatives forestières, etc.
Les dirigeants de ces associations sont des forestiers, dans certains cas, dépassant ainsi le clivage traditionnel entre écologistes et acteurs de la filière bois. Au niveau local, le tissu d’associations environnementales régionales s’est aussi renforcé et professionnalisé, développant des compétences dans le domaine de l’écologie et de la sylviculture. Nos travaux montrent que, relais autant que pourvoyeuses d’informations, ces associations contribuent à la catégorisation, l’objectivation, la production de connaissances et, grâce à leur travail en réseau, à la généralisation et à la médiatisation de problèmes qui, auparavant, paraissaient isolés ou contingents (Deuffic et al., 2016). Depuis les lois de décentralisation, les acteurs politiques territoriaux (communautés de communes, conseils départementaux et régionaux) interviennent aussi sur le volet forestier des politiques d’aménagement. Enfin, de nouveaux acteurs économiques issus du secteur de la construction ou de l’énergie s’invitent dans le débat sur l’avenir des forêts françaises. Or, nos recherches montrent que les industriels de la forêt et du bois considèrent ces nouveaux acteurs tout autant comme des menaces que comme des modèles de développement en termes de compétitivité économique, de création de valeur ajoutée et de lobbying politique. Intégrer, voire adopter, les normes et les règles du jeu de ces secteurs économiques leur apparaît de plus en plus comme une condition pour continuer à « peser » dans les débats (Banos et Dehez, 2017)
Des voies variées de résolution des conflits : communiquer, négocier, changer
Depuis deux siècles, les stratégies de résolution des conflits des forestiers ont consisté soit à tenir les usagers à l’écart, soit à leur faire accepter les opérations sylvicoles par l’éducation et l’information. Depuis quelques années, c’est la notion d’acceptabilité qui est mise en avant. Parfois résumée à l’art de « faire avaler la pilule », elle est suspectée de vouloir désamorcer les contestations et de forcer la décision. Mais on peut aussi la définir de manière plus constructive comme un processus d’évaluation politique d’un projet sociotechnique qui met en interaction une pluralité d’acteurs impliqués à diverses échelles et à partir duquel se construisent des règles et des arrangements institutionnels reconnus comme légitimes par les parties prenantes (Fournis et Fortin, 2015). Un gradient de dénouement des conflits apparaît ainsi entre des solutions qui visent à améliorer la communication entre protagonistes, d’autres à améliorer les procédures de négociation des arrangements institutionnels, et d’autres enfin qui visent la substance même du conflit en faisant évoluer les pratiques de gestion controversées.
Communiquer de manière unilatérale, un retour au catéchisme forestier ?
Face aux contestations publiques, une partie des forestiers continue de croire au modèle du déficit de connaissances et mise donc sur des campagnes de communication censées éclairer le profane. Dans les années 1960, ce type de campagne était désigné par le terme « propagande forestière » et visait à « obtenir de l’opinion une orientation favorable à notre cause en lui faisant comprendre le double rôle de production et de protection de la forêt » (Benda, 1959 : 259). Soixante ans plus tard, les objectifs de ces campagnes restent peu ou prou les mêmes, c’est-à-dire « expliquer à ceux qui ne connaissent pas la forêt que nos pratiques ne sont pas dangereuses pour l’environnement » (D’Amécourt et Le Bouler, 2020 : 26).
Ce positionnement est à la fois défensif, puisqu’il s’agit de légitimer l’action du forestier, et offensif puisque la contre-attaque consiste à semer le doute et disqualifier « les profanes ». Dans ce modèle de communication à sens unique (Rice et Atkin, 2013), un « émetteur » envoie « un message » à un « récepteur » via un « support de communication », ce qui déclenche théoriquement un « changement d’opinion ou de comportement ». Si ce type de communication peut améliorer les connaissances des publics cibles, il semble en revanche avoir peu d’effets en matière de changement de comportements et, encore moins, de valeurs (Snyder et al., 2020). Chacune des composantes de ce modèle a en effet ses limites. Les émetteurs peuvent avoir des objectifs différents, le message manquer sa cible, le récepteur être saturé d’informations ; enfin, les effets s’avèrent souvent difficilement évaluables.
C’est pourtant ce modèle de communication « balistique » que l’organisation interprofessionnelle France Bois Forêt (FBF) choisit, en 2016, pour redorer l’image de la filière auprès du grand public. Cette « offensive communicationnelle » visait à « prévenir les risques de protestation du public contre l’exploitation des forêts » (CGAAER, 2017 : 5), donnant l’impression de forestiers sur la défensive et inquiets de perdre la bataille de l’opinion. Dans une note interne, la fédération des syndicats de propriétaires forestiers fournit aussi des éléments de langage pour expliquer le travail des forestiers au public et aux journalistes. Au lieu de « coupe rase », elle conseille de privilégier les termes « coupe de renouvellement » ou « récolte ». Ces changements ne sont pas que sémantiques. Une lettre ouverte signée par un collectif de forestiers, de scientifiques et de politiques appelle ainsi à ne pas « se tromper de combat » et désigne un « ennemi commun, et de taille : le changement climatique ». Le recentrage de la définition légitime du problème autour du changement climatique permet de neutraliser les critiques sur la gestion forestière, de déporter les attaques sur des humains (les forestiers) vers des entités non humaines (le climat, les maladies) et de transcender les divisions en rassemblant les protagonistes autour d’un objectif commun.
Communiquer de manière symétrique et favoriser la concertation
Une autre modèle de communication, dit à double sens, suggère une approche moins descendante et plus inclusive (Rice et Atkin, 2013). Il repose sur un principe de symétrie où la définition des objectifs de l’action bénéficie à tous les groupes en présence et où la construction des messages se fait ensemble, abandonnant la hiérarchie entre émetteur et récepteur. Dans cette optique, l’instigateur de la campagne cherche la médiation plutôt que la persuasion à tout prix. Il agit comme un négociateur qui communique et informe en vue de gérer le conflit et veille à ce que les protagonistes s’accordent sur les messages à diffuser.
Ce modèle semble partiellement adopté par le ministère en charge des forêts, qui préconise désormais « d’entreprendre un programme de communication co-construit avec les ONG environnementalistes et les associations d’usagers de forêt, permettant au ministère d’occuper plus sereinement le terrain médiatique » (CGAAER, 2017 : 6).
Ce type de communication qui suggère la construction d’arrangements institutionnels par la concertation recoupe en partie la notion d’acceptabilité telle que définie par Fournis et Fortin (2015). Cette notion peut alors être plus qu’une boîte à outils prête à l’emploi, à condition qu’on en applique quelques principes (Batelier, 2016) : ne pas chercher à éviter à tout prix le conflit car il peut être porteur de solutions novatrices, veiller à ce que le processus de prise de décision ne soit pas pré-cadré mais public, rigoureux et juste afin d’éviter l’instrumentalisation de la participation, ne pas non plus considérer les opposants comme souffrant d’un déficit de connaissances, d’autant qu’ils sont capables aujourd’hui de s’informer rapidement par les réseaux sociaux.
Plutôt que d’ignorer ou de disqualifier la critique et d’opposer le droit de propriété comme fin de non-recevoir, une forme plus aboutie de l’acceptabilité consiste donc à partager l’information et les savoirs, et à faire des concessions de part et d’autre. La structure institutionnelle du partenariat importe peu ; il s’agit surtout de veiller à un équilibre entre les rapports de force des différentes parties prenantes et d’éviter ainsi de marginaliser les groupes les moins pourvus de ressources, lors des discussions. Cette volonté de relancer les processus de concertation et de débattre plus sereinement a été exprimée récemment par deux importantes organisations forestières et environnementales françaises (D’Amécourt et Le Bouler, 2020). Mais ce rapprochement par modification du régime d’alliance peut aussi être vu comme un moyen de ne pas être débordé par des acteurs plus virulents. Par ailleurs, certains conflits nécessitent plus de temps, en particulier lorsque qu’ils portent sur des valeurs éthiques ou morales. Ce type de conflit est plus complexe à résoudre, car il touche au fondement même des sociétés et des groupes qui les composent. Enfin, faute d’accord sur un mode de gestion partagée, certains collectifs environnementaux préfèrent acquérir des forêts afin de les gérer selon leurs principes, passant du statut d’observateur critique extérieur à celui de gestionnaire direct et engagé de la forêt (Nahapétian, 2020).
S’attaquer au fond du problème
Quant aux actions qui s’attaquent à la racine et à la substance même des conflits, elles sont plus ou moins ambitieuses, la réponse pouvant être technique, mais aussi juridique et politique. À cet égard, l’évolution des droits d’usage et de propriété témoigne de philosophies politiques différentes. Quand la France a fait le choix d’un droit de propriété très exclusif, les pays scandinaves ont institué le « droit à la nature pour tous », y compris le droit de bivouac, de cueillette, de randonnée à pied, etc. La contrepartie de ce droit d’accès repose sur une responsabilité environnementale individuelle et des règles éthiques comme le respect de la vie privée du propriétaire et de son environnement (Girault, 2018). Les sociétés scandinaves préfèrent donc l’inclusion du collectif à l’exclusion du privatif. Elles font le pari que le libre accès induit des rétroactions positives où la valorisation collective de l’environnement entraîne une responsabilisation individuelle à son égard permettant d’éviter la tragédie des communs.
En France, le choix d’un droit de propriété plus exclusif a été fait à la Révolution, et ses fondements n’ont guère évolué depuis. Si les propriétaires forestiers peuvent interdire l’accès à leur propriété et la récolte de produits non ligneux, des marges de manoeuvre et une certaine tolérance existent cependant au niveau local, qu’il s’agisse de cueillir une quantité « raisonnable » de champignons ou de traverser une parcelle à pied (Mora et Banos, 2014). De fait, les forêts françaises sont largement accessibles au public, y compris la forêt privée. Cette fréquentation ne pose aucun problème pour 86 % des propriétaires forestiers, 3 % seulement estimant que cela engendre beaucoup de désagréments (MAAF, 2014). Du côté des usagers, les tensions ne viennent pas tant des relations avec les forestiers qu’avec les autres usagers dont certains comportements sont dénoncés (dépôt d’ordures, véhicules motorisés, chasse, etc.) (Dehez, 2012).
Concernant les questions environnementales, les responsables politiques forestiers les ont aussi intégrées au coeur même des outils de gestion forestière. Au mitan des années 1990, le ministère de l’Agriculture a promulgué une batterie d’indicateurs de gestion (Barthod, 2012). Il a rendu obligatoire la description des caractéristiques environnementales des parcelles dans les plans simples de gestion (PSG) et proposé une adhésion volontaire au code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). En parallèle, les forestiers privés ont créé une certification environnementale volontaire (PEFC). En internalisant la contrainte écologique, les promoteurs de ces écolabels voulaient anticiper des réglementations environnementales plus contraignantes et améliorer l’image de la filière, même si leur processus d’évaluation a parfois été mis en cause.
Sur un plan pratique, certaines opérations sylvicoles conflictuelles tendent à disparaître des référentiels techniques. Un des changements les plus significatifs concerne le passage à la futaie irrégulière, et donc la fin des coupes rases dans les forêts publiques d’Île-de-France décrétée officiellement par l’ONF en 2017. Ce changement de doctrine peut être vu comme une forme de renoncement réalisé sous la pression des associations ou, au contraire, comme une forme d’innovation sociale où la prise en compte des aspirations sociétales entraîne des innovations sylvicoles.
Nos enquêtes montrent également que d’autres changements s’opèrent sur le terrain sans que les référentiels normatifs officiels ne l’imposent vraiment, qu’il s’agisse de l’utilisation moindre de produits phytosanitaires ou de la conservation d’éléments de biodiversité non officiellement répertoriés (arbres morts ou à cavités, espèces secondaires, habitats pour la faune locale, etc.) (Deuffic et al., 2012). Une partie des forestiers internalise donc d’elle-même les nouvelles règles du jeu qui, même tacites, définissent ce qui est raisonnable, tolérable et admis collectivement. En faisant ainsi preuve de perspicacité et d’une capacité à adopter les codes sociaux des autres acteurs territoriaux, les forestiers se protègent d’éventuels conflits et évitent le stigmate social de la « négligence environnementale ». Pour peu qu’ils atteignent leurs objectifs économiques et environnementaux, ils peuvent même apparaître comme une nouvelle élite forestière à l’avant-garde d’une sylviculture « en transition ». D’autres propositions demeurent cependant des lignes rouges pour certaines organisations forestières, comme la limitation de la superficie des coupes rases, l’abandon de la récolte mécanisée ou de la régénération par plantation.
Conclusion
Par notre réflexion, nous visons à proposer une grille d’analyse réactualisée des facteurs de conflictualité en forêt afin de comprendre les controverses qui resurgissent depuis quelques années sur la gestion des forêts françaises. En relisant l’historique de ces conflits sous un angle sociologique, nous voyons d’abord une certaine continuité dans l’imposition de représentations et de modes de gestion des forêts aboutissant à une déterritorialisation et à l’exclusion des communautés locales (Decoq et al., 2016). Mais ces conflits ont aussi permis de redéfinir une partie du contrat social entre les forestiers et la société. Les restrictions des droits d’usage se sont assouplies en faveur du public – mêmes si ces droits restent très encadrés – et on ne s’affronte plus physiquement pour un morceau de bois mort ou quelques champignons. De nouvelles revendications ont cependant vu le jour autour de la fourniture de services écosystémiques et l’appel de certaines ONGE à faire de la forêt un « bien commun », ce qui suscite des tensions avec les organisations représentatives de la forêt privée. Ces conflits reflètent aussi les évolutions structurelles qui affectent la société française : l’arrivée de néoruraux, l’éloignement et le vieillissement des propriétaires forestiers, un meilleur accès à l’information, un intérêt croissant de la population pour la forêt et l’environnement, ainsi qu’un pluralisme et une nouvelle hiérarchisation des valeurs qui suggèrent plusieurs voies possibles pour la transition écologique.
Un autre changement significatif tient au regard porté sur les pratiques respectives des forestiers et des usagers. Là où les pratiques des populations rurales étaient autrefois dénoncées par l’administration forestière, ce sont aujourd’hui les méthodes de sylviculture qui sont remises en cause. Les procès en légitimité et les stigmates du « bon » ou du « mauvais » comportement en forêt se sont donc inversés et paraissent plus équilibrés. Ces transitions sociales et culturelles bousculent le vivre-ensemble en forêt et sont à l’origine de conflits, mais elles ne sont pas forcément que des moments tragiques. Les conflits constituent des indicateurs d’adhésion ou de résistance à l’innovation et au changement, et sont en quelque sorte des laboratoires de la décision et de l’acceptabilité (Torre et al., 2016).
L’analyse sur le temps long des conflits forestiers montre aussi qu’à force de tenir à distance les autres groupes sociaux – agriculteurs, ayants-droit, usagers, citadins, environnementalistes – et plutôt que de s’en faire des alliés, les forestiers, au sens large, se sont retrouvés de plus en plus isolés, ne discutant plus que dans l’entre-soi de leurs institutions de tutelle et des acteurs de la filière. Cette mise à distance s’est parfois doublée d’une attitude surplombante, voire condescendante, notamment quand il s’agissait de discuter de gestion forestière. Jouant de la distinction entre « sachants » et « non-sachants », les forestiers ont, sous couvert de partage du savoir, cherché à orienter l’action et les représentations en matière forestière par des formes de communication à sens unique, au moins jusqu’à la fin du XXe siècle. Aujourd’hui, cela évolue, les savoirs et la communication de l’information étant de plus en plus souvent discutés, voire coconstruits, entre partenaires forestiers et non forestiers.
Alors que les désaccords se réglaient autrefois devant les tribunaux, les modes de résolution des conflits ont aussi évolué vers des processus plus démocratiques, même si des asymétries de pouvoir, d’accès et de légitimité au sein des arènes décisionnaires demeurent. Aujourd’hui, les instances de gouvernance forestière s’ouvrent à de nouveaux acteurs et les conflits se règlent autour d’une table où les protagonistes peuvent négocier des solutions honorables pour les parties prenantes, même si des incompréhensions et des réflexes hérités du passé demeurent. Si notre réflexion pose donc les bases d’une grille analytique reliant conflits passés et présents, facteurs de permanence et de changement, celle-ci mérite d’être amendée et approfondie par de nouveaux programmes de recherche ciblés sur les conflits forestiers afin de mieux cerner leur dynamique propre et leur inscription spécifique dans les territoires.
Parties annexes
Notes
Bibliographie
- ASSEMBLÉE NATIONALE (2020) Proposition de loi visant à l’encadrement des coupes rases. 15 septembre 2020, no 3314 [En ligne]. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3314_proposition-loi
- BALLION, Robert (1975) La fréquentation des forêts. Revue forestière française, vol. 27, no 2, p. 155-170.
- BANOS, Vincent et CANDAU, Jacqueline (2006) Recomposition des liens sociaux en milieu rural : de la fréquentation d’espaces à la production de normes collectives ? Espaces et Sociétés, vol. 127, no 4, p. 97-112.
- BANOS, Vincent et DEHEZ, Jeoffrey (2017) Le bois-énergie dans la tempête, entre innovation et captation ? Les nouvelles ressources de la forêt landaise. Natures Sciences Sociétés, vol. 25, no 2, p. 122-133.
- BANOS, Vincent et DEUFFIC, Philippe (2020) Après la catastrophe, bifurquer ou persévérer ? Les forestiers à l’épreuve des événements climatiques extrêmes. Nature Sciences Sociétés, vol. 28, nos 3-4, p. 226-238.
- BARTHOD, Christian (2012) Aux origines des indicateurs de gestion durable des forêts. Revue forestière française, vol. 64, no 5, p. 551-560.
- BATELIER, Pierre (2016) Acceptabilité sociale des grands projets à fort impact socio-environnemental au Québec : définitions et postulats. VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 16, no 1 [En ligne]. https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2016-v16-n1-vertigo02678/1037565ar/
- BENDA, Paul (1959) La propagande en matière forestière. Revue forestière française, p. 259-262.
- BERGER, Peter et LUCKMANN, Thomas (1996) La construction sociale de la réalité. Paris, Armand Colin.
- BOUDES, Philippe (2017) Changement social et écologie : où en est la modernisation écologique ? Socio-logos, no 12 [En ligne]. http://journals.openedition.org/socio-logos/3142
- BOURGENOT, Louis (1973) Forêt vierge et forêt cultivée. Revue forestière française, vol. 25, no 5, p. 339-360.
- BREMAN, Peter, MOIGNEU, Thierry et LAVERNE, Xavier (1992) Directives paysagères pour la région Île-de-France. Fontainebleau, Office national des forêts.
- BUTTOUD, Gérard, KOUPLEVATSKAYA-BUTTOUD, Irina, SLEE, Bill et WEISS, Gerhard (2011) Barriers to institutional learning and innovations in the forest sector in Europe: Markets, policies and stakeholders. Forest Policy and Economics, vol. 13, no 2, p. 124-131.
- CANDAU, Jacqueline et DEUFFIC, Philippe (2011) Une concertation restreinte pour définir l’intérêt général des espaces forestiers. Regard sur un paradoxe. VertigO - la revue électronique en sicneces de l’environnement, no 6 [En ligne]. https://www.erudit.org/en/journals/vertigo/2009-v9-n3-vertigo3895/044556ar/
- CATTELOT, Anne-Laure (2020) La forêt et la filière bois à la croisée des chemins : l’arbre des possibles. Paris, Assemblée nationale.
- CATTON Jr., William R. et DUNLAP, Riley E. (1978) Environmental sociology: A new paradigm. The American Sociologist, vol. 13, no 1, p. 41-49.
- CAUWET, Jean, DEMESSE, Nicole, FISCHER, Roger et PERSUY, Alain (1976) France, ta forêt fout le camp ! Paris, Stock.
- CHATEAURAYNAUD, Francis (2015) Pragmatique des transformations et sociologie des controverses. Les logiques d’enquête face au temps long des processus. Dans Francis Chateauraynaud et Yves Cohen (dir.) Histoires pragmatiques. Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, p. 349-385.
- CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DES ESPACES RURAUX (CGAAER) (2017) Plan de communication pour le secteur de la forêt et du bois. Paris, CGAAER.
- CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGEDD) et AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (AE) (2016) Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le programme national de la forêt et du bois 2016-2026. Paris, CGEDD et AE.
- CORDELLIER, Maxime et DOBRÉE, Michelle (2017) Usages et images de la forêt en France, Enquête « forêt et société », novembre 2015. Caen, Université de Caen, CEEReV et Office national des forêts, rapport de recherche.
- D’ALLENS, Gaspard (2019) Main basse sur nos forêts. Paris, Seuil.
- D’AMÉCOURT, Antoine et LE BOULER, Hervé (2020) D’évidentes passerelles avec l’environnement. Forêts de France, no 637, p. 23-26.
- De BUYER, Xavier (1970) La pression de l’homme sur la forêt. Revue forestière française, vol. 22, p. 792-796.
- DECOQ, Guillaume, KALAORA, Bernard et VLASSOPOULOS, Chloé (2016) La forêt salvatrice. Paris, Éditions Champ Vallon.
- DEHEZ, Jeoffrey (2012) Ouverture des forêts au public. Un service récréatif. Versailles, Quae.
- DEUFFIC, Philippe, ARTS, Bas J. M. et SOTIROV, Metodi (2018) “Your policy, my rationale”. How individual and structural drivers influence European forest owners’ decisions. Land Use Policy, no 79, p. 1024-1038.
- DEUFFIC, Philippe, BOUGET, Christophe et GOSSELIN, Frédéric (2016) Trajectoire sociopolitique d’un indicateur de biodiversité forestière : le cas du bois mort. VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 16, no 2 [En ligne]. https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2016-v16-n2-vertigo02855/1038176ar.pdf
- DEUFFIC, Philippe, GINELLI, Ludovic, BALLON, Philippe et GOSSELIN, Frédéric (2012) La biodiversité forestière, un nouveau référentiel pour les forestiers et les chasseurs ? Dans Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot-Julliard (dir.) L’exigence de réconciliation. Biodiversité et société. Paris, Fayard, p. 129-142.
- DEUFFIC, Philippe et LEWIS, Nathalie (2012) La forêt ré-enchantée. Deux siècles d’évolution sociale des loisirs en forêt. Dans Jeofrey Dehez (dir.) Ouverture des forêts au public. Un service récréatif. Versailles, Quae, p. 17-41.
- DEUFFIC, Philippe et LYSER, Sandrine (2012) Biodiversity or bioenergy: Is deadwood conservation an environmental issue for French forest owners? Canadian Journal of Forest Research, vol. 42, no 8, p. 1491-1502.
- DROUET, François-Xavier (2018) Le temps des forêts. Nouvelle-Aquitaine, Atelier documentaire et Centre national du cinéma et de l’image animée, 103 min.
- DUBET, François et MARTUCCELLI, Danilo (1996) Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l’école. Revue française de sociologie, no 37, p. 511-535.
- ECKERBERG, Katarina et SANDSTRÖM, Camilla (2013) Forest conflicts: A growing research field. Forest Policy and Economics, no 33, p. 3-7.
- FORTIER, Agnès et ALPHANDÉRY, Pierre (2005) Négociations autour de la biodiversité : la mise en oeuvre de Natura 2000 en France. Dans Pascal Marty, Franck-Dominique Vivien, Jacques Lepart et Raphaël Larrère (dir.) Les biodiversités. Objets, théories, pratiques. Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, p. 227-240.
- FOURNIS, Yann et FORTIN, Marie-José (2015) Une définition territoriale de l’acceptabilité sociale : pièges et défis conceptuels, VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 13, no 3 [En ligne]. http://vertigo.revues.org/16682
- GADANT, Jean (1996) Quand l’écologie devient nuisance. Revue forestière française, vol. 48, no 5, p. 403-415.
- GIRAULT, Camille (2018) Le droit d’accès à la nature en Europe du Nord : partage d’un capital environnemental et construction d’un espace contractuel. VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. hors-série, no 29 [En ligne]. https://journals.openedition.org/vertigo/19034
- GRANET, Anne-Marie (2020) Compte-rendu de la table ronde : émergence de nouveaux loisirs en forêt. Cahier du GHFF Forêt, environnement et société, no 30, p. 53-56.
- GUINIER, Ernest (1893) L’esthétique dans le traitement des bois. Revue des eaux et forêts, no octobre, p. 433-444.
- HUFFEL, Gustave (1910) Esthétique forestière. Économie forestière. Paris, Lucien Laveur.
- JOMIER, Jean (1976) Aménagement touristique des forêts domaniales du Nord-Pas-de-Calais. Revue forestière française, vol. 28, no 1, p. 21-29.
- KALAORA, Bernard (1976) Quelques problèmes de l’aménagement de la forêt péri-urbaine. Cas de la forêt de Fontainebleau. Revue forestière française, vol. 28, no 1, p. 69-74.
- KALAORA, Bernard (1993) Le musée vert. Radiographie du loisir en forêt. Paris, L’Harmattan.
- KALAORA, Bernard (2001) À la conquête de la pleine nature. Ethnologie française, vol. 31, no 4, p. 591-597.
- KALAORA, Bernard et SAVOYE, Antoine (1986) La forêt pacifiée : sylviculture et sociologie au XIXe siècle. Paris, L’Harmattan.
- LARRÈRE, Raphaël (1981) L’emphase forestière : adresse à l’Etat. Recherches, no 45, p. 115-153.
- LARRÈRE, Raphaël, BRUN, A, KALAORA, Bernard, NOUGAREDE, Olivier et POUPARDIN, Dominique (1980) Reboisement des montagnes et systèmes agraires. Revue forestière française, vol. 32, no spécial, p. 20-36.
- LARRÈRE, Raphaël et NOUGARÈDE, Olivier (1993) Des hommes et des forêts. Paris, Gallimard.
- LAWRENCE, Anna, DEUFFIC, Philippe, HUJALA, Teppo, NICHIFOREL, Liviu, FELICIANO, Diana et al. (2020) Extension, advice and knowledge systems for private forestry: Understanding diversity and change across Europe. Land Use Policy, vol. 94, no 104522 [En ligne]. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104522
- MESNIL, Hubert et Minair, Robert (1963) Le tourisme et la forêt dans le nord de la France. Revue forestière française, vol. 15, no 7, p. 580-593.
- MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE (1964) Premières instructions sur le rôle des forêts dans la civilisation des loisirs. Paris, Ministère de l’agriculture.
- MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT (MAAF) (2014) Enquête sur la structure de la forêt privée en 2012. Agreste chiffres et données – Agriculture, no 222, p. 1-78.
- MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT (MAAF) (2016) Programme national de la forêt et du bois 2016-2026. Paris, MAAF.
- MOL, Arthur P. J. (2010) Ecological modernization as a social theory of environmental reform. Dans Michael R. Redclift et Graham Woodgate (dir.) International handbook of environmental sociology. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, p. 63-76.
- MORA, Olivier et BANOS, Vincent (2014) La forêt des Landes de Gascogne : vecteur de liens, VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 14, no 1 [En ligne]. http://vertigo.revues.org/14631
- MORINIAUX, Vincent (1999) Les Français face à l’enrésinement, XVIe-XXe siècles. Annales de Géographie, vol. 108, nos 609-610, p. 660-663.
- MORMONT, Marc (2006) Conflit et territorialisation. Géographie, économie, société, vol. 8, no 3, p. 299-318
- NAHAPÉTIAN, Naïri (2020) Quand les citoyens s’emparent de la forêt. Alternatives économiques, no 397, p. 97-99.
- PAHUN, Jeanne, FOUILLEUX, Eve et DAVIRON, Benoît (2018) De quoi la bioéconomie est-elle le nom ? Genèse d’un nouveau référentiel d’action publique. Natures Sciences Sociétés, vol. 26, no 1, p. 3-16.
- RIBEREAU-GAYON, Marie-Dominique (2011) La légitimité de la forêt des Landes de Gascogne du XIXe siècle à la tempête de 2009. Dans Collectif, Tempêtes sur la forêt landaise. Histoires, mémoires. Langon, L’Atelier des Brisants, p. 165-183.
- RICE, Ronald E. et ATKIN, Charles K. (2013) Public communication campaigns. Thousand Oaks, Sage.
- RUDOLF, Florence (2013) De la modernisation écologique à la résilience : un réformisme de plus ? VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 13, no 3 [En ligne]. https://journals.openedition.org/vertigo/14558
- RUI, Sandrine (2011) Conflit. Dans Serge Paugam (dir.) Les 100 mots de la sociologie. Paris, Presses universitaires de France, p. 54-55.
- SOCIÉTÉ DE RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIOLOGIQUE EN AGRICULTURE (SARES) (1969) Étude de la fréquentation des forêts de la région parisienne. Paris, SARES.
- SERGENT, Arnaud, ARTS, Bas et EDWARDS, Peter (2018) Governance arrangements in the European forest sector: Shifts towards ‘new governance’ or maintenance of state authority? Land Use Policy, no 79, p. 968-976.
- SIMMEL, Georg (2003) Sociologie : études sur les formes de la socialisation. Paris, Presses universitaires de France, [1908].
- SNYDER, Stephanie A., MA, Zhao, FLORESS, Kristin et CLARKE, Mysha (2020) Relationships between absenteeism, conservation group membership, and land management among family forest owners. Land Use Policy, vol. 91, no 104407 [En ligne]. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104407
- TORRE, André, KIRAT, Thierry, MELOT, Romain et VU PHAM, Hai (2016) Les conflits d’usage et de voisinage de l’espace. Bilan d’un programme de recherche pluridisciplinaire. L’Information géographique, vol. 80, no 4, p. 8-29.
- VIDALOU, Jean-Baptiste (2017) Être forêts. Habiter des territoires en lutte. La Découverte, Paris.
- WALKER, Gregg B. et DANIELS, Steven E. (1997) Foundations of natural resource conflict: Conflict theory and public policy. Dans Birger Solberg et Saija Miina (dir.) Conflict management and public participation in land management. Proceedings 14. Joensuu, Finland, European Forest Institute, p. 13-36.