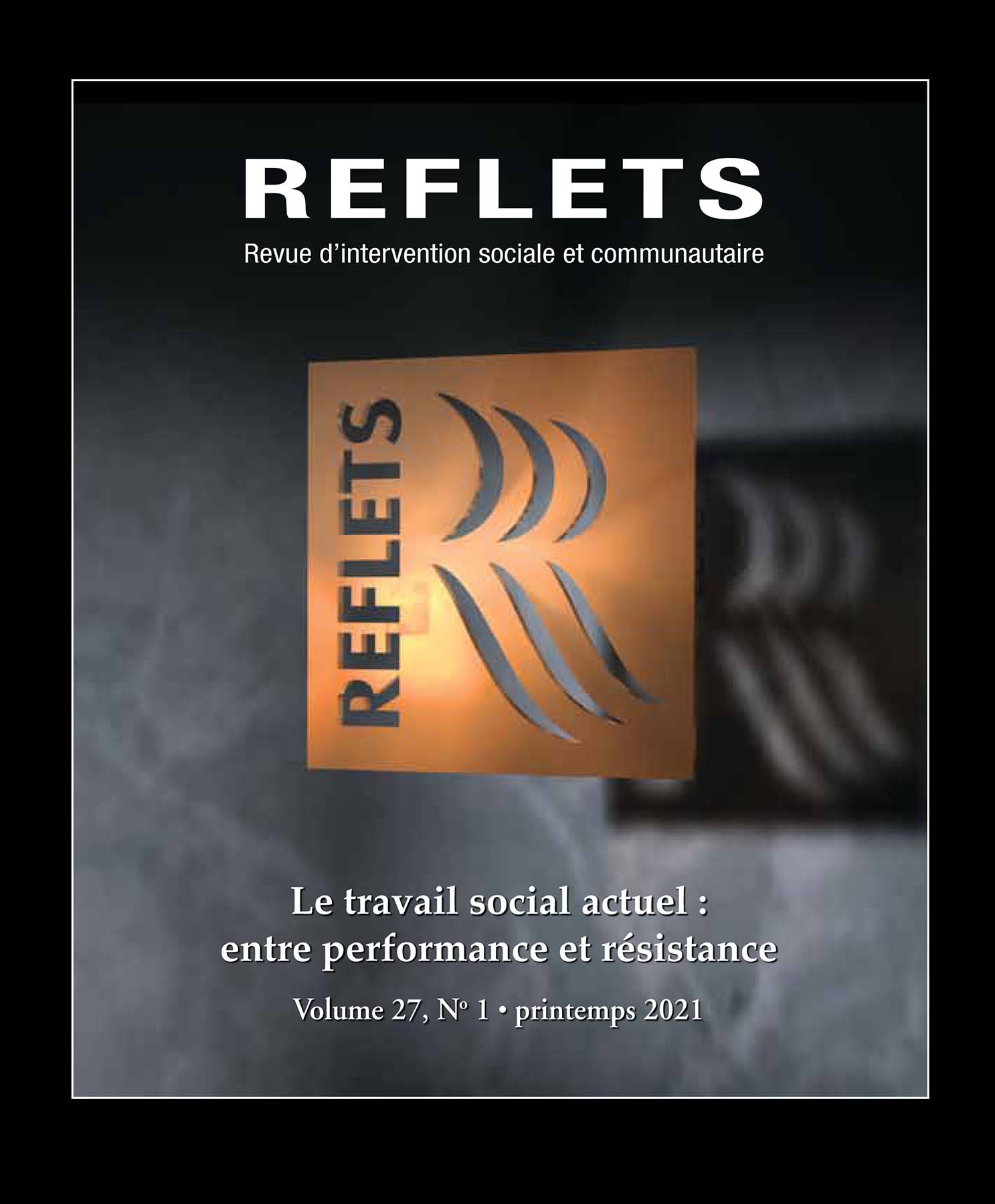Article body
Introduction
Passionnée de justice sociale et impliquée dans diverses communautés depuis une douzaine d’années, je constate à chaque fois, un peu plus, les ravages des inégalités sociales sur la santé physique, mentale et spirituelle des êtres humains. Les inégalités socioéconomiques constituent un réel enjeu de santé publique. Avec l’approche anti-oppressive en psychothérapie qu’utilisent un nombre grandissant de travailleurs sociaux, ces derniers se retrouvent aux premières lignes pour en témoigner et agir pour contrer ces inégalités.
Ravon et coll. (2008) soulevaient le décalage entre les valeurs de justice sociale des T.S. fraichement sortis des écoles et les milieux de pratique pour expliquer l’épuisement des professionnels. Cette explication a le mérite de nous éloigner des discours « martyrisant » ou « psychiatrisant » de la profession, en plus de nous inviter à reconceptualiser la notion de loyauté vis-à-vis de notre employeur. Si les intervenantes sociales restent et valsent avec les aléas du travail communautaire, ce n’est pas parce qu’elles/ils sont plus gentil.le.s ou fait.e.s plus fort.e.s. C’est plutôt qu’elles/ils sont dans des milieux dont les gestionnaires reconnaissent et comprennent l’oppression structurelle. Faisant écho à Ravon et coll. (2008) lorsque les principes et actions d’un organisme sont chapeautés par la Justice sociale et que lignes directrices pour la pratique vont dans le même sens, les travailleuses et travailleurs sont légitimé.e.s dans leurs actes de résistance et de solidarité. Nous sentir écouté.e, accepté.e et apprécié.e dans ce que nous croyons et défendons n’est pas seulement important pour les gens que nous accompagnons, mais c’est aussi vital pour notre sentiment de satisfaction au travail. La gestionnaire de l’unité familiale du groupe de thérapie pour lequel je travaille (et que j’ai eu la chance d’avoir pour mentor clinique) est une travailleuse sociale de formation, tout comme la fondatrice de l’ensemble des programmes de thérapie de mon organisme. Une vision simple : rendre accessible la psychothérapie pour les populations les plus vulnérables de la vile d’Ottawa, une vision qui trouve ses racines dans la justice sociale.
En tant que de travailleuse sociale « nouvelle génération », j’ai « magasiné » l’organisme ou j’allais « vendre » mes services à mes « clients », à savoir les gens que j’accompagnerais. Cette liberté, legs du monde capitaliste dans lequel nous vivons, constitue mon moyen premier de résistance : choisir l’organisation en fonction de la complémentarité entre les valeurs de justice sociale qui me sont chères et les valeurs dominantes de l’organisation et les personnes qui la composent. Dans ce nouveau rapport à l’emploi, je considère que le changement social est mon employeur, le réel indicateur de performance de ma pratique.
C’est dans cette perspective que la jeune travailleuse sociale que je suis est tout bonnement tombée en amour avec l’approche narrative (liée au constructivisme) en thérapie. Cette approche et ses outils me permettent de pratiquer la psychothérapie tout en continuant d’honorer les principes de justice sociale et de résister aux discours dominants qui tendent à l’individualisation des problématiques sociales. Mon immersion dans le monde professionnel m’aura appris que les valeurs de justice sociale peuvent et doivent constituer un levier important de l’intervention individuelle et guider la pratique de la psychothérapie, de manière à modifier les rapports de force à l’oeuvre.
J’occupe aujourd’hui un poste de psychothérapeute communautaire au sein du programme RVN (refugees and vulnerables new comers) a JFS (Jewish family services Ottawa). Mon poste est entièrement subventionné par le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Le service de thérapie/conseil en santé mentale est plurilingue et entièrement gratuit pour les usagers. Cette réflexion se veut donc représenter le point de vue d’une praticienne travailleuse sociale clinique auprès de personnes en demande d’asile, de personnes au statut protégé et de nouveaux arrivants vivant en situation de vulnérabilité.
Je travaille avec des survivant.e.s de génocides, de guerres et de crimes atroces, avec des personnes fuyant la torture, les violences sexuelles et de genre ou la persécution d’un gouvernement dictatorial, avec pour seul espoir de trouver ici un lendemain nouveau. Vous imaginez bien que de tels parcours de vie ne sont pas sans conséquences sur la capacité d’une personne à s’engager avec son environnement, à s’investir de manière saine dans les interactions sociales ou même à garder confiance dans son corps et son propre jugement !
Il s’agit d’individus marqué.e.s par des pertes inestimables : pertes de proches, du réseau social, du statut socioéconomique et des identités sociales ; mais aussi pertes de rêves, d’aspirations, d’espoir, du sentiment d’appartenance ; enfin, ces individus sont marqués par le déclin de leur santé physique et mentale.
Des diagnostics, il y en a eu plusieurs : du choc post-traumatique au deuil complexe, en passant par les troubles de l’humeur ou de la personnalité, ou encore parfois, il est question de la « nouvelle normalité » d’une personne.
Par ailleurs, ces personnes affligées rapportent toutes un impact significatif du trauma sur leur qualité de vie. On parlera généralement d’un changement de rapport aux besoins primaires (hygiène, appétit, libido et sommeil), de déclin de l’estime personnelle, d’isolement social et/ou de relations sociales abusives ou « toxiques », d’épisodes d’auto mutilation, de psychose, d’idéations suicidaires, de souvenirs intrusifs et de sentiment de peur constant.
Parfois, c’est du jour au lendemain qu’une personne se trouve aux prises avec des « symptômes » débilitants : flash-back, cauchemars, anxiété sociale, douleurs psychosomatiques, dissociation ou crises de panique. La plupart des gens que je rencontre rapportent, au début de notre travail ensemble, le sentiment d’être trahi par leur propre corps, dénonçant son imprédictibilité. À cela s’ajoutent le profond sentiment d’impuissance face aux changements hormonaux, la prise de poids, aux effets secondaires de la médication, à l’invasion de leur personne par le corps médical ou de sa vie privée par les services sociaux et d’immigration.
Il arrive que des personnes arrivent déjà convaincues que leur corps n’était pas digne de confiance et d’amour et qu’elles n’étaient elles-mêmes plus digne de confiance et d’amour…
Il n’est pas rare que ces mêmes personnes ne maîtrisent pas encore une des langues officielles. Elles vivent donc encore plus de discrimination au logement, à l’emploi, dans l’accès aux réseaux de la santé et des services sociaux. Elles ne connaissent pas non plus leurs droits ni les ressources pour se protéger contre les arnaques. Elles deviennent des cibles de choix pour des professionnels blasés ou des charlatans du crédit et de la finance.
Comme si cela n’était pas suffisant, ces mêmes personnes se voient dépossédées de leur droit à la vie privée. Elles sont interrogées, suspectées et bien trop souvent traitées irrespectueusement par différents représentants des institutions avec lesquels elles interagissent au quotidien.
Si l’arrivée en Amérique du Nord procure à ces personnes une sécurité physique et sociopolitique au regard de la violence qu’elles ont fuie, les violences systémiques auxquelles elles font face contribuent à n’en pas douter au déclin de leur santé mentale une fois au Canada.
En deux années de service, j’ai vu trop de ces personnes arriver chez nous le coeur, le corps et l’esprit avides de sécurité et d’acceptation, et se heurter au visage de la peur, du mépris ou pire encore, à celui de l’indifférence : d’une agente d’Ontario travail biaisée, d’un éducateur ou d’enseignant aux penchants moralistes, d’une avocate frustrée d’être sous-payée, d’un médecin aux oreilles bouchées, d’un chauffeur de bus déconnecté, de voisins racistes, d’un propriétaire de logement qui n’est soudainement plus intéressé, alors que vous, vous êtes en mode survie. C’est comme si votre maison était en feu, que vous vous époumoniez à demander de l’aide et que l’entièreté de la rue déniait l’urgence même de la situation !
Les personnes nouvelles arrivantes n’ont pas connaissance de la complexité du système dans lequel nous nous trouvons. Il m’est arrivé d’en accompagner pendant un moment avant de comprendre qu’elles me croyaient en communication systématique avec leur médecin, leur banque, leur avocat, ou l’agent frontalier qu’elles avaient vu à leur arrivée… C’est un peu comme si tous les professionnels qu’elles avaient rencontrés sur le sol canadien appartenaient à « la même machine ». J’ai donc rapidement compris l’effet domino que peut provoquer une seule expérience négative avec un.e professionnel.le et la méfiance qui s’en suit pour l’ensemble de celles et ceux qui seront perçu.e.s comme des représentants du système. Par ailleurs, j’ai été émerveillée de découvrir le pouvoir du cadre clinique quand vient le temps d’établir ou de rétablir une relation de confiance entre la personne et les institutions canadiennes. L’espace clinique offre une certaine sécurité : il est un lieu où la subjectivité des personnes qui l’habitent (contexte, expressions et valeurs) est centrale et où la co-construction d’un savoir transformateur est possible. C’est dans un partage viscéral d’empathie et d’indignation que nous participons à la déconstruction des discours oppressifs.
La contribution du travail social
En tant que travailleurs/travailleuses de première ligne, nous sommes plusieurs à être issu.e.s du groupe majoritaire. Nous avons donc la responsabilité d’adopter une posture culturellement humble et travailler ainsi à l’amélioration de la qualité globale des soins offerts aux réfugiés.
Un aspect important et distinctif de notre pratique est de mettre en lumière (et contrer) l’hégémonie des approches découlant du paradigme biomédical. Élaborées à partir de données quantitatives (fondées sur des preuves probantes), les connaissances médicales sont à bien des égards réduites aux dimensions objectives et mesurables des problématiques vécues par les personnes. Par exemple, le trauma, tel qu’il est conceptualisé par le monde médical, occulte la nature véritable de la violence exercée sur les humains qui en font l’objet. Le langage du trauma, avec ses symptômes et ses outils d’évaluation, tend a invisibiliser les structures d’oppression, telles que la colonisation, la pauvreté ou le racisme pour relocaliser le mal dans l’individu. Cette approche du trauma conduit les travailleurs/euses de première ligne à personnaliser, individualiser et responsabiliser les personnes souffrantes (Vikki Reynolds, 2019).
L’individualisme et le culte de la performance nord-américains semblent contribuer, dans un contexte de professionnalisation du travail social, à maintenir un profond sentiment « d’imposture » chez le nouveau praticien. Dans un contexte où le droit de pratiquer la psychothérapie a récemment été accordé aux travailleurs/euses sociaux/sociales, il est normal de constater qu’ils sont moins nombreux à occuper ces postes ; la majorité étant des personnes détentrices de maîtrise en art, en éducation ou en sciences[1]. Cette position minoritaire que connaissent les travailleurs sociaux dans le monde de la psychothérapie et du counseling, doublée du manque de ressources pour la formation, contribue à l’érosion des valeurs de justice sociale dans la pratique. C’est un peu comme le nouveau clinicien ou la nouvelle clinicienne qui se laisser subjuguer par les théories et approches dominantes, désireux.se d’apporter un changement, de « guérir » le traumatisé…
L’intégrité du travailleur social clinique réside, en ce sens, dans sa capacité à adopter une posture qui fera primer les valeurs, les principes et le langage de la personne accompagnée, dans les limites prévues par le cadre légal. À ce titre, j’aimerais faire une parenthèse sur l’importance pour cette population immigrante en souffrance d’être desservie par des professionnel.le.s issu.e.s de la grande diversité canadienne. La gestionnaire du programme RVN et presque l’ensemble des intervenant.e.s qui forment cette unité ont une expérience personnelle d’immigration ou de demande d’asile et une compréhension intrinsèque des enjeux qui y sont liés.
La flexibilité des bailleurs de fonds et de l’organisme
L’accompagnement d’une population hautement stigmatisée, politisée et jouissant de conditions socioéconomiques moindres ne peut se faire que dans une perspective systémique. De plus, la situation de vulnérabilité de cette population appelle à l’importance de la flexibilité du travail de l’intervenant.e et de l’adaptation des ressources du programme aux besoins des individus accompagnés.
Dans le cadre du programme Refuges and Vulnerable Newcomers, le ministère reconnait la nécessité de réduire des barrières d’accessibilité, ce qui nous permet d’offrir un soutien financier pour le transport et la garde d’enfants afin de faciliter l’utilisation des services. Dans le calcul de la charge et du temps alloué pour les interventions, le financement du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada prévoit du temps pour la défense des droits de la personne et la communication avec d’autres professionnels, organismes et institutions, en plus du temps réservé à la psychothérapie.
Nous disposons donc d’un temps raisonnable pour la rédaction de lettres de soutien à joindre au dossier d’immigration, à la demande de prestation d’invalidité de l’Ontario, au logement, au transport, à des biens essentiels tels que vêtements et meubles, aux services de garde, etc. Nous accompagnons également les nouveaux arrivants dans leur inscription à différents programmes en assurant les suivis avec les différents professionnels et acteurs concernés et en assurant des services de traduction.
Du temps est également accordé à la recherche de ressources appropriées, à la consultation entre les membres de l’équipe, aux diverses rencontres de supervision (individuelles, de couples, familliales, traumatiques), aux rencontres d’équipe RVN, aux rencontres bimensuelles internes de développement professionnel, aux formations de développement continu externes et aux rencontres mensuelles de la communauté de pratique, composée de cliniciens de la communauté qui accompagnent les nouveaux arrivants en situation de vulnérabilité.
L’accès à des services de santé mentale de qualité constitue un besoin fondamental pour les personnes en situation d’asile ou au statut d’immigration précaire. Lorsque les tarifs pour un service de psychothérapie s’élèvent à 150 $ de l’heure, l’investissement du ministère et sa flexibilité face aux exigences liées à l’utilisation de la subvention constituent des conditions sine qua none dans l’intégration des nouveaux arrivants en situation de vulnérabilité.
Les alliances : tenir dans et à travers l’indignation
Je ne pense pas que la création d’alliances devrait perdre de ses couleurs lorsqu’il est question d’intervention individuelle. S’indigner c’est s’allier ! Non seulement avons-nous la responsabilité de partager cette indignation entre intervenant.e.s et avec les personnes, mais nous avons aussi le devoir d’utiliser le pouvoir dont les travailleuses sociales sont investi.e.s institutionnellement pour répondre véritablement aux besoins de chaque personne que nous accompagnons.
Nous avons tous vécu des situations où nous nous sommes senti.e.s impuissant.e.s et vulnérables face à l’injustice. Des souvenirs de violentes peines cimenteront les convictions les plus profondes pour vibrer quotidiennement dans les tripes des intervenant.e.s de première ligne exposé.e.s au visage de la souffrance. Il est important de connecter avec ces fragments de notre personne, de tabler sur l’indignation comme carburant au moteur du changement. Je pense que l’indignation doit rester en nous même après que le « client » quitte notre bureau. Elle nous imprègne, nous inspire dans les discussions et les décisions futures que nous prendrons. Ces moments d’indignation se veulent des occasions de s’unir dans une visée commune de l’intervention et de s’adonner à une réflexion éthique.
De plus, la création d’alliances entre professionnel.le.s permet d’arriver à des résultats où le consensus entre les acteurs est plus facile à obtenir et où la voix des personnes accompagnées est mieux entendue. Le Jewish Family services (JFS) devient d’ailleurs l’hôte de la Communauté de pratique. Ces rencontres permettent de discuter des meilleures pratiques et d’échanger des pistes de solution face aux problématiques rencontrées par les réfugiés et les nouveaux arrivants à Ottawa. À titre de cliniciens oeuvrant avec une population spécifique, nous avons la capacité de rapporter des connaissances expérientielles et qualitatives des personnes que nous accompagnons aux gestionnaires de nos organismes respectifs et, ainsi, de contribuer à l’élaboration de programmes intersectoriels.
Il est clair que la question des ressources est de plus en plus alarmante et mérite une attention particulière. Toutefois, la création des alliances, et le partage des pouvoirs qui en découle, permet l’utilisation de ces mêmes ressources de manière plus efficiente, voire performante. Le centre de la Famillle Juive d’Ottawa (JFS) travaille activement avec les différentes agences de la famille, centre de santé communautaire et organismes partenaires de la ville d’Ottawa. Ce travail de concertation et d’intégration permet de : a. créer des outils d’évaluation qui s’enlignent avec la philosophie et les approches préconisées par les agences communautaires ; b. accroître la cohérence d’action et, c. mettre en lumière des pratiques trop souvent invisibilisées. Le ministère qui nous finance nous a d’ailleurs demandé de développer des indicateurs de performance à l’interne plutôt que de nous les faire imposer. Je suis d’avis que le travail de collaboration de ces agences de la ville d’Ottawa a permis d’accroître l’autonomie d’action par rapport aux différents bailleurs de fonds.
Un exemple d’intervention
Pour illustrer le travail d’intervention auprès de nouveaux arrivants vivant des traumas, j’aimerais raconter un processus de psychothérapie mené avec l’un d’eux. Les noms et pays ont été changés pour préserver l’anonymat.
Djamal est un homme d’une quarantaine d’années originaire du Rwanda qui occupe une fonction de haut placé politique. Lors de notre première rencontre, il se présente avec sa femme qui m’informe qu’il ne peut plus se déplacer seul depuis quelques mois. Cela fait neuf mois qu’ils sont au Canada et bientôt trois mois que la détresse de Djamal est apparue à sa femme.
Djamal parle sur un ton très bas, les yeux fixés sur le plancher. Il indique avoir peur en permanence et apprécier mon ton très « doux » qui le réconforte. Très vite, un peu en mode « automatique », il raconte les détails entourant le massacre de ses parents et de sa fratries dans les années 1980, ainsi que de militants de son groupe dans les années 2000. Il parle de castrations, de viols, d’amputations, d’égorgements, de torture… Sa femme est aussi bouleversée par la crudité de ces détails, mais Djamal n’est déjà plus avec nous, il est au Rwanda, les images de violence et de souffrance extrêmes défilent clairement devant ses yeux.
Je tape alors du pied tout en gardant mon attention sur lui, un peu de manière instinctive, il reproduit le même geste et me regarde dans les yeux, le mouvement le ramène vers nous.
Il explique avoir été recherché par la police à la suite de manifestations auxquelles il avait participé et s’être enfui, car sa famille et lui-même couraient le risque de se faire torturer et assassiner. Il indique qu’il s’était d’abord rendu aux États-Unis, décrivant un voyage extrêmement éprouvant, avant d’arriver au Canada. Il dit se souvenir d’avoir vécu beaucoup de stress à son arrivée, entre l’inscription des enfants à l’école, la recherche d’un logement et l’enregistrement aux divers programmes liés à l’établissement, mais toujours en contrôle de lui-même.
Ce n’est qu’après avoir été témoin d’une manifestation au Canada que sa souffrance est remontée, en d’autres mots, que les symptômes se sont manifestés : paranoïa, sentiment de peur constant, perte de mémoire, difficulté de concentration, confusions, douleurs musculaires et migraines, souvenirs intrusifs et cauchemars. Ainsi, la vue d’une personne en uniforme suffit à l’envoyer dans un état de panique extrême, persuadé que le Rwanda a envoyé ces gens pour lui. Les cauchemars ont significativement affecté la qualité et la quantité de son sommeil, le faisant basculer dans un cycle infernal de peur et de vigilance.
Il rapporte avoir essayé de cacher sa détresse aux siens et trouvé refuge dans l’alcool, mais a constaté l’aggravation de son état, lorsque sa femme l’a découvert. Il dénonce l’imprédictibilité de son corps, rapportant le sentiment d’être trahi par celui-ci. Lors de notre première session, il prend des antidépresseurs et des somnifères prescrits dans une clinique sans rendez-vous, a un « case manager » et un avocat avec lesquels il entretient une relation de confiance. Il exprime le souhait d’accéder à un médecin de famille et à un dentiste.
La psychoéducation entourant les symptômes liés au choc post-traumatique a été bénéfique pour normaliser l’expérience de Djamal et la resituer dans son contexte : il est soulagé de savoir que son corps cherche à le protéger, et non à le trahir. Il suffit maintenant de faire comprendre à ce même corps qu’il est en sécurité et qu’il peut maintenant se reposer. Cette nouvelle compréhension devient un terrain propice pour explorer les actes de résistance de Djamal, il m’explique qu’il se parle souvent quand il est attaqué par le passé : il se dit qu’il est au Canada ; lorsqu’il réussit à faire cela, il reprend parfois le contrôle. Il s’illumine : s’il a pu le faire par lui-même, plus d’une fois, c’est qu’il est toujours apte à maîtriser son corps. Je lui donne une liste de médecins et de dentistes qui acceptent la couverture médicale du fédéral, de l’information pour sa femme si elle souhaite accéder à un service de psychothérapie et des exercices simples de relaxation à pratiquer avant de dormir.
Dès la deuxième session, Djamal signale des progrès qu’il associe à la relation thérapeutique qui semble s’être installée entre nous et aux exercices d’ancrage (dessins thérapeutiques, balle antistress, échanges) et de relaxation (étirement et respirations profondes) : diminution du phénomène d’errance, du sentiment d’être étranger à soi-même, des épisodes de confusion, des maux de tête et de l’irritabilité, une meilleure concentration le matin et une augmentation du sentiment de contrôle. S’il rapporte que les cauchemars, la confusion et l’hypervigilance au réveil persistent, il exprime avoir recours à l’espoir pour revenir à la réalité. Dans cette session, il s’ouvre sur les peurs associées à son rétablissement et à son traitement, à savoir devenir dépendant de la médecine et ne plus pouvoir faire confiance à son propre jugement.
Par le recours à l’approche narrative et à un modèle d’analyse systémique, nous explorons les rôles sociaux et la perte de ses nombreuses identités sociales. Djamal réalise qu’il est en deuil. Il réfléchit sur les violences génocidaires qui affligent le peuple rwandais et établit un lien avec l’addiction. Il ne se croit plus la seule victime, il n’est pas damné, il fait partie d’un système défaillant et violent. Nous venons de changer le sens de l’histoire dominante et travaillons à créer des récits alternatifs dans lesquels les valeurs et croyances de Djamal peuvent exister.
Il rapporte que ses symptômes l’empêchent de conduire et de se sentir comme le protecteur de la famille, identité chère à son coeur. Il exprime se sentir honteux et coupable de cette réalité. Un nouvel objectif se dessine : « reprendre le volant », au sens propre et figuré, cette image guidera l’ensemble des sessions qu’il nous reste.
Une fois que Djamal a su maîtriser les outils de relaxation et qu’un fort sentiment de confiance a été établi, nous avons voué une session à de l’imagerie guidée pour revisiter les espaces et les relations liés à un profond sentiment de sécurité. Cette technique nous a permis d’accroître les outils d’ancrage et de relaxation dont il dispose pour combattre ses peurs, lorsqu’elles se manifestent.
Au cours de notre travail, il est devenu évident que l’environnement de Djamal, qui résida à ce moment toujours dans un refuge avec sa famille, constitue une entrave à son sentiment de contrôle et, par voie de conséquence, à son rétablissement. Il rapporte ne pas avoir de serrure pour leur chambre, devoir vivre avec une présence accrue de policiers, avec des allers et venues toute la nuit, en plus des cris des disputes ou des scènes de violence. Il sent donc que le protecteur de la famille qu’il est doit « garder la porte » de leur chambre et maintenir son état d’hypervigilance. Avec l’aide du médecin traitant, nous avons rédigé des lettres de soutien qui ont permis à Djamal et à sa famille d’accéder au statut prioritaire pour un logement subventionné. Une fois relocalisé, l’hypervigilance a significativement diminué. Djamal rapporte s’être senti soutenu tout au long du processus, déclarant que ses besoins ont été reconnus et respectés.
Au bout de la sixième session ensemble, Djamal a commencé à venir seul, utilisant ses techniques d’ancrage pour rester alerte dans les transports en commun. De plus, il rapporte sa capacité à contempler la nature sans rentrer dans un état second : il est maintenant capable de remarquer la beauté des paysages et le changement des saisons. Il me regarde droit dans les yeux et marche d’un ton plus affirmé.
Une session a également été dédiée à l’exploration de son cauchemar récurrent, et des techniques de visualisation ont été utilisées pour établir une autre fin, à l’image de ses propres aspirations. Au cours de la huitième session, il rapporte une diminution des cauchemars et un état plus serein au courant de la journée. Son médecin, dit-il, a également constaté l’ampleur de ses progrès et a réduit sa médication de moitié.
À travers son récit, j’apprends l’existence d’une communauté rwandaise unie dans l’adversité. Djamal me parle des marches matinales, des repas de groupe, d’une forte participation aux messes à l’église, des visionnements de matches de soccer, bref d’une communauté qui mise sur de nombreuses ocassions de rassemblements et de connexions. Il me raconte, avec passion, comment les membres de sa communauté discutent des injustices et crimes commis par leur gouvernement en plus de s’organiser sur la scène internationale pour mettre en lumière ces atrocités. Il parle maintenant d’une « résurrection de la justice » ancrée dans l’espoir ! Une mission vient de s’agrafer au nouveau récit : dévoiler la vérité et résister à l’oppression. Un sens nouveau est donné à son expérience : il n’estpas seulement victime d’un gouvernement imbue de pouvoir et xénophobe, mais aussi un être investi de pouvoirs et capable d’agir.
Ainsi, Djamal a bénéficié du soutien constant du système de santé, des services sociaux, de sa famille, de sa communauté et de l’Église. Ce soutien lui aura permis de reprendre le volant, au sens propre. Au terme de notre travail ensemble, il avait passé son permis, conduisait un véhicule, en plus de suivre des cours de langue et de se projeter dans le futur.
Appendices
Note
-
[1]
Elles s’inscrivent à l’Ordre des psychothérapeutes. Avant d’avoir effectué un certain nombre d’heures de supervision et de pratique directe, elles ont le statut de « qualifiée » et lorsqu’elles complètent le nombre d’heures requis, elles deviennent officiellement membres de l’Ordre.
Bibliographie
- Ravon B., Decrop G., Ion J., Laval C. et Vidal-Naquet, P. (2008). Usure des travailleurs sociaux et épreuves de professionnalité. Les configurations d’usure : clinique de la plainte et cadres d’action contradictoires. Recherche pour l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), Ministère de la santé et des solidarités — Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).
- Reynolds, V. (2019). The Zone of Fabulousness: Resisting vicarious trauma with connection, collective care and justice-doing in ways that centre the people we work alongside. Context, 164, 36-39. https://vikkireynoldsdotca.files.wordpress.com/2019/09/2019-context-uk-zone-of-fabulousness-reynolds.pdf