Abstracts
Résumé
Certaines vies sont perçues comme comptant moins que d’autres. L’attention est vulnérable à la mise en scène sociopolitique de la hiérarchisation des vies et contribue en partie à la reproduction des injustices sociales. En s’inspirant de la pensée de Simone Weil, il s’agit de réfléchir à une éducation favorisant la capacité à porter attention à autrui, notamment en prenant en compte l’importance du sentiment de sécurité, des moyens pédagogiques ainsi que du rôle de la prudence dans l’usage des mots et dans la transmission du savoir. Ces éléments disposent au déploiement d’une attention déprise, pour un moment, des rapports de pouvoir.
Mots-clés :
- attention,
- éducation,
- Simone Weil,
- vulnérabilité,
- autonomie relationnelle,
- malheur,
- injustice épistémique,
- éthique
Abstract
Some lives are seen as counting less than others. Attention is vulnerable to a sociopolitical framing of the prioritization of lives. This, in part, contributes to the reproduction of social injustices. By drawing on the thought of Simone Weil, we think about an education that favours the capacity to pay attention to others, particularly by taking into account the importance of the feeling of security, of the educational means as well as the role of precaution in the use of words and in the transmission of knowledge. These elements prepare for an attention that can be separated, for a moment, from power relations.
Keywords:
- attention,
- education,
- Simone Weil,
- vulnerability,
- relational autonomy,
- affliction,
- epistemic injustice,
- ethics
Article body
L’attention devrait être l’unique objet de l’éducation.
Weil 1997, Oeuvres complètes VI, 397
L’attention est un terme dont la valeur heuristique, épistémologique, politique et éthique change selon les multiples phénomènes qu’il éclaire. Cette polysémie rend la problématique de l’attention particulièrement complexe à cerner, car son rôle et ses effets seront différents selon le positionnement de l’attention par rapport aux choses et selon la chose regardée elle-même. En effet, l’attention est toujours porteuse d’un savoir situé, tout comme elle est affectée par son objet. De fait, l’attention est partielle parce que positionnée tout comme elle est partiale parce qu’engagée dans le monde. Parallèlement à ce mode de connaissance, l’attention entre en rapport avec son objet à travers un processus d’extraction et d’élection. Il s’agit de porter son attention sur une chose afin de la saisir. Pour ce faire, il faut l’isoler momentanément des autres objets de manière à en définir les contours et se concentrer sur cette chose uniquement. Pour le dire autrement, faire attention à quelque chose signifie toujours être inattentif à autre chose. Ces mécanismes d’extraction et d’élection ont plusieurs effets, parfois radicalement opposés.
Esquissons au passage ces divergences. Selon les contextes, donner son attention à une personne discriminée comporte une dimension sociale et politique positive, puisque cela contribue à rendre pleinement réel l’objet de l’attention et à réduire en partie, pour un moment du moins, les invisibilités sociales. Il y a une compétition pour l’attention, puisque la visibilité des un·es est en partie liée à l’invisibilité des autres. On peut penser, tout banalement, à celles et ceux qui s’arrêtent, discutent et aident les personnes en situation d’itinérance plutôt que de passer dans la rue en s’efforçant de ne pas les voir (Honneth 2004, 137-151). Or, porter attention à une personne discriminée n’est pas nécessairement garant d’avoir une portée positive. L’attention peut en effet contribuer à constituer son objet en cible du pouvoir. La surreprésentation des personnes autochtones dans les prisons canadiennes est un exemple des effets sociopolitiques du profilage racial, lequel s’opère au travers d’un certain usage de l’attention[1]. Les gestes commis par certain·es apparaîtront plus facilement à l’attention des corps policiers alors que les mêmes actes posés par d’autres ne seront pas surveillés de manière aussi exhaustive. L’attention, dans le premier cas, a une finalité éthique et bienveillante, alors que dans le second elle participe d’une grammaire de surveillance et de contrôle. En déployant ces contrastes entre l’attention comme lien éthique, d’un côté, et comme reproduction des rapports de force, de l’autre, nous chercherons à montrer les différents usages de l’acte attentionnel afin de mieux cerner ses potentialités comme ses dérives.
Dans un premier temps, nous donnerons une définition de la « vulnérabilité de l’attention » en partant d’une approche de la philosophie sociale et politique. Saisir l’attention à travers la vulnérabilité permettra d’observer les répercussions éthiques et politiques du geste attentionnel. La vulnérabilité implique que nous sommes modelés en partie par le monde et toujours ouverts à la potentialité de la blessure (Garrau 2018). Il s’agit, en posant l’attention dans sa dimension vulnérable, de montrer la manière dont l’attention est toujours en rapport avec l’extériorité, affectée par elle. Cette vulnérabilité intrinsèque de l’attention la rend perméable au dehors. Afin d’être en mesure d’atteindre une certaine autonomie attentionnelle, cette capacité a besoin, pour s’épanouir pleinement, de certaines conditions matérielles. Or, ces conditions sont rarement réunies et on observe au contraire que l’attention a tendance à être captée, par dispersion ou aversion, par le biais de différents dispositifs. Dès lors, la possibilité de diriger son attention par soi-même s’avère plus complexe et laborieuse.
Dans un deuxième temps, nous aborderons les principes éducationnels favorisant un type précis d’attention, que Simone Weil [1909-1943] définit dans ses travaux. La conception proposée par Weil permet de cerner la radicalité de l’attention en tant que capacité à la racine d’une relation humaine à soi-même et au monde, mais aussi de saisir combien la distorsion de l’attention transforme radicalement les rapports sociaux en les déshumanisant. Partant de la pensée de Weil, il s’agira de réfléchir aux conditions matérielles qui permettent de faire usage d’une attention sensible à la fragilité d’autrui, qui révèlent les blessures peu visibles et contribuent à les réparer. Pour cela, il faut être en mesure d’orienter son attention par soi-même. Différents éléments peuvent être cultivés pendant les cours afin de contribuer à l’épanouissement de l’attention. Nous en soulignerons trois. D’abord, il faut valoriser une atmosphère de sécurité, considérant que le sentiment de précarité rend difficile l’attention à autre chose qu’à soi-même ; ensuite, accorder plus d’importance aux moyens des exercices pédagogiques plutôt qu’aux résultats des notes ; et, finalement, faire preuve de prudence dans l’usage des mots et des savoirs. Au travers de ces éléments, il s’agira d’observer la manière dont une certaine éducation de l’attention permet, selon Weil, « l’autonomie relationnelle[2] ». Cette attention, on le verra, est malheureusement trop peu valorisée socialement.
La vulnérabilité de l’attention
La vulnérabilité attentionnelle comme lien éthique
La question centrale de l’attention en phénoménologie pourrait se résumer comme suit : « L’expérience perceptive livre-t-elle une forme de connaissance vraie ? » La phénoménologie, bien que de ramifications et d’écoles diverses, creuse les rapports intimes et dialectiques entre les sens et les structures sociales. Elle pose l’attention comme ce qui résulte du corporel et du psychique, tout comme elle l’inscrit dans un ensemble de supports collectifs et de pratiques sociales.
À la fois passive et active, l’attention est d’abord une présence pré-intentionnelle et préréflexive au monde, qui éveille justement le soi et l’invite à se tendre vers autre que lui. L’attention serait donc d’abord préconsciente. D’une certaine façon, c’est elle qui tend la conscience vers le monde. C’est dans un second temps seulement que le soi déploie librement, activement et intentionnellement son attention vers l’objet (Husserl 1989, 317-321). Cette dynamique de prise de conscience de l’objet est, pour Edmond Husserl, corollaire de la maîtrise de soi et de la liberté. Pour lui, l’attention est le corrélat de la liberté mise en acte. Relisant Husserl autrement, Emmanuel Lévinas considère l’attention et l’éveil qu’elle crée dans une perspective éthique, au sens où l’attention n’est jamais en dehors d’une situation de relation. Moins que le signe de la maîtrise de soi, l’attention est plutôt pour Lévinas ce qui ébranle le soi et le projette hors de lui. Ce qui apparaît réveille le soi en le déstabilisant jusque dans ses fondements identitaires. Ainsi, cet éveil du soi « signifie la dé-fection de l’identité, ce qui n’est pas son extinction, mais sa substitution au prochain – ordre ou désordre où la raison n’est plus ni connaissance ni action, mais où désarçonnée par Autrui de son état – désarçonnée du Même et de l’être – elle est en relation éthique avec autrui, proximité du prochain » (Lévinas 1986 : 60). L’attention, ici, est une forme de relation intersubjective profonde, au sens où elle creuse à la racine du soi pour en transformer, du moins momentanément, la représentation que le sujet a de lui-même ou d’elle-même. De manière générale, pour la phénoménologie, l’attention est considérée à la fois comme passive et active, non intentionnelle et réflexive, liberté (comprise comme maîtrise de soi) et sensibilité au monde. Elle apparaît traditionnellement comme le pont entre le sujet et le monde, entre le conscient et l’inconscient, entre la maîtrise de soi et l’affect. Plus encore, l’attention révèle cette relation entre le sujet et le monde par lequel du sens se crée (Depraz 2016). L’attention est, en quelque sorte, toujours à la recherche de signification : « l’attention s’éveille et est maintenue éveillée dans la mesure où elle participe d’un dévoilement d’être, à une constitution de sens […] [N]ous sommes attentifs lorsqu’il se passe quelque chose, lorsqu’il arrive quelque chose qui est digne de notre attention et qui la nourrit » (Moinat 2010, 45). Si dans un premier temps l’attention est passive, son affectation par le monde anime en elle une activité par laquelle le sujet se saisit de sa capacité attentionnelle pour la diriger et se concentrer sur l’objet choisi afin d’en cerner la signification.
Bien que l’attention soit importante dans la phénoménologie en général, elle demeure un moment de la perception parmi un ensemble d’autres mécanismes, par exemple l’intention, l’intérêt, la volonté ou, encore, l’action[3] (Husserl 2009). C’est sans aucun doute dans la philosophie de Weil que le traitement du concept d’attention est analysé au plus loin, à la fois dans sa profondeur conceptuelle et dans ses multiples effets existentiels, sociaux et politiques. Pour Weil, l’attention relève bien sûr de la perception, mais elle est également la base d’une relation authentique au réel qui englobe des dimensions spirituelles, sociales, éthiques, politiques et cognitives[4]. En fait, il y a deux espèces d’attention chez Weil, l’une exigeant un contrôle de soi, l’autre dépossédant de soi. La première est liée à la volonté et renvoie à l’attention comme effort de concentration en exigeant une certaine ascèse du corps. Il s’agit du genre d’attention telle qu’elle est communément comprise. La seconde ne nie pas la première, mais dépasse de loin ses possibilités éthico-politiques. Cette sorte d’attention beaucoup moins commune que la première et malheureusement peu valorisée et reconnue[5]. Weil nomme cette seconde forme « l’attention créatrice[6] ». La volonté y laisse place à une certaine passivité et réceptivité du monde, une forme de dépouillement dont l’effet est extatique. Pour atteindre cette attention si particulière, il faut pouvoir se disposer à « suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l’objet, à maintenir en soi-même à proximité de la pensée, mais à un niveau inférieur et sans contact avec elle, les diverses connaissances acquises qu’on est forcé d’utiliser » (Weil 1966, 92-93). Le second type d’attention est une forme d’hospitalité radicale, car « faire le vide implique faire le plein dans le monde » (Vetö 1971, 49). Dans ce processus, la pensée se déleste d’une part de sa souveraineté et amorce un exercice d’attente à vide, n’imposant plus de significations préconçues sur les choses et les êtres, mais, au contraire, en les recevant pleinement dans leur apparition. Cela requiert de faire une lecture du réel libérée, dans la mesure du possible, de toute forme d’imagination.
Longuement inspirée par son professeur Alain, Weil partage avec lui l’idée que les mauvaises interprétations du monde sont en partie liées aux effets de l’imagination sur le jugement[7]. L’imagination tend à distordre le lien au réel en y projetant les désirs, les peurs et les envies que les prestiges sociaux et les rapports de force cultivent, que la personne intègre en elle-même, parfois malgré elle, parfois de façon consciente. Refuser le réconfort de l’imagination dans l’attention est un exercice par lequel la personne fait l’expérience graduelle du détachement de ce qui, en elle, est empreint des puissances sociales. De fait, une partie d’elle-même est diminuée, celle qui d’ordinaire « ne s’épanouit que lorsque du prestige social la gonfle ; son épanouissement est un privilège social » (Weil 1957, 27). Or, qui est gonflé par le prestige est d’autant plus vulnérable face aux pressions sociales puisque dépendant de la reconnaissance des autres ; la perte de cette partie de soi contribue alors à l’apprentissage d’une forme d’autonomie réflexive, par laquelle la personne arrive à ressentir les forces sociales qui influencent sa perception. Il est alors possible de les refuser ou de les accepter, plutôt que de les subir sans les déceler.
Cet apprentissage de l’attention a une grande importance sociale. En effet, pour Weil l’attention créatrice permet aux individus de voir par-delà les normes sociales en s’arrachant momentanément aux prestiges sociaux. Elle mentionne combien la pensée, en soi, cherche à fuir le malheur. Le malheur est un état particulièrement souffrant, bien qu’il ne se réduise pas à la douleur. « Il n’y a vraiment malheur que si l’événement qui a saisi une vie et l’a déracinée l’atteint directement ou indirectement dans toutes ses parties, sociales, psychologiques, physiques. » (Weil 1999, 694) Se mettre à la place d’un·e malheureux·se est quelque chose d’extrêmement difficile, cela demande de se « vider de sa fausse divinité, se nier soi-même, renoncer à être en imagination le centre du monde » (ibid., 732). Cette première démarche est exigeante puisque l’imaginaire permet de gonfler le moi de certitude et, surtout, de le protéger de la peur du vide. Plus encore, il faut consentir à faire l’expérience mentale de son propre anéantissement, accepter de partager l’impression de l’extrême précarité existentielle, sociale et politique du malheureux. Pour porter véritablement attention à une personne dans le malheur, il faut donc traverser le vide en taisant son égoïsme et ses prétentions individuelles afin de cerner, jusqu’au fond de soi-même, ce que signifie être une personne qui ne compte pour rien. Or, l’attention aux malheureux·ses est quelque chose de difficile, car cela implique un renoncement à la souveraineté du soi. Plutôt que de se mettre à la place d’un·e malheureux·se, la pensée se rebute et se referme sur elle-même. À l’image de ceux et celles qui accélèrent en passant près d’un junkie comateux, évitant le plus possible de faire attention à la personne qui gît devant eux, c’est en s’arrêtant que la personne mesure l’effet des forces sociales et cognitives qui la poussent à accélérer devant le malheur : « L’attention créatrice consiste à faire réellement attention à ce qui n’existe pas. L’humanité n’existe pas dans la chair inerte au bord de la route. Le Samaritain qui s’arrête et regarde fait autant attention à cette humanité absente, et les actes qui suivent témoignent qu’il s’agit d’une attention réelle. » (ibid., 726) L’attention créatrice est à la fois détachement d’une partie de soi et dévoilement de ce que les prestiges camouflaient dans le réel. Elle a le potentiel de faire « un modeste, mais réel contrepoint » aux effets de déréalisation qu’engendrent l’indifférence, le mépris et la violence sur la perception des individus. Ce regard, élément « infiniment petit » (Weil 1957, 108) devant la grandeur des jeux de pouvoir, porte ainsi en lui la possibilité de modifier et de rééquilibrer les rapports de force, voire de réparer certaines injustices, et révèle une capacité possible pour tous et toutes d’accueillir l’altérité d’autrui dans sa pleine réalité.
Avec Weil, on comprend dès lors que l’attention est à la fois maîtrise de soi et vulnérabilité devant l’extériorité. Pour être en mesure de voir pleinement le réel et de se faire affecter par lui sans y apposer de préconception, il faut apprendre un certain usage de l’attention. « Ce regard est d’abord un regard attentif, où l’âme se vide de tout contenu propre pour recevoir en elle-même l’être qu’elle regarde, tel qu’il est, dans toute sa vérité. Seul en est capable celui qui est capable d’attention. » (Weil 1966, 97) Weil revalorise l’attention au titre d’une technique, d’une habitude, d’un usage qui demande à être appris et, surtout, longuement pratiqué. Pour cerner l’ensemble de ces apprentissages, il est bon de se pencher d’abord sur les défis actuels entourant l’acte d’attention.
La vulnérabilité attentionnelle comme possibilité de domination
L’attention ne se manifeste pas uniquement au travers des dispositions du soi dans ses rapports à l’extériorité et, surtout, dans la capacité du soi à contrôler et à diriger l’attention. En fait, la vulnérabilité de l’attention, en tant que capacité naturellement affectée et fragile, demeure peu explorée. Nous l’avons vu rapidement avec Weil, l’attention à vide, l’attente sans exigence permet à la personne d’entrer en contact avec des éléments du réel qui sont souvent moins bien perçus. La vulnérabilité de l’attention a deux versants, nous l’avons dit. Si l’attention peut être attente pure et accueil de l’altérité, son affectation par l’extériorité rend cette capacité fragile face aux différents stimuli. Ainsi, il se crée tout un réseau « d’économie de l’attention » qui fonctionne grâce à la captation de l’attention (Citton 2014)[8]. Valérie Kokoszka avance que : « [d]ans nos sociétés le mode opératoire de l’orientation et du contrôle des libertés est régi par une économie de l’attention qui ambitionne de faire une économie du pouvoir-être » (2019, 89). Cette économie[9] fonctionne au travers d’une gestion des attentions individuelles par différents dispositifs de transmutation de l’attention (ibid., 90). Ainsi, Kokoszka mentionne que les différents dispositifs ont comme finalité soit la diversion, soit l’aversion de l’attention. Ces effets sur l’attention visent la transformation des pratiques : affecter l’attention permet de jouer sur les conduites. Le premier dispositif, la diversion, consiste à entraver l’orientation attentionnelle, de manière à ce que la maîtrise attentionnelle de soi n’advienne pas. Plutôt que de porter son attention vers l’objet souhaité, le soi est détourné et stimulé vers d’autres lieux attractifs, souvent empreints de prestige ou considérés agréables. C’est ce que Weil observe en usine, où l’attention des travailleur·euses à la chaîne est épuisée, dirigée et captée vers la question des salaires. L’argent demande peu d’effort de concentration, mais elle ne modifie pas les conditions du travail (Weil 1957). Ce détournement de l’objet empêche la focalisation de l’attention là où on voudrait l’orienter. Dès lors, l’attention a plus de mal, car elle perd l’habitude de se concentrer vers ce qui est plus effacé, moins volubile, expressif, ou difficilement décodable.
Dans le second cas, l’aversion, l’attention est éduquée à éprouver de la répulsion envers un certain objet, considéré comme dégradant, répugnant, malsain ou encore pénible. Elle se rabat sur elle-même, se ferme à l’objet parfois avant même d’être réellement entrée en contact avec lui. L’aversion est souvent encouragée, voire cristallisée, par différents préjugés sociaux. Dès lors, l’attention contribue à la reconduction des rapports de pouvoir et des préjugés. Il y a un caractère politique intrinsèque à la vulnérabilité de l’attention. Cet aspect renvoie aux rapports de pouvoir qui structurent le social et font en sorte que certaines vies sont perçues comme comptant moins que d’autres. De fait, il apparaît moins urgent ou obligatoire de répondre aux besoins de ces vies, ou même d’entendre leurs revendications. La vulnérabilité de certaines catégories de personnes sera amplifiée selon leur identité de classe, de sexe et de race. L’attention est elle-même vulnérable à la mise en scène sociale et politique de la hiérarchisation des vies. Le regard qu’elle porte n’est jamais exempt des préjugés sociohistoriques qui façonnent le présent et participent en partie à la reproduction des injustices sociales. Ainsi, certaines catégories de personnes seront frappées d’illégitimité et placées en situation d’altérisation radicale de telle manière que l’attention à leur égard traverse un ensemble de tabous et de préjugés qui rendent le contact extrêmement difficile. Si la diversion crée de l’inattention, l’aversion, elle, produit la fermeture de l’attention, les deux dispositifs n’étant évidemment pas mutuellement exclusifs. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’indifférence, de mépris ou de dégoût, les dérives de l’attention participent des souffrances sociales.
Il est important, dès lors, de creuser les liens entre l’attention, la manière dont elle est orientée et appréciée, et la justice sociale. Bien que Kokoszka ne mentionne pas précisément ce qu’elle entend par « dispositif », on peut supposer qu’elle se réfère à la notion centrale à la pensée de Michel Foucault. Ce dernier la définit comme « un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit aussi bien que du non-dit » (Foucault 1994, 299). En ce sens, le dispositif est constitué d’agencements dont les effets normatifs sur l’environnement ont comme conséquences de faciliter certaines conduites et d’en empêcher d’autres. Reprenant le fameux passage d’ouverture de Surveiller et punir dans lequel Foucault décrit le supplice de Damien, Elsa Dorlin rappelle que la torture et les multiples mutilations sont la confirmation du pouvoir souverain absolu sur l’individualité, dont « [l]a puissance – si infime soit-elle – n’est jamais prise en compte, précisément parce qu’elle ne compte pas » (2017, 6). Le pouvoir, grâce à ce processus de torture et de mise à mort public, se voit confirmé par l’anéantissement de toute forme de puissance d’agir de la part de ses sujets. Dorlin conçoit certains dispositifs non comme des agencements visant à écraser la puissance d’agir (pouvoir souverain) ou à la rendre docile (pouvoir disciplinaire), mais plutôt à renverser cette puissance contre les sujets eux-mêmes ou elles-mêmes : « La technique employée semble cibler la capacité de (ré)agir du sujet comme pour mieux la dominer. » (ibid.) En ce sens, pour fonctionner, ce dispositif doit être en mesure de cerner la puissance des sujets et de l’appréhender dans une certaine direction qui permettra de la tourner contre le sujet lui-même ou elle-même. Les dispositifs de diversion et d’aversion de l’attention que mentionne Kokoszka sont, selon nous, une manière de neutraliser la puissance des sujets.
Nous avançons que l’attention et la manière dont elle est orientée et appréciée a à voir avec la capacité d’agir des sujets et, donc, avec la justice sociale. C’est en ce sens que Judith Butler (1993), abordant la perception qui avait été faite de la vidéo présentant Rodney King battu par une dizaine de policiers, dont quatre se déchaînent particulièrement, pose la question des possibilités de reconnaissabilité. Alors qu’à sa sortie la vidéo a largement outré le public et déclenché diverses manifestations antiracistes, l’analyse qui en est faite durant le procès en transforme la perception. En effet, la défense présente alors les policier·ères comme des personnes vulnérables : devant la puissance d’un grand corps noir de 1,9 mètre, que les policier·ères croyaient drogué, car il leur semblait imperméable aux coups, ceux et celles-ci apparaissent comme de possibles victimes qui craignent pour leur vie. Il devient alors possible de croire, selon le plaidoyer de la défense, que les policier·ères auraient agi en légitime défense. C’est en partant de ce retournement que Butler aborde la médiation de la perception, laquelle n’est, selon l’autrice, jamais immédiateté donnée, mais soumise à un ensemble de cadrages assignant les corps à des préconceptions différentes selon les catégories sociales. Ainsi, le corps de l’homme noir est socialement présenté, avant toute forme d’expérience perceptive individuelle, comme un corps potentiellement plus violent, animal et agressif que le corps blanc. Ce qui est produit comme visible apparaît à travers des processus et des dispositifs politiques régissant l’attention individuelle, lesquels contribuent à l’orchestration d’une distribution hiérarchique des vies humaines. Cette distribution s’appuie sur une grammaire des valeurs sociales (ce qui fait qu’une vie humaine est considérée comme « réussie »), laquelle est apprise à force de répétitions, d’habitudes, d’imitations et de significations.
La production de la visibilité est une relation entre la manière dont les cadrages sociaux sont disposés, d’une part, et la façon dont ils sont matérialisés, incarnés et habités par les sujets, d’autre part. Ainsi, apprendre à porter attention relève d’un certain usage de cette capacité qui, elle-même, est en partie garante du milieu dans lequel elle se déploie. La capacité attentionnelle, le milieu sociopolitique et le corps individuel forment un triptyque aux tonalités variant selon les caractéristiques des éléments. Il demeure cependant difficile de fixer les frontières entre ces trois domaines, lesquels font plus que s’influencer mutuellement : ils sont coconstitutifs. Pour reprendre Butler : « ce qui constitue la fixité du corps, ses contours, ses mouvements, sera entièrement matériel, mais la matérialité elle-même sera repensée comme un effet du pouvoir, comme l’effet le plus productif du pouvoir » (2018, 17). C’est en ce sens que la manière de porter attention, tout comme l’objet de l’attention, est politique.
Il y a donc un caractère politique intrinsèque à la vulnérabilité de l’attention. Cet aspect renvoie aux rapports de pouvoir qui structurent le social et font en sorte que certaines vies sont perçues comme comptant moins que d’autres. En fait, l’attention est elle-même vulnérable à la mise en scène sociale et politique de la hiérarchisation des vies. La vulnérabilité de certaines catégories de personnes sera amplifiée selon leur identité de classe, de sexe et de race. L’attention influence la reproduction des injustices sociales. Cela dit, l’attention n’est pas que pur conditionnement. Il faut un apprentissage de l’attention pour vraiment s’approcher du malheur sans anesthésier la sensibilité, d’une part, et résister aux mouvements de dispersion et d’aversion, d’autre part. Faire attention à l’autre implique de sortir de soi un instant pour se concentrer sur autrui. Cette relation, nous rappelle Weil, renferme la possibilité d’un oubli momentané de soi qui est également oubli des normes sociales. L’attention illustre alors la promesse d’un regard éthique veillant à réparer les injustices sociales qu’il s’agit désormais d’explorer à partir de l’éducation.
Attention, justice sociale et éducation
Nous avons souligné les deux tangentes liées à la vulnérabilité de l’attention. D’un côté, la manière dont l’attention est affectée par le monde facilite sa captation, que ce soit par diversion ou par aversion. De l’autre, précisément parce qu’elle est affectée par l’extériorité, l’attention est ce pont relationnel par lequel le monde éveille et happe le sujet. Celui-ci ou celle-ci se ressaisit pour diriger par lui-même ou elle-même son attention vers l’objet qui l’a affecté en consentant à entrer pleinement en contact avec ce que le réel contient d’altérité[10]. Ainsi cette seconde possibilité ouverte par la vulnérabilité de l’attention a une forte portée éthique[11]. Il apparaît dès lors important de réfléchir à une éducation de l’attention qui favoriserait l’habitude d’une certaine maîtrise de soi attentionnelle et permettrait de faire un modeste, mais réel contrepoint aux rapports de force inhérents à la mise en visibilité des vies, d’une part, et aux processus entourant l’économie de l’attention, d’autre part. Bien évidemment, ces deux états ouverts par la vulnérabilité ne sont pas exclusifs l’un à l’autre, puisqu’ils renvoient à des usages toujours situés et incarnés de l’attention, laquelle est profondément changeante. L’attention est une forme de vigilance au monde qui cherche à être stimulée et qu’il est difficile, voire impossible et non souhaitable, de contrôler et de dresser. Cela dit, l’incorporation de l’attention fait de cette capacité quelque chose qui relève d’un apprentissage. L’attention, dont le corps est le lieu d’apparition et l’outil, requiert des habitudes. Ainsi, les conditions matérielles, certains exercices et l’inspiration dans laquelle baigne la personne ont des effets importants sur le type d’attention cultivé.
Le développement par la pédagogie de la pensée individuelle, critique et réflexive des jeunes a longuement intéressé les chercheur·euses de maints acabits. Ainsi, l’activité de philosopher, en plus de son enseignement classique, est une expérience qui permet aux étudiant·es de faire non seulement l’apprentissage de la discussion, mais favorise également la mise en rapport et en question de ce qui est soit tenu pour acquis, d’une part, soit largement ignoré, d’autre part. « Philosopher oblige, en ce sens qu’il découvre au sujet une exigence à laquelle il ne saurait se dérober, un triple questionnement qui concerne simultanément son rapport à soi (Qu’est-ce que je crois exactement ?), son rapport au monde (Qu’est-ce qui m’autorise à croire ce que je crois ?) et son rapport aux autres (Comment puis-je amener les autres à croire ce que je crois juste ?) » (Galichet 2007, 160) L’expérience de soi, des autres et du monde est d’autant plus importante que l’école se transforme progressivement sous l’influence des valeurs du marché « comme l’efficacité, le rendement et l’individualisme » (Daniel 2017, 47). Cette manière de concevoir l’école a des effets sociaux importants, puisque les nouvelles générations grandissent en étant inspirées par « une épistémologie égocentrique (“je”, “moi”, “mes”) centrée sur les droits individuels […], plutôt que tournée vers l’intersubjectivité (“nous”, “nos”) qui valorise les responsabilités sociales et l’engagement » (ibid., 47). Revenant sur le rapport de l’UNESCO de 2015, Marie-France Daniel considère qu’il « devient fondamental et urgent, qu’en plus de sa mission de transmission de l’héritage culturel, l’école se donne pour mission d’apprendre aux jeunes à réfléchir de manière autonome, responsable et critique sur les informations qu’elle leur transmet, sur leurs expériences de vie et sur la société qui les façonne » (ibid.). Or, si les différentes options épistémologiques sont abordées par l’autrice afin de réfléchir aux types d’approches pédagogiques favorisant le développement d’une pensée autonome et critique, il est surprenant de constater qu’aucune place n’est faite au concept d’attention en éducation.
Pour sa part, Philippe Meirieu constate que les problématiques d’inattention et de surstimulation tendent à « transformer les objectifs de l’école en préalables de la scolarisation pour justifier la démission ou l’exclusion. C’est une opération facile, en effet, que d’inverser l’ordre des facteurs : puisque l’école ne parvient pas à former à l’attention, il lui suffit d’en faire un préalable à l’accès à l’école et de proclamer, mezza voce, « nul n’entre ici s’il n’est pas déjà attentif » (Meirieu 2014, 27). Parmi les chercheur·euses qui mentionnent la problématique de l’attention à l’école, peu étudient la pensée de Simone Weil[12].
Plusieurs philosophes dont les écrits ont influencé les approches pédagogiques rappellent combien l’attention est un défi pour l’éducateur·rice, bien qu’elle demeure l’objectif premier. Ainsi, William James affirmait déjà en 1939 :
[v]oluntary attention is thus an essentially instantaneous affair. You can claim it, for your purposes in the schoolroom, by commanding it in loud, imperious tones; and you can easily get it in this way. But, unless the subject to which you thus recall their attention has inherent power to interest the pupils, you will have got it for only a brief moment; and their minds will soon be wandering again.
1939, 103
Weil est tout à fait consciente des enjeux de l’attention. Sa pédagogie est même inséparable du concept : pour elle, apprendre c’est faire attention. L’attention relève d’une méthode par laquelle le monde entre en soi. La conception weilienne de l’attention invite notamment à l’apprentissage de « deux opérations complémentaires : détourner l’attention de tout souci de soi, et la porter vers ce que l’intelligence n’arrive pas à saisir. Mais ces deux opérations peuvent aussi être décrites comme la seule venue d’une attention pleine, qui par elle-même efface le “je”. Il y a là à la fois un effort personnel et un processus de disparition qui est au-delà de l’effort et de la dimension personnelle » (Janiaud 2002, 70). Ces deux opérations sont possibles pour toutes et tous et les moyens pour y parvenir peuvent être très divers[13].
On peut discerner à partir des écrits de Weil plusieurs éléments centraux pour une pédagogie visant le développement de l’attention. Nous en avons relevé trois que nous aimerions esquisser afin de souligner le caractère politique et social d’une éducation centrée sur le développement d’une attention profonde et relativement autonome. Ces critères comprennent : la création d’une atmosphère de sécurité dans la classe, une vision non instrumentale, en ce que les moyens du savoir surpassent en importance la finalité, ainsi qu’une certaine prudence dans l’utilisation des mots comme dans la transmission des savoirs. Si ces trois éléments ne semblent pas, au premier abord, avoir des liens avec le développement de l’attention, nous affirmons au contraire qu’ils constituent des conditions favorables, voire nécessaires, à l’apprentissage d’une attention soutenue que la personne sait diriger par elle-même. C’est peut-être là, d’ailleurs, une des originalités que nous souhaiterions relever de la pensée de Weil pour une pédagogie de l’attention : ne pas penser l’éducation de l’attention comme s’il fallait sculpter les contours de cette capacité, mais plutôt cultiver un terreau propice à son déploiement. Ces critères n’agissent donc pas directement sur l’attention et peuvent être compris plutôt comme des influences obliques favorisant l’émergence d’une attention soutenue sans pour autant l’accaparer. Ainsi, ils ne consistent pas en une captation et un dressage de l’attention, mais permettent à celle-ci de s’épanouir en l’orientant dans une certaine direction, en la nourrissant pour qu’elle s’apparaisse à elle-même dans ses possibilités d’autonomie. L’intégration de ces trois principes (sécurité, importance des moyens, prudence) dans les écoles aurait le potentiel de contribuer à une transformation majeure et positive de l’éducation de l’attention, voire de l’usage de l’attention dans la société en général.
L’attention a besoin de sécurité
Nous l’avons vu, l’attention est un effort qui doit d’abord être réveillé et par lequel le soi dépasse le « je ». Ce faisant, la personne arrive momentanément à « perdre la perspective », au sens où ni les imaginaires sociaux ni son propre égoïsme ne brouillent son contact au réel. Comment, alors, apprendre à faire cet usage de l’attention qui exige une transformation du rapport à soi ? On comprend dès lors pourquoi les questions attentionnelles sont au coeur de la pédagogie. En effet, un des rôles centraux de l’enseignant est d’être capable de susciter, d’orienter, de soutenir et d’accompagner l’attention des élèves, d’autant plus s’il s’agit d’un objet dont les significations sont difficilement déchiffrables.
Or, paradoxalement, pour Weil le rôle de l’éducateur·rice ne semble pas lié à sa capacité de susciter ou de soutenir l’attention de ses élèves. Au contraire, plusieurs documents ministériels et témoignages d’ancien·nes étudiant·es s’entendent sur le fait qu’elle ne cherchait pas à diminuer ou à camoufler l’effort que demande le processus d’attention. Ainsi un inspecteur de lettres venu évaluer son enseignement affirme dans son rapport : « À première vue, on a l’impression qu’elle ne devrait pas avoir d’action sur ses élèves : sa vue est très basse, sa voix molle, son articulation peu distincte… ses mains demeurent inertes ; mais l’intelligence active et tendue mord sur l’auditoire. » (Schweyer 2009, 559-560) Mise à part la pédagogie de Freinet[14], Weil n’était pas intéressée par les « nouvelles » pédagogies, dont elle se méfiait et qui lui semblaient surtout être des modes de séduction (ibid., 561). Inspirée par son maître Alain, pour qui « l’attention facile n’est nullement l’attention », le rôle de l’éducateur chez Weil n’est ni celui d’un·e animateur·rice ni celui d’un·e dresseur·se d’attention.
L’éducateur·rice doit plutôt veiller à ce que les conditions permettant l’avènement et l’apprentissage de l’attention soient réunies. D’abord, en créant une atmosphère de confiance, de sécurité, d’égalité et de consentement. Ces éléments constituent en quelque sorte les conditions matérielles pour le développement psychique de la forme la plus élevée d’attention. En effet, pour être en mesure de se déprendre et de se détacher de soi, il faut d’abord avoir le sentiment d’être protégé. Si la personne se sent stressée et anxieuse, peu importe que cet état soit créé par la culture institutionnelle, les collègues, l’éducateur·rice ou, encore, par sa propre imagination, elle ne se décentrera pas d’elle-même. Le sentiment de la précarité s’arrime bien souvent à une peur de la perte qui gonfle le souci de soi, dans la mesure où la personne se sent trop fragile pour ne pas penser d’abord à elle-même. Cet état est l’opposé de celui préconisé par Weil dans l’attention[15].
Selon Weil, la collectivité tend à faire pression sur les individus de telle manière que ceux et celles-ci se sentent validés surtout à travers elle. Dans une certaine mesure, la précarité est inhérente à l’état de dépendance des personnes à l’égard des collectifs. Analysant longuement les mouvements politiques et sociaux des années 1930, Weil constate que les diverses organisations collectives tendent à parasiter les capacités individuelles de penser et de porter attention[16]. Pour libérer la personne des effets des collectifs, « il faut d’un côté qu’il y ait autour de chaque personne de l’espace, un degré de libre disposition du temps, des possibilités pour le passage à des degrés d’attention de plus en plus élevés, de la solitude, du silence. Il faut en même temps qu’elle soit dans la chaleur, pour que la détresse ne la contraigne pas à se noyer dans le collectif » (1957, 21). Weil observe que la plupart des organisations sociales, à commencer par les usines, sont structurellement conçues pour vulnérabiliser les existences, faire sentir aux personnes combien elles comptent peu et sont aisément remplaçables[17].
En opposition à ce que Weil étudie en usine, une salle de classe qui préconiserait le développement de l’attention veillerait à ce que l’étudiant·e soit entouré·e de silence et d’une solitude chaleureuse lui permettant d’apprivoiser sa propre pensée sans trop d’influences et de pressions. La perte de soi momentanée propre à l’attention profonde ne s’accomplit jamais sous la contrainte des autres. Ainsi, l’attention profonde et autonome « n’est possible que dans la solitude. Non seulement la solitude de fait, mais la solitude morale. [L’attention] ne s’accomplit jamais chez celui qui se pense lui-même comme membre d’une collectivité, comme partie d’un “nous” » (ibid.). Cette solitude ne veut pas dire que la personne est laissée à elle-même, il s’agit plutôt de veiller à ce qu’elle ait la force de ne pas se perdre dans les collectifs. Dans une certaine mesure, la solitude et le silence permettent d’apprivoiser une « acceptation du vide » par le refus des réponses réconfortantes et des objectifs précis proposés par les groupes[18]. L’attention, à travers cette acceptation du vide, devient elle-même à vide, c’est-à-dire que la personne apprend à faire attention à l’attente, sans prédéterminer l’objet de son attention. Weil « rappelle avec pertinence qu’en présence de plusieurs voix – plusieurs sources de stimulation technologique simultanées – on ne peut réellement faire attention[19] ». Pour ce faire, il faut d’abord que les classes ne soient pas trop bondées d’étudiant·es, de façon à ce que l’éducateur·rice puisse être présent·e pour chacun·e en maintenant un faible volume de bruit.
Le silence fait partie, indirectement, de ce que Weil aborde lorsqu’elle mentionne le sentiment de sécurité qu’il faut favoriser autour de chaque personne. La vie sociale est ainsi faite que les plus fort·es prennent bien souvent le plus de place et font le plus de bruit. Sans nécessairement le vouloir, ils et elles noient dans leur bavardage les paroles, plus timides et moins facilement audibles, des plus faibles. En cherchant à privilégier le silence, c’est aussi une autre forme d’encouragement qui est visée dans la classe. Plutôt que de chérir les résultats, les talents, les fortes personnalités et l’expression de soi, la recherche de silence tend à briser « l’écran » qui camoufle la fragilité, la beauté et le malheur (Weil 1957, 21-22). Ainsi, le silence est une condition matérielle qui permet à l’attention de se déprendre des éléments les plus omniprésents pour tendre vers ce qui passe le plus inaperçu. C’est en ce sens que Weil conçoit l’apprentissage de l’attention comme inséparable de l’esprit de justice : « Ainsi il est vrai, quoique paradoxal, qu’une version latine, un problème de géométrie, même si on les a manqués, pourvu seulement qu’on leur ait accordé l’espèce d’effort qui convient, peuvent rendre mieux capable un jour, plus tard, si l’occasion s’en présente, de porter à un malheureux, à l’instant de sa suprême détresse, exactement le secours susceptible de le sauver. » (Weil 1966, 97)
L’attention est le moyen et la fin des études
Le silence et la solitude relative voulus par Weil ne signifient pas que l’éducation est une pure ascèse rigoriste et pénible. En fait, le désir d’apprendre est inséparable de la joie et du plaisir, et doit être protégé par l’éducateur. « La joie d’apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs. Là où elle est absente, il n’y a pas d’étudiants, mais de pauvres caricatures d’apprentis. » (ibid., 91) Cette joie culmine dans ce que l’apprentissage est compris à partir des moyens plutôt que des fins, au sens où le résultat compte bien peu, par exemple les notes scolaires, par rapport aux efforts d’attention soutenue. L’éducation, bien plus qu’un lieu de recherche de résultats, doit favoriser le développement de certaines aptitudes, dont en premier lieu la capacité de porter une attention continue dans la durée. Chacun et chacune est en mesure d’arriver méthodiquement à ce type d’attention, car il ne s’agit pas de l’excellence des facultés, qui peuvent différer, mais de l’exercice de facultés présentes chez toutes et tous. Comme le dit Weil :
Il faut donc étudier sans aucun désir d’obtenir de bonnes notes, de réussir aux examens, d’obtenir aucun résultat scolaire […] Au moment où on s’applique à un exercice, il faut vouloir l’accomplir correctement ; parce que cette volonté est indispensable pour qu’il y ait vraiment un effort. Mais à travers ce but immédiat, l’intention profonde doit être dirigée uniquement vers l’accroissement du pouvoir d’attention en vue de la prière, comme lorsqu’on écrit on dessine la forme des lettres sur le papier, non en vue de cette forme, mais en vue de l’idée à exprimer.
ibid., 88-89
Weil ne propose pas, ici, une forme de relativisme qui ferait peu de cas des bons résultats versus des mauvais : il ne s’agit pas, non plus, de négliger le rôle des savoirs pour laisser toute la place aux attitudes. Les notes ont, pour ainsi dire, une importance moyenne. Ce n’est pas que les résultats ne comptent pas, mais ceux-ci sont fédérés à la capacité à porter attention et à la maîtriser, effort qu’ils contribuent par ailleurs à développer. L’attention est, en quelque sorte, le moyen et la fin des études. Dans cet apprentissage, il importe d’accorder son attention aux fautes et aux corrections des professeurs, de façon à ce que l’étudiant fasse l’acquisition graduelle de « la vertu d’humilité » (ibid., 89). Cependant, les notes ne doivent pas prendre le dessus sur le cheminement de l’attention, mais bien accompagner son développement sans l’étouffer. Accorder trop de prestige aux résultats favorise la compétition entre les jeunes, donc le gonflement de l’égo pour certains et du sentiment de précarité pour d’autres : dans les deux cas, le regard est tourné vers soi pour mieux se démarquer ou pour survivre aux jugements des autres. Ainsi, si la « vérité » liée à la résolution d’un problème mathématique doit essentiellement être transmise, c’est en partie au travers de l’effort d’attention soutenue qu’elle exige, laquelle demande en retour, pour se déployer, un climat de confiance et de sécurité que la compétition crée par le prestige des notes et, passé un certain degré, dégrade. Il faut dès lors que l’éducateur·rice s’assure d’une atmosphère de sécurité sans pour autant faire l’impasse sur l’étude des résolutions et la contemplation des erreurs. La question du temps semble être essentielle à cet équilibre.
En effet, l’attention demande du temps et une acceptation de ce dernier. L’effort d’attention ne peut s’accomplir s’il est entravé par la peur de perdre son temps ou de vouloir faire vite, puisqu’en lui-même cet effort relève d’une création de vide en se délestant des pensées superficielles. La durée est fondamentale dans l’attention, puisque le temps joue dans la vie intérieure le rôle de l’espace : lorsqu’on doute d’un objet, dans la vie sensible, on en fait le tour. Le temps permet de faire le tour de ce que la perception de la réalité a imprégné en nous. Il en modifie les sensations et discrimine la perception imaginée du réel concrètement perçu (Weil 1997, 458). Faire l’expérience de la durée de l’attention, c’est passer de l’action d’attention, souvent crispée et volontaire, dans un premier moment, à l’état attentif où la personne a une posture d’attente à vide permettant la réception à l’extériorité, dans un second moment. L’attention, alors, prend tout l’espace de l’être : de fait, les émotions et les prestiges sociaux qui entravent et influencent la perception sont alors évacués momentanément du soi qui devient une pure médiation de l’attention.
Si Weil a longuement critiqué la séparation factice entre le travail manuel et le travail intellectuel, tout comme elle déplore le prestige associé au second et le mépris relatif entourant le premier, on retrouve en partie ce raisonnement en ce qui a trait à la culture[20]. Impliquée auprès du Groupe d’éducation sociale en 1927, Weil acquiert la certitude qu’il faut tenter d’améliorer l’estime que les ouvriers ont d’eux-mêmes. En réalité, note-t-elle, « [c]eux qui croient savoir le moins se trouvent peut-être à la fin avoir été ceux dont les autres auront le plus appris » (1988, 45). Très tôt dans ses expériences en usines, Weil observe combien la poésie, la littérature, bref, la beauté de manière générale, dans sa richesse non utilitaire, étaient peu disponibles aux classes laborieuses. Les poèmes grecs, écrit-elle, « sont tellement humains qu’ils sont encore très proches de nous et peuvent intéresser tout le monde. Ils seraient même bien plus émouvants pour le commun des hommes, ceux qui savent ce que c’est que de lutter et de souffrir, que pour les gens qui ont passé leur vie entre les quatre murs d’une bibliothèque. » (Voir notamment Weil 1953, 57) La littérature, la musique, la peinture et la poésie, dans ce qu’elles contiennent de beauté, réveillent la sensibilité et permettent l’apprentissage de certaines attitudes, notamment l’humilité et la capacité à se restreindre soi-même pour être pleinement réceptif. Saisir la beauté d’une oeuvre, c’est vouloir qu’elle reste intacte. De fait, l’art procède à un « travail sur soi, à un travail de purification à l’égard des passions dont je peux être le jouet. En me montrant attentif à ce que l’oeuvre d’art donne à voir et à penser, j’oublie pour un temps ce que je suis, et cessant d’être attentif à moi-même, je deviens attentif à la réalité du monde qui m’entoure. » (Poirier 2016, 139) Cette relation vient transformer les rapports habituels de la personne avec le réel – ici, pas de finalité de rentabilité ou de résultat, si ce n’est que de contempler : le souci de soi s’estompe au même titre que « [l]’imagination qui cherche sans cesse à combler les vides, l’imagination qui empêche de voir ce qui est devant soi » (Janiaud 2009, 620) s’épuise un instant.
Si les oeuvres d’art en général devraient être disponibles dans les écoles et dans les lieux de travail, Weil a une préférence notable pour les oeuvres qui traduisent avec justesse et sans complaisance la dureté du malheur. Le choix n’est pas personnel, mais social et anthropologique. D’abord, parce que le malheur fait perdre de la réalité, il est extrêmement difficile à partager avec autrui :
Rien n’est plus difficile à connaître que le malheur ; il est toujours un mystère. Il est muet, comme disait un proverbe grec. Il faut être particulièrement préparé à l’analyse intérieure pour en saisir les vraies nuances et leurs causes, et ce n’est pas généralement le cas des malheureux. Même si on y est préparé, le malheur empêche cette activité de la pensée, et l’humiliation a toujours pour effet de créer des zones interdites où la pensée ne s’aventure pas et qui sont couvertes soit de silence soit de mensonge. Quand les malheureux se plaignent, ils se plaignent presque toujours à faux, sans évoquer leur véritable malheur ; et d’ailleurs, dans le cas du malheur profond et permanent, une très forte pudeur arrête les plaintes. Ainsi chaque condition malheureuse parmi les hommes crée une zone de silence où les êtres humains se trouvent enfermés comme dans une île.
Weil 2002, 341-342
Les mots semblent insuffisants pour traduire l’état d’enfermement, d’irréalité et de déracinement propre à la posture toujours singulière du malheureux ou de la malheureuse.
Ensuite, les oeuvres d’art qui traduisent la dureté du malheur sont essentielles, car elles apprivoisent la pensée à l’état du malheur. Rarement la pensée s’exerce à réfléchir au malheur sans l’embaumer dans des réponses préconstruites qui en expliquent la laideur ou en diminuent la tristesse. Le caractère radicalement scandaleux et aléatoire du malheur est généralement camouflé par la pensée de façon à ce qu’elle ne soit pas réellement en contact avec lui. Dès lors, la beauté des oeuvres d’art rendant compte de la réalité du malheur permet à la personne d’avoir un premier rapport authentique au malheur et d’apprivoiser la pratique de la diminution de soi dans le processus d’attention. On se détache, d’une certaine manière, de la création, on renonce à vouloir imprimer sa marque sur le monde. Dans ce renoncement, c’est l’absence de mobile, d’intention, de convoitise et de finalité qui fait de l’étude des oeuvres d’art une activité qui dépasse toute forme de résultat pratique, rentable et tangible. Car si le malheur est hideux et est fui par la pensée, l’expression du malheur, elle, peut être éclairée de beauté et permettre à la personne d’apprendre à faire attention au malheur. Il en est ainsi des tragédies grecques, de l’Iliade, du Phèdre et d’autres. À un certain degré, l’expression du malheur et celle de la beauté se confondent, toutes deux faisant signe vers quelque chose d’impénétrable à l’intelligence, dépassant infiniment l’entendement et l’imagination, suscitant l’attention profonde. À travers le contact avec certaines oeuvres d’art traduisant le malheur, Weil croit qu’on peut cultiver un certain type d’amour, celui pour la fragilité : « La compassion pour la fragilité est toujours liée à l’amour pour la véritable beauté, parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d’une existence éternelle et ne le sont pas. » (2014, 233)
L’attention implique la prudence, et inversement
Les mots, notamment ceux des grandes oeuvres, ont donc le pouvoir de rendre visible le malheur et de faire apparaître la beauté qui l’éclaire. Car le langage, s’il est parfaitement clair, rigoureux et ordonné, « énonce des relations » (Weil 1957, 32). La beauté de l’expression du malheur peut alors se présenter comme un chemin par lequel l’attention aux malheureux devient possible. Nous terminons ici avec notre dernier critère, celui de la prudence. En effet, les mots recouvrent la possibilité de rendre visible le malheur, mais ils ont également le pouvoir de le camoufler. L’éducateur·rice doit avoir le temps de saisir et de cerner l’usage et le sens des mots, car ces derniers peuvent ouvrir des blessures ou, encore, museler des voix. La difficulté de nommer le malheur et d’exprimer les causes de ses souffrances se voit, la plupart du temps, court-circuitée par des mots-valises dont l’effet capte l’attention ailleurs qu’au coeur du problème. Ainsi « la catégorie des hommes qui formulent et les revendications et toutes choses, qui ont le monopole du langage, est une catégorie de privilégiés » (ibid., 28). L’éducation à l’apprentissage de l’attention passe dès lors par un souci constant quant à la signification des mots, à ce qu’ils donnent à voir comme relation au monde ainsi qu’à leur bagage social et historique. La prudence implique donc des conditions d’enseignement qui permettent à l’éducateur·rice d’être lui-même ou elle-même en état d’attention[21].
Cette prudence n’est pas uniquement orientée vers l’usage des mots, mais également vers la manière dont le savoir est transmis, plus précisément le goût de la « grandeur ». Car, demande Weil, « peut-on admirer sans aimer ? » (2014, 282). Au coeur de la Seconde Guerre mondiale, elle écrit :
C’est une chimère, due à l’aveuglement des haines nationales, que de croire qu’on puisse exclure Hitler de la grandeur sans une transformation totale, parmi les hommes d’aujourd’hui, de la conception et du sens de la grandeur. Et pour contribuer à cette transformation, il faut l’avoir accomplie en soi-même. Chacun peut en cet instant même commencer le châtiment d’Hitler dans l’intérieur de sa propre âme, en modifiant la distribution du sentiment de la grandeur.
ibid. 282
Il faut, selon Weil, donner d’autres exemples aux « petits garçons assoiffés de grandeur » (ibid., 282), à commencer par une nouvelle définition de ce qui est considéré comme grand. Celle-ci considère que l’éducation consiste à indiquer « ce qui est bien » (ibid., 246). Or, pour ce faire, il faut préserver une distance critique devant ce qui est présenté comme admirable. Pour la philosophe, l’impérialisme de Napoléon, le colonialisme français et Hitler sont les manifestations d’un même usage de la force, celle qui tend à aseptiser la sensibilité pour autrui de façon à ce qu’on puisse le manier comme une « chose » tout en niant son aspect radicalement scandaleux et horrible[22]. Bourreaux comme victimes, la force fait de tous ceux et celles qui y sont associé·es une chose. Elle détruit les relations entre les humains. La logique de la force déracine, comme ont fait le colonialisme et l’hitlérisme.
Ainsi, il peut y avoir divers degrés à la force, jusqu’au meurtre d’autrui ; elle trouve cependant sa racine dans un même sens mortifère de la grandeur, que Weil développe en s’inspirant de cette phrase de Thucydide : « Nous croyons par tradition au sujet des dieux, et nous voyons par expérience au sujet des hommes que toujours, par une nécessité de nature, tout être exerce tout le pouvoir dont il dispose. » (Weil 2002, 424) Pour le dire autrement, il est extrêmement rare qu’une personne s’abstienne de prendre du pouvoir sur une autre, d’autant plus si cela est facile. Pour aller à l’inverse de cette fausse grandeur, il faut dès lors se retenir et refuser de prendre toute la place qu’il nous serait possible de conquérir afin de laisser à autrui l’espace pour exister pleinement à nos yeux et aux siens. Ce rapetissement de soi est le sens premier de la véritable grandeur, puisqu’il laisse advenir entre les êtres une forme d’attention à l’autre, que Weil ne différencie pas de l’amour : « L’esprit de justice et de vérité n’est pas autre chose qu’une certaine espèce d’attention, qui est du pur amour » (1957, 36). Plusieurs exemples historiques et littéraires peuvent inspirer ce genre de grandeur vivifiante ; Weil mentionne tout autant Antigone que Jeanne D’Arc, en passant par Laurence d’Arabie et Gandhi. Quant à la grandeur meurtrière de la force, ce n’est pas qu’il faille la cacher, au contraire. Il importe de raconter les guerres, les décennies de colonialisme et de déracinements systémiques. Il ne faut absolument pas, par contre, les enrober d’un quelconque voile d’éclat. Au contraire, ces événements doivent être rendus dans leur pleine amertume, sans camoufler la laideur de la destruction et la perte incommensurable, à jamais injustifiable, de tout ce qui est affecté par la force. De cette façon, alors, l’attention envers les fort·es ne sera peut-être plus aussi facilement enivrée.
Conclusion
Nous avons vu avec Weil que n’importe quel sujet d’étude, s’il inspire une attention profonde, dépasse infiniment le savoir auquel il est associé. « Bien qu’aujourd’hui on semble l’ignorer, la formation de la faculté d’attention est le but véritable et presque l’unique intérêt des études. Tous les exercices qui font vraiment appel au pouvoir d’attention sont intéressants au même titre et presque également. » (Weil 1966, 85) En effet, l’éducation encourage habituellement une forme d’attention axée sur l’intelligence brute, celle qui emmagasine les connaissances, mais fait peu de cas d’un niveau d’attention au réel plus profond, celle que Simone Weil nomme « l’attention créatrice ». Cette seconde forme d’attention renvoie à un regard exempt de préjugé et aimant sur le monde. Selon la philosophe, les exercices scolaires devraient être réalisés dans une atmosphère d’humilité et d’acceptation du temps que cela prend, plutôt que de favoriser la compétition et la productivité. Il est également du devoir de l’enseignant·e de créer un sentiment de sécurité, de faire de l’école un abri dans lequel l’élève se sent en mesure de se laisser affecter par l’objet de son attention sans craindre d’y chercher rapidement une réponse ou, encore, sans peur de se tromper. En faisant preuve de prudence dans l’usage des mots et des inspirations privilégiés, l’éducation peut encourager la pratique d’une attention capable de cerner ce qui est camouflé par les rapports de force, à commencer par les malheureux·ses. Car l’attention libère momentanément du social et réapproprie le regard pour et par soi-même. Ainsi, « L’attention seule, cette attention si pleine que le “je” disparaît, est requise de moi. Priver tout ce que je nomme “je” de la lumière de l’attention, et la reporter sur l’inconcevable. » (Weil 1997, 252) Non seulement cette attention rend, l’espace d’un instant, le soi pleinement autonome dans son acte perceptif, mais elle donne à voir ce qui passerait autrement inaperçu. Ainsi, les malheureux·ses demeurent souvent invisibles et inaudibles, car la pensée et l’attention ont de la difficulté à se tourner vers eux et elles. Or,
ce cri [des personnes dans le malheur] ne parvient presque pas à s’exprimer […] Il faut d’abord que l’éducation publique soit telle qu’elle lui fournisse, le plus possible, des moyens d’expression. Il faut ensuite un régime pour l’expression publique des opinions, qui soit défini moins par la liberté que par une atmosphère de silence et d’attention où ce cri faible et maladroit puisse se faire entendre.
Weil 1957, 14
À défaut d’avoir un régime où l’expression publique des opinions, plutôt que d’être structurée par les voix les plus fortes, serait cultivée dans une ambiance de silence et d’attention, il nous semble que l’intégration d’une atmosphère propice au déploiement de l’attention profonde à l’école serait une manière riche et prometteuse de permettre aux générations futures d’apprendre à user par elles-mêmes de leur attention. Cette attention a le potentiel de résister, du moins en partie ou par moments, aux divers dispositifs attentionnels qui, par aversion ou par dispersion, tendent à désensibiliser d’autrui et de soi-même.
Appendices
Note biographique
Pascale Devette est professeure adjointe au Département de science politique de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les questions du tragique, de la violence, de la vulnérabilité et de l’attention. Ses travaux actuels s’inscrivent dans le champ de la pensée critique et féministe.
Notes
-
[1]
Voir à ce sujet l’arrêt R. c. Gladue rendu en avril 1999, qui a interprété pour la première fois l’alinéa 718.2e du Code criminel adopté en 1996 et l’a conçu comme une « disposition réparatrice visant à réduire la surreprésentation des peuples autochtones dans la population carcérale au moyen de la détermination de la peine » (Justice Canada 2018).
-
[2]
La littérature entourant l’autonomie relationnelle vise notamment à intégrer la dimension de la vulnérabilité au coeur du processus d’autonomie, cherchant ainsi à incarner le concept contre des visions trop rationalistes de l’autonomie. Ainsi, « reconnaître que l’autonomie est plus qu’une capacité rationnelle, mais représente aussi une situation sociale et affective spécifique permet de comprendre les rapports complexes qu’entretiennent l’individu et la société. Elle permet aussi de pointer avec plus de précision les manques, les vulnérabilités dont certains individus sont victimes et d’expliquer leur souffrance à partir de leur capacité à être autonome. L’utilisation d’une notion relationnelle d’autonomie nous amène alors à considérer l’exclusion sociale dans une toute nouvelle perspective […] S’il y a des laissés-pour-compte dans le système économique, c’est parce qu’ils ne sont généralement pas considérés et valorisés par la société et le système actuel de redistribution des richesses. Et le fait que l’on tolère encore aujourd’hui les souffrances inacceptables de populations entières pour assurer la stabilité de l’économie mondiale relève nécessairement d’un déni de reconnaissance des gens qu’on ne considère pas comme nos semblables. » (Ricard 2013 : 169)
-
[3]
Voir Phénoménologie de l’attention. Husserl a donné des cours sur le phénomène de l’attention (2009).
-
[4]
Bien qu’elle ait été formée dans les meilleures institutions, qu’elle détenait un bagage universitaire solide et une compétence philosophique rare, Weil a choisi à de nombreuses reprises de partager les duretés de son temps (en travaillant en usine, en combattant avec les anarchistes en Espagne et dans la résistance à Londres) plutôt que de se concentrer sur l’enseignement de la philosophie, carrière à laquelle elle ne s’est consacrée que quelques années. Comme nous le verrons, la pensée de Weil est toujours ancrée dans la cité, refuse les systèmes et cherche à « comprendre sans cesser de percevoir » (1959, 199). Morte à 34 ans, ses nombreux travaux sont repris actuellement dans plusieurs domaines de recherche, notamment en philosophie du travail ainsi qu’en philosophie politique et morale.
-
[5]
Notamment en éducation, qui stimule surtout la première forme d’attention selon Weil. Nous y viendrons.
-
[6]
Parfois, elle la nomme également « attention intuitive ». Intuitive ou créatrice, dans les deux cas, il s’agit d’une forme d’attention différente de l’attention rationnelle à laquelle nous faisons habituellement référence, dont le regard capte au-delà de ce que les mots peuvent saisir et décrire.
-
[7]
Alain était le professeur de Simone Weil durant ses années au lycée Henri-IV, de 1925 à 1928.
-
[8]
Pensons, par exemple, aux publicités sur Internet.
-
[9]
Nous abordons l’attention dans ses dimensions politiques, sociales et éthiques, mais il importe de mentionner que les phénomènes attentionnels sont aussi creusés à partir du prisme de l’économie. L’attention en tant que denrée vulnérable, rare et limitée devient en elle-même une valeur. En 2013, Frank écrit sur le « capitalisme mental », qu’il attribue au nouvel esprit du capitalisme au XXIe siècle. Il observe maintes transformations dans les activités économiques et sociales, notamment l’essor de la publicité, soutenue par la reproduction et la multiplication des réseaux technologiques agissant sur l’attention des particuliers. Pour lui, les modifications contemporaines sont du même niveau, en termes d’importance, que celles qui ont rendu possible le passage au capitalisme industriel. Dans les deux cas, Frank observe la transformation d’éléments issus de biens communaux ou privés vers le marché, permettant l’apparition de nouvelles relations de propriété.
-
[10]
Bien évidemment, ce saisissement est toujours temporaire, d’autant que les contours du sujet sont mouvants, plastiques et perméables aux conditions matérielles qui le forment en partie.
-
[11]
Élément central aux éthiciennes du care. Voir par exemple Laugier, Molinier et Paperman (2009) ; Ibos et al. (2019).
-
[12]
Il faut cependant mentionner certains auteur·rices qui ont traité de la question : voir notamment Janiaud (2002) ; Chenavier (2009) ; Windhorst (2011) ; et Bourgault (2016).
-
[13]
En effet, selon Weil (1966), la finalité est la même : faire attention à un problème mathématique est équivalent à l’attention portée au défrichage d’un sol.
-
[14]
Pédagogue français né en 1896, Célestin Baptistin Freinet met au point une approche basée sur la libre expression des enfants dans l’apprentissage.
-
[15]
Comme nous l’avons dit plus haut, l’attention exige une forme de déprise de soi pour se tourner pleinement vers autrui.
-
[16]
D’ailleurs, l’attention des collectifs n’est jamais, ou très rarement, dirigée vers les plus faibles, car ceux-ci sont escamotés par les plus fort·es (Weil 1957).
-
[17]
Dans La condition ouvrière, Weil observe de son expérience en usine combien la monotonie, la cadence rapide et continue, les risques de blessure, l’absence d’accomplissement associé au travail à la chaîne, l’insécurité d’emploi, l’obsession des sous, la peur et l’épuisement transforment la relation du travailleur et de la travailleuse avec le monde, réduisant sa liberté à « [u]ne docilité de bête de somme résignée [et c’est] le genre de souffrances dont aucun ouvrier ne parle : ça fait trop mal même d’y penser » (1951, 21). Pour une excellente analyse sur la place du travail dans sa pensée, voir Chenavier (2001).
-
[18]
Pour Weil (2014), la personne pense, tandis que les collectifs sont incapables de le faire. Si ceux-ci tendent à noyer les capacités individuelles de réfléchir, elle ne nie pas pour autant l’importance des milieux. L’Enracinement explore, parmi les besoins humains, celui d’avoir plusieurs racines dans plusieurs milieux diversifiés et nourrissants.
-
[19]
Voir l’article « L’attention fait toute la différence entre les hommes et les animaux » de Bourgault (2016) dans lequel il aborde avec justesse l’importance de la répétition, patiente et parfois monotone, dans l’acquisition de l’habitude attentionnelle. Nous partageons tout à fait ses propos, bien que n’ayons pas le temps d’en traiter ici. Il s’agit dans cet article d’examiner les éléments qui entourent et permettent l’avènement de l’attention, plutôt que les exercices attentionnels pratiques en eux-mêmes. Dans une certaine mesure, les exercices sont pleinement potentialisés lorsque les éléments favorisant l’épanouissement de l’attention sont réunis.
-
[20]
Sur la problématique du travail manuel et du travail intellectuel, voir Weil (1998).
-
[21]
Ce qui peut difficilement être fait si l’éducateur·rice doit gérer une classe surchargée, autant en ce qui a trait au nombre d’élèves présent·es qu’au nombre d’activités à effectuer.
-
[22]
Le terme « chose » est celui employé par Weil. Voir à ce sujet son texte admirable « L’Iliade ou le poème de la force » (1999).
Bibliographie
- Bourgault, Sophie. 2016. « “L’attention fait toute la différence entre les hommes et les animaux”. Weil et Rancière sur l’attention, l’éducation et l’émancipation. » Tumultes 46 (1) : 55-76. Numéro spécial « Oppressions et liberté. Simone Weil ou la résistance de la pensée. » Sous la direction de Pascale Devette et Étienne Tassin.
- Butler, Judith. 1993. « Endangered/Endangering: Schematix Racism and White Paranoia. » Dans Reading Rodney King / Reading Urban Uprising. Sous la direction de Robert Goodwing-Williams, 15-23. Londres : Routledge.
- Butler, Judith. 2018. Ces corps qui comptent. Paris : Éditions Amsterdam.
- Chenavier, Robert. 2001. Simone Weil, Une philosophie du travail. Paris : Cerf.
- Chenavier, Robert. 2009. Simone Weil, L’attention au réel. Paris : Michalon.
- Citton, Yves. 2014. Pour une écologie de l’attention. Paris : Seuil.
- Daniel, Marie-France. 2017. « Dignité humaine et pensée critique dialogique chez des enfants et des adolescents. » Éthique en éducation et en formation 3 : 47-68.
- Depraz, Nathalie. 2016. Attention et vigilance, À la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives. Paris : Presses universitaires de France.
- Dorlin, Elsa. 2017. Se défendre, une philosophie de la violence. Paris : La Découverte.
- Ergas, Oren. 2016. « Attention Please: Positioning Attention at the Center of Curriculum and Pedagogy. » Journal of Curriculum Theorizing 31 (2) : 66-81.
- Foucault, Michel. 1994 [1977]. « Le jeu de Michel Foucault. » Dits et écrits, Tome II. Paris : Gallimard.
- Foucault, Michel. 1999. Dits et Écrits, volume III, Paris, Gallimard.
- Frank, Georg. 2013. « Capitalisme mental. » Multitudes 54 (3) : 199-213.
- Galichet, François. 2007. « Chapitre 11. La discussion à visée philosophique et la question de la croyance. » Dans Apprendre à philosopher par la discussion. Pourquoi ? Comment ? Sous la direction de Michel Tozzi, 147-160. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.
- Garrau, Marie. 2018. Politiques de la vulnérabilité. Paris : CNRS [Centre national de la recherche scientifique] Éditions.
- Honneth, Axel. 2004. « Visibilité et invisibilité. Sur l’épistémologie de la “reconnaissance”. » Revue du MAUSS [Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales] 23 (1) : 137-151.
- Husserl, Edmund. 1989. Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique. Tome I : Introduction générale à la phénoménologie. Introduction et traduction de Paul Ricoeur. Paris : Gallimard.
- Husserl, Edmund. 2009. Phénoménologie de l’attention. Paris : Vrin.
- Ibos, Caroline, Aurélie Damamme, Pascale Molinier et Patricia Paperman. 2019. Vers une société du care, une politique de l’attention. Paris : Le Cavalier Bleu.
- James, Williams. 1939. Talk to Teachers on Psychology. Michigan : H. Holt.
- Janiaud, Joël. 2002. Simone Weil, l’attention et l’action. Paris : Presses universitaires de France.
- Janiaud, Joël. 2009. « Les hommes et les choses. De Simone Weil à elle-même en passant par Lévinas. » Archives de philosophie 72 (4) : 607-626.
- Justice Canada. 2018. La lumière sur l’arrêt Gladue : défis, expériences et possibilités dans le système pénal canadien. Ottawa : Justice Canada. https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/gladue/p1.html. Consulté le 28 juillet 2021.
- Kokoszka, Valérie. 2019. « Modalités réflexives et éthiques de l’attention chez Husserl. » Dans Valeurs de l’attention. Perspectives éthiques, politiques et épistémologiques. Sous la direction de Nathalie Grandjean et Alain Loute, 77-92. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2019.
- Lévinas, Emmanuel. 1986. De Dieu qui vient à l’idée. Paris : Vrin.
- Meirieu, Philippe. 2014. « À l’école, offrir du temps pour la pensée. » Esprit 401 (1) : 20-33.
- Moinat, Frédéric. 2010. « Phénoménologie de l’attention aliénée : Edmund Husserl, Bernhard Waldenfels, Simone Weil. » Alter 18 : 45-58.
- Molinier, Pascale, Sandra Laugier et Patricia Paperman. 2009. Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité. Paris : Petite Bibliothèque Payot.
- Poirier, Nicolas. 2016. « L’expérience esthétique chez Simone Weil. » Tumultes 46 (1) : 141-152. Numéro spécial « Oppressions et liberté, Simone Weil ou la résistance de la pensée. » Sous la direction de Pascale Devette et Étienne Tassin.
- Ricard, Laurence. 2013. « L’autonomie relationnelle : un nouveau fondement pour les théories de la justice. » Philosophiques 40 (1) : 139-169.
- Schweyer, Marc. 2009. « Simone Weil professeur de philosophie. » Dans Simone Weil. Sous la direction de Chantal Delsol, 559-560. Paris : Cerf.
- Vetö, Miklós. 1971. La métaphysique religieuse de Simone Weil. Paris : Vrin.
- Weil, Simone. 1951. La condition ouvrière. Paris : Gallimard, coll. « Espoir ».
- Weil, Simone. 1953. « Antigone. » Dans La source grecque. Paris : Gallimard, coll. « Espoir ».
- Weil, Simone. 1957. « La personne et le sacré. » Dans Écrits de Londres et dernières lettres. Paris : Gallimard.
- Weil, Simone. 1959. Leçons de philosophie, Roanne 1933-1934. Paris : Union générale d’éditions.
- Weil, Simone. 1966. « Réflexion sur le bon usage des études scolaires. » Dans Attente de Dieu. Paris : Fayard.
- Weil, Simone. 1988. Oeuvres complètes II, Cahiers 1 : Écrits historiques et politiques. L’engagement syndical (1927-juillet 1934). Paris : Gallimard.
- Weil, Simone. 1997. Oeuvres complètes VI, 2 : Cahiers (septembre 1941 - février 1942). Paris : Gallimard.
- Weil, Simone. 1998. Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale. Paris : Gallimard.
- Weil, Simone. 1999. Oeuvres. Paris : Gallimard, coll. « Quarto ».
- Weil, Simone. 2002. La condition ouvrière. Paris : Gallimard, coll. « Folio ».
- Weil, Simone. 2014. L’Enracinement, ou Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain. Paris : Flammarion, coll. « Champs ».
- Windhorst, H. Dirk. 2011. « Loving Wisdom with Dewey and Simone Weil. » Analytic Teaching and Philosophical Praxis 31 (1) : 41-55.

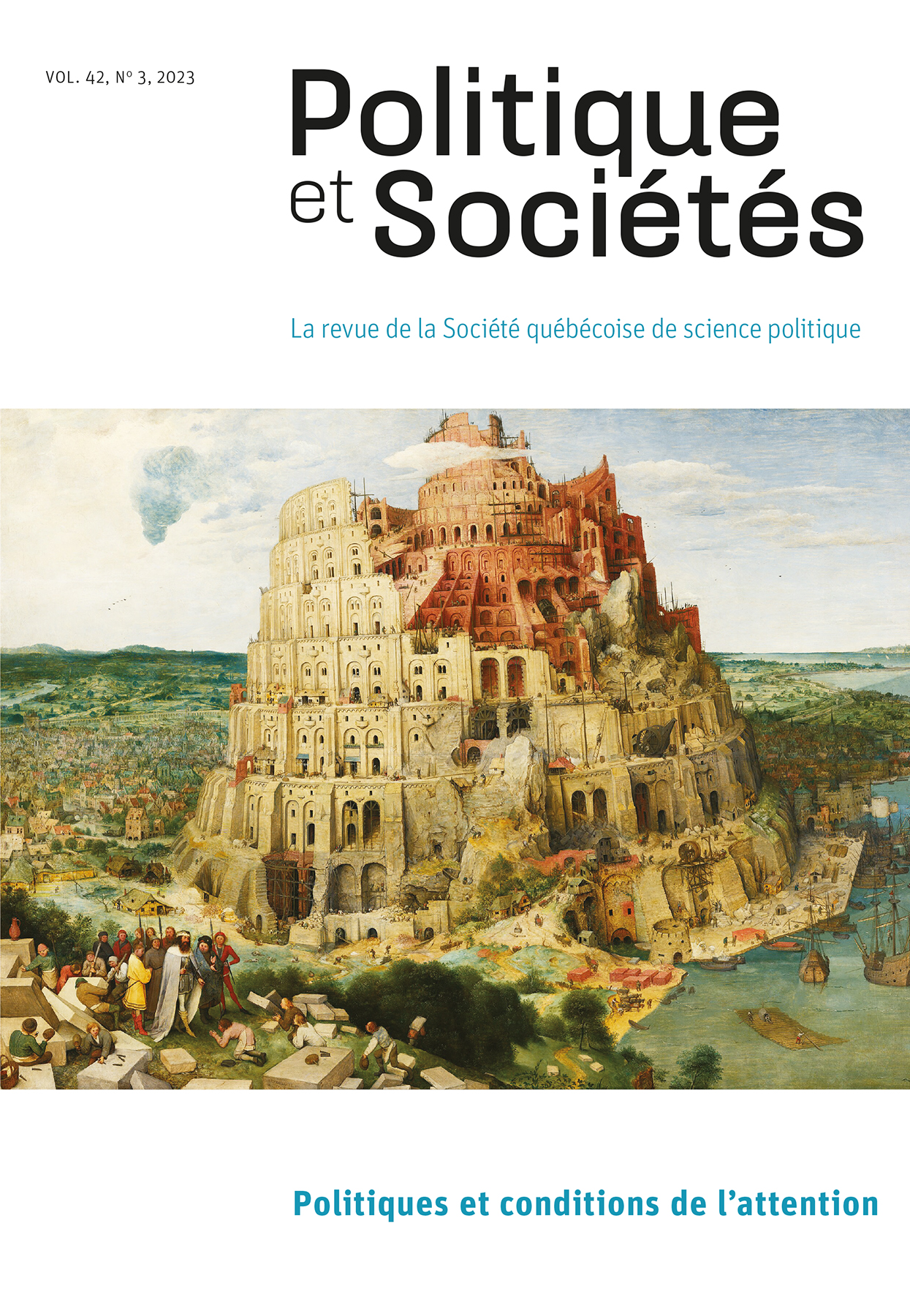
 10.7202/1042936ar
10.7202/1042936ar