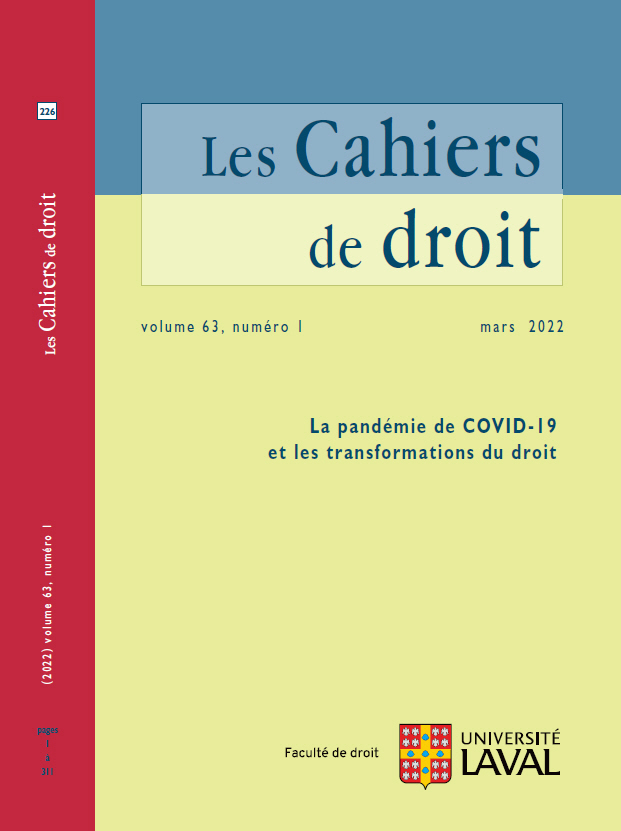Abstracts
Résumé
Les effets de la pandémie de COVID-19 sur les enjeux de santé reproductive des femmes, et sur leurs droits en cette matière, ont été peu explorés. Pourtant, l’offre de soins, leur accessibilité, les modalités entourant la prestation de ces soins ou encore leur mise en oeuvre par différents protocoles cliniques sont autant d’aspects qui ont pu être modifiés pour cause de pandémie et qui ont pu, à divers degrés, porter atteinte aux droits des femmes en matière de santé reproductive. Proposant une analyse qui se situe au confluent du droit, de la santé publique et des sciences sociales, l’autrice explore les enjeux et les défis soulevés par la pandémie au regard des droits des femmes en matière de santé reproductive, au Québec et plus largement partout au monde.
Abstract
The impacts of COVID-19 on women’s reproductive health issues, and on their rights in this matter, have received little public attention since the beginning of the pandemic. Yet the provision of care, its accessibility or the implementation of new clinical protocols are all aspects that may have been modified due to COVID-19. These modifications may, to varying degrees, violate women’s reproductive health rights. Offering a perspective that sits at the confluence of law, public health and social sciences, this article explores the issues and challenges posed by the pandemic in terms of women’s reproductive health rights.
Resumen
Poco se ha investigado sobre los efectos de la pandemia de la COVID-19 en cuestiones vinculadas con la salud reproductiva de las mujeres y sobre sus derechos en este ámbito. Sin embargo, la oferta de asistencia, su accesibilidad, las modalidades relacionadas con la prestación de estos cuidados, o incluso su implementación a través de diferentes protocolos clínicos, son aspectos que han podido ser modificados debido a la pandemia y que han podido menoscabar, en diversos niveles, los derechos de las mujeres en el ámbito de la salud reproductiva. La autora ha propuesto una perspectiva donde convergen el derecho, la salud pública y las ciencias sociales donde se exploran las cuestiones y los desafíos planteados por la pandemia con respecto a los derechos de las mujeres en materia de salud reproductiva en Quebec y a nivel mundial.
Article body
Les effets de la pandémie de COVID-19 sur les femmes et les nombreux enjeux qui en découlent occupent une certaine place dans le discours public et les médias d’information. On reconnaît ainsi que la pandémie les a particulièrement affectées, tant sur le plan de leur exposition au virus que sur celui des conséquences sociales et économiques liées aux restrictions sanitaires : pertes d’emploi plus importantes, hausse de la violence conjugale, travailleuses essentielles du milieu de la santé au front, travail des proches aidantes, conciliation travail-famille[1], etc. Les mesures prévues au budget du gouvernement fédéral canadien en avril 2021, le premier à être présenté depuis le début de la crise sanitaire, ont même été qualifiées de « solutions féministes à une récession féminine[2] ». Globalement, on peut constater que les effets de la pandémie sur les femmes et leurs droits ont été soulignés, à juste titre, au cours des derniers mois.
Certains enjeux touchant précisément les femmes sont toutefois demeurés davantage dans l’ombre de la pandémie de COVID-19, car ils ont obtenu moins d’attention publique et médiatique. Les effets de la pandémie sur leur santé reproductive sont l’un de ces angles morts. Que ce soit dans le traitement offert à celles qui sont atteintes de la COVID-19, des mesures sanitaires imposées à toutes, ou encore du délestage de certains soins et services dans les hôpitaux surchargés, des changements significatifs dans la mise en oeuvre des soins et des services reproductifs qui leur sont destinés ont été adoptés au cours des derniers mois, et ce, partout au monde. L’offre de soins, leur accessibilité, les modalités entourant la prestation de ces soins ou encore leur mise en oeuvre par l’entremise de divers protocoles cliniques sont autant d’aspects qui ont subi des modifications et qui ont pu, à divers degrés, porter atteinte aux droits des femmes en matière de santé reproductive[3].
Proposant un regard qui se situe au confluent du droit, de la santé publique et des sciences sociales, nous nous penchons dans le présent texte sur les enjeux et les défis soulevés par la pandémie de COVID-19 au regard des droits des femmes[4] en matière de santé reproductive. Pour ce faire, nous posons d’abord un regard sur le contenu et l’étendue de leurs droits en matière de santé reproductive (partie 1). Par la suite, les processus décisionnels en période d’urgence sanitaire au Québec sont explorés (partie 2), afin d’établir les balises du contexte dans lequel s’inscrit l’analyse des effets de la pandémie de COVID-19 sur ces droits. Finalement, nous démontrons que la pandémie et les mesures adoptées en vue de la freiner ont exacerbé ou ont généré des enjeux spécifiques pour les femmes et leur santé reproductive (partie 3). Nous constatons que, si des mesures restrictives des droits des femmes en matière de santé reproductive peuvent être justifiées au regard du droit, notamment parce qu’elles présentent une atteinte minimale dans un contexte de protection de la santé publique, ce n’est pas le cas pour plusieurs d’entre elles. Non seulement des mesures ne respectent pas lesdits droits, mais certaines sont même contraires aux données probantes de la science. Par ailleurs, la rapidité avec laquelle de telles mesures délétères, juridiquement ou scientifiquement, ont été revues et corrigées par les autorités est également variable, ce qui entraîne de ce fait des conséquences plus ou moins importantes sur les femmes.
1 Les droits des femmes en matière de santé reproductive : un aperçu
Avant d’aborder plus directement le contexte pandémique et les processus décisionnels qui ont mené à l’adoption de différentes mesures de protection de la santé publique, nous tenons à mettre en évidence les normes qui définissent les droits des femmes en matière de santé reproductive. Cette exploration commande d’adopter une approche pluraliste et internormative. En effet, plusieurs normes ne sont pas explicitement inscrites dans des lois ou des règlements adoptés par l’État. Toutefois, dans un contexte où la normativité intrinsèque au milieu de la santé est souvent perçue comme autant, voire davantage contraignante que ne peut l’être le droit positif[5], une approche large permet de préciser plus exactement l’éventail de droits reconnus aux femmes en vertu, par exemple, de recommandations et de lignes directrices émanant d’associations internationales.
D’abord, plusieurs droits fondamentaux reconnus dans la Charte canadienne des droits et libertés[6] ou la Charte des droits et libertés de la personne[7] s’appliquent aux femmes dans le contexte particulier de leur santé reproductive. La professeure Louise Langevin en fait une synthèse sous l’appellation de « droit à l’autonomie procréative », que nous emploierons également dans notre texte[8]. Les droits à la dignité, à la liberté, à la sécurité, à l’intégrité[9] et à l’égalité[10] sont ainsi mobilisés par cette reconnaissance de l’autonomie procréative des femmes. L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Morgentaler[11] constitue certainement une décision phare pour la reconnaissance de leur autonomie décisionnelle en matière de santé reproductive, car il s’appuie sur les droits à la dignité, à la liberté et à la sécurité. Dans cette décision qui a invalidé une disposition du Code criminel qui n’autorisait que l’avortement thérapeutique, tel que déterminé par un comité composé de trois médecins, la juge Wilson mentionne qu’« un aspect du respect de la dignité humaine sur lequel la Charte est fondée est le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales sans intervention de l’État. Ce droit constitue une composante cruciale du droit à la liberté[12] ». Dans ses motifs, le juge en chef Dickson, quant à lui, souligne les atteintes à l’intégrité et à la sécurité des femmes portées par le recours obligatoire à un comité évaluant la nécessité thérapeutique de l’avortement, ce processus générant des délais et reposant sur des « critères totalement sans rapport » avec les priorités et les aspirations de la femme visée. Ce faisant, les balises du droit criminel qui encadrent le recours à l’avortement portent « clairement atteinte à l’intégrité corporelle, tant physique qu’émotionnelle d’une femme » et constituent « une ingérence grave à l’égard de son corps et donc une violation de la sécurité de sa personne »[13].
Pour ce qui est du droit à l’égalité, il se manifeste lorsqu’on tient compte des effets du sexe « femme » sur différents aspects de la santé reproductive et de la relation mère-enfant[14]. La question de l’égalité entre les sexes, dans le contexte de la grossesse, a été soulevée par les deux seules femmes siégeant à la Cour suprême à ce moment-là — les juges McLachlin et L’Heureux-Dubé — dans l’arrêt Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson[15]. La décision portait sur la responsabilité délictuelle (en common law) d’une femme enceinte à l’égard des dommages subis par son enfant in utero, ce dernier étant né avec de multiples handicaps à la suite d’un accident de voiture dont la mère était responsable. Tout comme la majorité de leurs collègues à la Cour suprême, les juges McLachlin et L’Heureux-Dubé rejettent la possibilité pour un enfant de poursuivre sa mère en raison des préjudices subis in utero, en justifiant d’autant cette position que le contraire constituerait une discrimination à l’égard des femmes :
En général, les Canadiens sont entièrement libres de décider ce qu’ils mangeront ou boiront, de choisir leur lieu de travail et de se déterminer dans leur vie personnelle. Les femmes enceintes, cependant, seraient privées de ce droit. En plus d’être assujetties à l’obligation habituelle de se conduire prudemment dans l’exercice des activités humaines, les femmes enceintes feraient l’objet de toute une gamme de restrictions supplémentaires. N’importe qui peut éviter de commettre un délit en s’isolant des autres membres de la société. La femme enceinte, elle, ne le peut pas. Elle porte le foetus 24 heures par jour, sept jours par semaine[16].
Lorsqu’il est question d’autonomie procréative et de droits des femmes quant à leur santé reproductive, les droits fondamentaux prévus dans les chartes sont généralement interprétés comme conférant une obligation de non-ingérence pour l’État, soit l’obligation de ne pas faire obstacle à cette autonomie procréative, plutôt que d’adopter des mesures positives pour la mettre en oeuvre[17]. C’est ainsi, par exemple, que la vente de contraceptifs et l’accès à l’information à leur sujet ont été décriminalisés au Canada en 1969[18]. Cette décriminalisation ne garantit pas un accès aux contraceptifs, mais elle ne pénalise pas leur utilisation[19]. De la même façon, l’avortement ne constitue plus un acte criminel, mais le droit canadien ne reconnaît pas un droit positif à l’avortement[20].
Par ailleurs, certaines lois prévoient expressément des normes dont l’objectif est de protéger les droits des patientes en matière de soins de santé. Le Code civil du Québec énonce d’abord le principe de l’inviolabilité de la personne et son droit à l’intégrité[21]. Ce droit s’articule principalement, au regard des soins de santé, autour de la nécessité d’obtenir un consentement libre et éclairé de la part de la patiente avant d’accomplir quelque geste que ce soit[22]. Le droit au consentement libre et éclairé est également mentionné dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux[23]. Celle-ci prévoit aussi plusieurs droits d’importance pour les femmes en matière de santé reproductive, soit le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources à leur disposition[24], le droit de choisir son professionnel et son établissement[25], le droit d’accès au lieu du service de santé offert[26], le droit de participer à toute décision concernant sa santé ou son bien-être[27], de même que le droit d’être accompagnée et assistée par une personne de son choix dans l’obtention d’informations et les démarches relatives à ses soins[28].
En matière de soins de fertilité[29], il existe peu de normes créant des droits positifs pour les femmes. Des services sont offerts et peuvent être accessibles, mais leur couverture par le régime public de santé est variable, et ces soins nécessitent donc généralement un investissement financier important de la part des femmes qui y ont recours. Une loi fédérale et une loi québécoise encadrent l’offre de soins de fertilité. La Loi sur la procréation assistée[30] est principalement une loi pénale, relevant de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Elle proscrit certaines pratiques relatives à la procréation assistée, comme la manipulation génétique des embryons, et met en place des exigences spécifiques pour les consentements à obtenir quant à l’utilisation du matériel reproductif prélevé aux fins des soins de fertilité. De son côté, la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée[31] encadre l’organisation et la prestation des soins de santé relatifs à la procréation assistée au Québec. Cette loi prévoit notamment qu’un seul transfert d’embryon est autorisé par cycle de fécondation in vitro (FIV), sauf circonstances particulières justifiant le transfert de deux embryons[32]. Par ailleurs, de nouvelles dispositions législatives sanctionnées, mais non encore en vigueur à ce jour, prévoient des modifications à la couverture des traitements de fertilité par le régime public d’assurance maladie au Québec[33]. Actuellement, l’État québécois rembourse neuf cycles d’insémination artificielle, mais aucun cycle de FIV ; les modifications adoptées permettront la prise en charge par la Régie de l’assurance maladie de six cycles d’insémination artificielle et d’un cycle de FIV[34]. Au-delà de cette couverture, le recours à des soins de fertilité demeure à la charge financière des femmes et des couples qui souhaitent en bénéficier. Si les femmes n’ont pas droit à des soins de fertilité, il n’en demeure pas moins que ces soins sont accessibles, à certaines conditions, et que leur accès doit se faire dans le respect de leurs droits fondamentaux, notamment leurs droits à la dignité, à l’intégrité et à l’autonomie, et ce, sans discrimination.
Hormis les droits fondamentaux et les droits généraux reconnus par les lois à toute patiente dans le contexte des soins de santé qu’elle reçoit, déterminer les droits des femmes en matière de soins liés à la maternité — suivi de grossesse, accouchement, soins postnatals — impose de se détourner du droit positif pour préciser les normes de soins et de pratiques reconnues par les instances internationales comme étant pertinentes et appropriées. C’est ainsi que l’organisation internationale Human Rights in Childbirth[35] désigne quatre catégories de droits propres à la maternité :
-
le droit d’avoir ou de ne pas avoir d’enfant ;
-
le droit de ne pas être séparée de son enfant ;
-
le droit de prendre soin de son enfant selon ses valeurs culturelles, spirituelles et communautaires, dans le respect des droits des femmes et des enfants ;
-
le droit de choisir le type d’accouchement souhaité, y compris le droit de décider du professionnel de santé, de l’accompagnant ou des accompagnants à la naissance, des options de traitements et des circonstances de la naissance (par exemple, le lieu de naissance)[36].
De la même façon, Birthrights, organisme de défense des droits du Royaume-Uni, reconnu internationalement, indique des droits fondamentaux que toute femme enceinte devrait pouvoir faire valoir, notamment le droit de consentir à tout traitement et de le refuser, le droit de recevoir des soins conformes aux standards de pratique reconnus, et sans discrimination, le droit de bénéficier de méthodes de soulagement de la douleur qui soient médicalement appropriées, le droit à ce que ses choix soient respectés sans égard à l’intérêt du foetus[37], le droit à la présence d’un accompagnant à la naissance[38] et le droit de choisir le lieu où donner naissance[39].
Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière de soins prénatals et périnatals (intrapartum)[40] offrent également des informations intéressantes afin de mieux circonscrire les normes de soins et de pratiques auxquelles les femmes sont en droit de s’attendre. Parmi ces recommandations, on trouve, entre autres, un suivi prénatal prévoyant au moins huit contacts avec le soignant ou la soignante[41], l’utilisation de la péridurale pour les femmes enceintes en bonne santé qui le demandent et selon leurs préférences[42], la prise de liquide et de nourriture par voie orale durant l’accouchement, la mobilité et la position verticale pendant le travail, le libre choix de la position d’accouchement par la femme (même sous péridurale)[43], le contact peau à peau entre la mère et le nouveau-né au moins durant une heure suivant la naissance, l’initiation à l’allaitement le plus rapidement possible après la naissance (si la mère et l’enfant sont prêts)[44], le fait de laisser la mère et l’enfant dans la même pièce en tout temps (24 heures sur 24), et un séjour d’au moins 24 heures après la naissance dans l’établissement de soins[45]. Enfin, les lignes directrices pour des établissements adaptés aux mères et aux bébés, adoptées conjointement par la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique, la Confédération internationale des sages-femmes, la White Ribbon Alliance, l’Association internationale de pédiatrie et l’OMS, reconnaissent notamment le droit des femmes d’être accompagnées par au moins un partenaire durant le travail et l’accouchement, de recevoir des soins conformes aux données probantes (par exemple, la cohabitation constante de la mère et de l’enfant dès la naissance) et de pouvoir faire du peau à peau avec le nouveau-né dès sa naissance[46].
Au Québec, l’Institut national de santé publique remet un guide à chaque femme en début de suivi de grossesse, document où sont abordés plusieurs de ces éléments dans les réflexions suggérées aux femmes pour préparer leur plan de naissance : l’accompagnement à la naissance notamment par une doula (personne formée en périnatalité qui soutient et conseille les femmes avant, pendant et après leur accouchement), les méthodes de gestion de la douleur souhaitées, les interventions médicales qui pourraient être acceptées ou refusées, le cas échéant, le contact peau à peau au moment de la naissance, les interventions désirées ou non après la naissance et le choix du mode d’alimentation du bébé[47]. Ainsi, bien que ces normes ne constituent pas des « droits » au sens du droit positif, il n’en demeure pas moins qu’elles créent des attentes légitimes pour les femmes.
Les éléments discutés jusqu’à présent n’offrent qu’un rapide survol des normes, pluralistes et internormatives, qui façonnent les droits des femmes en matière de santé reproductive. Dans le cas de la vaste majorité des droits que nous venons de mentionner, la non-reconnaissance de droits positifs pour les femmes pose de réels enjeux en matière d’effectivité du droit. En effet, si l’État ne peut faire obstacle au droit à leur autonomie procréative, il n’a cependant pas à offrir des services spécifiques[48]. Ainsi, plusieurs barrières sont toujours présentes pour un nombre important d’entre elles : non-disponibilité des services sur leur territoire, coûts financiers associés à des traitements non couverts par les régimes étatiques d’assurance maladie ou médicaments, facteurs socioéconomiques accroissant leur vulnérabilité sur le plan de leur santé reproductive (facteurs ethniques et culturels, revenus familiaux, niveau de scolarité, etc.), difficultés à faire valoir les atteintes et les préjudices subis devant les tribunaux, etc. L’examen minutieux des effets du contexte de la pandémie de COVID-19 nous permettra de constater que, bien souvent, les mesures adoptées ont exacerbé ces enjeux.
2 Le contexte d’urgence sanitaire au Québec : une analyse des processus décisionnels
L’analyse des effets de la pandémie de COVID-19 sur les droits des femmes en matière de santé reproductive ne peut se faire sans aborder sommairement le contexte décisionnel propre à une situation d’urgence sanitaire. La plupart des décisions entraînant des modifications dans l’offre de soins de santé reproductive des femmes, l’accès à ces derniers ou leur mise en oeuvre ont en effet eu lieu dans un contexte où des états d’urgence sanitaire étaient décrétés. Nous considérerons ci-dessous la situation spécifique du Québec : ainsi, nous explorerons le contexte décisionnel étatique lié à un état d’urgence sanitaire, en étudiant d’abord à la fois le cadre juridique et les considérations propres au domaine de la santé publique (2.1). Le cadre décisionnel qui doit guider l’adoption des mesures et des normes sera par la suite mis en relation avec les biais qui influent sur la perception des risques en matière de santé publique et sur la prise de décisions politiques et juridiques (2.2).
2.1 Un aperçu du cadre décisionnel de l’État en contexte d’urgence sanitaire
L’état d’urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle prévue dans la Loi sur la santé publique[49]. Utilisée pour la première fois au Québec le 13 mars 2020[50], cette mesure était toujours en vigueur en date du 1er juin 2021[51]. Les dispositions en balisant le décret et la mise en oeuvre se trouvent aux articles 118 et suivants de la Loi sur la santé publique. En premier lieu, l’article 118 prévoit que l’état d’urgence sanitaire ne peut être déclaré que dans les situations où « une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger la santé de la population ». Ces mesures d’urgence, exceptionnelles, comprennent notamment la vaccination obligatoire, la fermeture des écoles, l’imposition du confinement ou encore l’interdiction d’accès à certains territoires[52]. Si la Loi sur la santé publique définit la menace à la santé de la population comme « la présence au sein de celle-ci d’un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie si la présence de cet agent n’est pas contrôlée[53] », elle est muette sur la qualification grave de cette menace. Ainsi, le caractère grave de la menace s’appréciera à l’aune des moyens nécessaires pour protéger la santé de la population ; si l’application de mesures exceptionnelles prévues par l’article 123 de la Loi sur la santé publique se révèle nécessaire, la menace pourra être qualifiée de grave dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire[54].
Lorsque l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, d’importants pouvoirs qui incombent généralement au législateur sont dévolus au gouvernement, voire au ministre de la Santé et des Services sociaux, qui peut dès lors adopter des mesures « sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population[55] ». Si les pouvoirs conférés au gouvernement, au ministre et même au directeur national de santé publique[56] sont extrêmement larges, un aspect fondamental demeure tout de même essentiel à la légalité de toute mesure adoptée dans ce contexte : elle doit être nécessaire pour protéger la santé publique devant la menace[57]. À cet encadrement rigoureux de l’exercice du pouvoir gouvernemental en cas d’état d’urgence sanitaire précisé à même la Loi sur la santé publique s’ajoutent également les balises constitutionnelles en cas d’atteinte aux droits et aux libertés reconnus par la Charte canadienne[58] et la Charte québécoise[59]. En effet, les restrictions sanitaires imposées au nom de la santé publique sont susceptibles de porter atteinte aux droits et aux libertés, par exemple le droit à la liberté, le droit à la vie privée, la liberté de religion ou encore la liberté d’association. De telles atteintes ne pourront être légales que dans la mesure où elles sont justifiées en vertu de l’article premier de la Charte canadienne ou de l’article 9.1 de la Charte québécoise, et suivant le test élaboré par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Oakes[60]. Pour ce faire, il est nécessaire de démontrer que la mesure vise la poursuite d’un objectif réel et urgent, engendre une atteinte minimale aux droits et aux libertés protégés, et que la valeur de l’objectif poursuivi de même que les bénéfices et les désavantages qui y sont associés sont proportionnels aux conséquences de l’atteinte aux droits et libertés[61].
Concrètement, quels sont les principes sur lesquels doivent alors reposer les mesures adoptées en vertu de l’état d’urgence sanitaire pour respecter à la fois les balises intrinsèques de la Loi sur la santé publique et les impératifs constitutionnels de protection des droits et des libertés de la personne ? Dans un contexte de santé publique, il est d’abord essentiel que les mesures soient fondées, autant que cela est possible, sur des données scientifiques de qualité[62]. Cependant, et considérant que l’état d’urgence sanitaire découle de la propagation d’un nouveau virus[63], ces données sont parfois inexistantes, lacunaires, et évolueront au fur et à mesure que l’état des connaissances s’approfondira et se modifiera. Les professeurs Colleen Flood, Brian Thomas et Kumanan Wilson proposent dès lors que le principe de précaution, en complément d’une approche fondée sur la justification des atteintes au sens des chartes, guide les gouvernements dans l’adoption et la mise en oeuvre des mesures sanitaires[64]. À l’instar de ces auteurs, le Comité d’éthique en santé publique et la Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec sont d’avis que le principe de précaution constitue un fondement approprié à la prise de décision gouvernementale en contexte d’endiguement de la pandémie[65].
Le principe de précaution s’applique lorsque les incertitudes scientifiques sont importantes, et ne permettent pas d’appuyer les décisions de santé publique sur des données probantes solides. Il prévoit globalement « qu’il faut se prémunir contre de potentielles conséquences négatives d’événements ou d’actions en cours ou à venir[66] », sans que le manque ou l’absence de données robustes empêche les décideurs publics d’agir. On y trouve l’idée que, plus le risque pour la population est grand, moins la démonstration scientifique de l’efficacité des mesures envisagées pour y faire face sera nécessaire[67]. Cependant, une application trop précipitée du principe de précaution pour prévenir un risque peut causer d’autres effets délétères sur la santé, ce qui a donné lieu à certaines critiques de l’utilisation de ce principe en santé publique[68]. Devant les enjeux qui découlent de l’application du principe de précaution, le concept a évolué pour tenir compte expressément de la proportionnalité entre le risque redouté et les mesures adoptées, la cohérence avec des mesures analogues déjà adoptées, la prise en considération des bénéfices et des risques potentiels des mesures dans une perspective large de santé populationnelle ainsi que la nécessité de prévoir des mécanismes de révision à la lumière des nouvelles données scientifiques[69]. Cette évolution est d’ailleurs reflétée dans les travaux du Comité d’éthique de santé publique et de la Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec, qui reconnaissent expressément dans leurs rapports sur la pandémie de COVID-19 que la proportionnalité entre les bénéfices anticipés des mesures et leurs effets négatifs sur la santé globale de la population doit être au coeur des valeurs sous-jacentes à l’application du principe de précaution[70].
2.2 Les biais qui teintent la prise de décision
Malgré les apparences de cadre décisionnel rationnel et objectif, le principe de précaution n’est pas purement neutre dans son application. Comme le soulignent les auteurs du rapport Enjeux éthiques de la pandémie de COVID-19 : précaution et déconfinement, « l’évocation du principe de précaution comporte un volet éminemment politique, et est donc soumis à la délibération et à l’acceptation publique. Ainsi, la perception des risques par la population visée et le niveau de confiance que celle-ci exprime à l’endroit des autorités jouent un rôle non négligeable dans l’actualisation des mesures[71] ». De la même façon, lorsqu’il est question de la justification des atteintes aux droits et libertés en vertu des chartes, Flood, Thomas et Wilson mentionnent que les tribunaux modulent l’application du test de l’arrêt Oakes en fonction de la nature des mesures qui sont contestées. Par exemple, des règles de droit criminel verront un fardeau de preuve plus important reposer sur le gouvernement dans sa justification de l’atteinte qui est portée aux droits et aux libertés des individus ; au contraire, une plus grande déférence sera réservée à l’État lorsqu’il adopte des mesures qui impliquent des compromis multiples et complexes entre les droits et les obligations de divers groupes d’individus[72]. On comprend de cette approche pragmatique du test de l’arrêt Oakes qu’une grande majorité des mesures adoptées en contexte d’état d’urgence sanitaire pour freiner la propagation d’une pandémie entrent de facto dans la catégorie des règles complexes qui mettent en jeu une pluralité d’intérêts divergents, dont la protection de personnes particulièrement vulnérables.
Dans le cas de l’application de ce cadre décisionnel aux mesures et aux directives adoptées par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il importe de se demander si le « volet éminemment politique », la perception des risques et la latitude accordée à l’État pour justifier des atteintes potentielles aux droits et aux libertés peuvent emporter certains biais dans la conception même des mesures mises en oeuvre pour freiner ladite pandémie. La psychologie et les sciences cognitives ont démontré que des biais cognitifs et des heuristiques[73] ont une influence non seulement sur les décisions politiques[74], mais également sur les jugements des tribunaux[75] et sur l’interprétation donnée aux risques[76]. Quant à la perception des risques, les recherches démontrent par exemple un « effet de l’homme blanc », soit un écart significatif dans la perception de la gravité de certains risques entre les hommes blancs et les femmes blanches, et entre les hommes blancs et les personnes noires des deux genres ; les « hommes blancs » perçoivent moins de risque dans la vaccination, la peinture au plomb, les centrales nucléaires ou le port d’armes à feu[77]. En matière de décisions judiciaires, une étude a démontré que les juges devant se prononcer sur des demandes de libérations conditionnelles sont moins portés à accorder ces dernières lorsqu’ils doivent rendre leurs décisions en fin d’avant-midi ou en fin d’après-midi, simplement parce qu’ils ont faim[78]. Dans un contexte décisionnel d’état d’urgence sanitaire où, au surplus, beaucoup de décisions doivent être prises rapidement, on conçoit que ni l’application du principe de précaution ni l’appréciation d’une justification à une atteinte aux droits en vertu du test de l’arrêt Oakes ne seront parfaitement « objectives ».
En matière de droits des femmes et de santé reproductive, les biais cognitifs qui ont trait au genre sont d’un intérêt particulier parce qu’ils auront une incidence certaine sur les normes et les mesures prises à leur égard. Par exemple, dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.)[79], la Cour suprême s’est prononcée sur l’atteinte aux droits fondamentaux d’une mère dans un contexte où ses enfants faisaient l’objet d’une procédure de retrait par les services sociaux, et qu’elle ne pouvait bénéficier de la représentation d’un avocat, faute de moyens financiers et d’accès à l’aide juridique. Dans cette décision, il est notamment question du droit à la sécurité garanti par l’article 7 de la Charte canadienne :
Pour qu’une restriction de la sécurité de la personne soit établie, il faut donc que l’acte de l’État faisant l’objet de la contestation ait des répercussions graves et profondes sur l’intégrité psychologique d’une personne. On doit procéder à l’évaluation objective des répercussions de l’ingérence de l’État, en particulier de son incidence sur l’intégrité psychologique d’une personne ayant une sensibilité raisonnable. Il n’est pas nécessaire que l’ingérence de l’État ait entraîné un choc nerveux ou un trouble psychiatrique, mais ses répercussions doivent être plus importantes qu’une tension ou une angoisse ordinaires[80].
En pratique cependant, l’appréciation dite « objective » de la raisonnabilité n’est pas neutre : « Historically, the socially constructed reasonable person has been skewed toward the traditional views held by those in power. These tend to reflect a male viewpoint, simply because men were in control of the apparatus of the law for so long[81]. » D’ailleurs, il est intéressant de noter que, dans l’arrêt Nouveau-Brunswick, seulement trois juges sur sept, dont les deux seules femmes qui siégeaient dans cette affaire (les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin), ont noté l’aspect genré de l’atteinte au droit à la sécurité de la mère et l’aspect essentiel du droit à l’égalité :
Avant d’aborder l’analyse des droits garantis par l’art. 7 mis en cause ainsi que les principes de justice fondamentale, j’aimerais souligner que la présente affaire comporte également des questions relatives à l’égalité garantie par l’art. 15 de la Charte […] La présente affaire soulève des questions relatives à l’égalité des sexes, car les femmes, notamment les mères célibataires, sont touchées, de façon disproportionnée et particulière, par les procédures relatives à la protection des enfants[82].
Par ailleurs, on a assisté au cours de la pandémie de COVID-19 à la mise en place de normes et de mesures qui imposent largement une gestion des risques individualisée plutôt que collective, c’est-à-dire misant sur une responsabilisation des individus par rapport aux risques sanitaires, au lieu d’engager une prise en charge collective par l’État ou les industries[83]. Au Québec, une critique de cette approche a souvent été formulée à l’encontre du gouvernement pour sa stratégie ciblant les comportements individuels (port du masque, interdiction des contacts sociaux, couvre-feu) au détriment d’approches plus systémiques, comme l’adoption des tests de dépistage rapides en entreprise, ou encore la ventilation dans les écoles[84]. Cette approche de la gestion de risques peut avoir des conséquences plus grandes sur les femmes dès lors que la relation mère-enfant est en jeu, puisque les biais de genre créent une attente « raisonnable » ou « normale » que la mère prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger son enfant, même au détriment de ses propres besoins et de ses propres droits[85].
Ainsi, nous venons de mettre en lumière que le cadre décisionnel gouvernant la prise de décision étatique en temps de pandémie et d’état d’urgence sanitaire est complexe, et qu’il ne peut s’analyser sous le seul regard du droit ; la compréhension du cadre d’analyse propre à la santé publique, plus précisément le principe de précaution, s’avère également nécessaire. Toutefois, tant l’appréciation des risques concernant la santé publique que l’application du droit positif sont susceptibles d’être — et, en fait, sont — influencés par différents biais et préjugés qui teintent, souvent inconsciemment[86], la prise de décision. À la lumière de ce constat et du cadre normatif que nous avons abordé dans la première partie de notre texte, nous montrerons dans ce qui suit que bon nombre d’enjeux ayant trait aux droits des femmes en matière de santé reproductive ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19, et que les mesures adoptées au nom de la santé publique ont pu porter atteinte à ces droits.
3 Quelques enjeux de santé reproductive des femmes en temps de pandémie
Nous proposons d’observer maintenant les modifications qui ont eu cours dans l’offre, l’organisation et la prestation des soins de santé reproductive depuis le début de la pandémie de COVID-19, afin d’en analyser les effets sur les droits des femmes. Nous prêterons attention particulièrement au contexte québécois, et nous rapporterons également différentes situations provenant des expériences étrangères pour illustrer les atteintes à leurs droits en matière de santé reproductive. À noter que nous avons divisé les soins de santé reproductive en trois catégories distinctes aux fins de l’organisation de notre texte, mais rappelons qu’ils constituent pour certaines femmes un continuum qui aura été vécu en entier au cours des 16 derniers mois pandémiques : les soins d’interruption volontaire de grossesse (IVG) et de fertilité (3.1), les soins prénatals (3.2) de même que les soins liés à l’accouchement et à la période postnatale (3.3).
3.1 Les soins de fertilité et d’interruption volontaire de grossesse
Dès le début de la pandémie de COVID-19, les soins de fertilité ont rapidement été considérés comme non essentiels : ce faisant, la plupart des protocoles de soins ont été arrêtés. Au Québec par exemple, les cliniques de fertilité ont complètement cessé leurs activités de mars à juin 2020[87]. Les services de fertilité durant les premiers mois de la pandémie ont également été suspendus, entre autres, au Canada[88], en Israël[89], au Royaume-Uni[90] et aux États-Unis[91]. Alors que les processus de soins de fertilité ont déjà des effets considérables sur la qualité de vie ainsi que sur la santé mentale et physique des femmes[92], les études réalisées auprès de patientes dont les traitements de fertilité ont été mis sur pause à un moment ou l’autre de la pandémie démontrent des hausses significatives de stress, d’anxiété et de dépression, ce qui a amené les auteurs de ces recherches à s’interroger sur la pertinence de la suspension de ces soins jugés non essentiels :
Emerging research is indicating that prolonged periods of lockdown are detrimental to fertility patients and wider society […] and it is questionable as to whether subsequent waves of COVID-19 should result in fertility clinic closure again. Indeed, the number of expected births compromised by the lockdown « might be as significant as the total number of deaths attributed to the COVID-19 pandemic »[93].
Soulignons d’ailleurs qu’au Québec les vagues subséquentes de propagation de la COVID-19 (automne 2020 et hiver 2021) n’ont pas donné lieu à la suspension des soins de fertilité, conformément aux recommandations de la Société canadienne de fertilité et d’andrologie[94].
Au regard de notre recension de littérature effectuée pour la présente recherche, les enjeux entourant la pandémie de COVID-19 et l’accès aux IVG ont peut-être été les plus documentés et commentés. Dans un contexte où l’accès à ces soins est déjà limité ou menacé dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis[95], on peut comprendre que c’est là un sujet prioritaire pour le droit des femmes à leur autonomie procréative. Le gouvernement du Québec a pris position à cet égard, dès le début de la pandémie, et a choisi de maintenir l’accès et les services d’IVG[96] : il a demandé à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) d’évaluer la meilleure manière de maintenir ces services, tout en diminuant au maximum les risques de transmission du coronavirus. Les conclusions de l’INESSS recommandent de privilégier la pilule abortive à la chirurgie pour les grossesses de neuf semaines ou moins, et de favoriser la prise de cette pilule au domicile de la femme plutôt que sous supervision d’un professionnel de la santé, si cette façon de faire est jugée sécuritaire par le prescripteur[97]. La diminution du nombre d’avortements réalisés en 2020 au Québec semble d’ailleurs s’expliquer davantage par une baisse du nombre de grossesses non désirées — due aux mesures de distanciation sociale et de la fermeture des bars, notamment — que par une difficulté d’accès aux services[98]. La position et les mesures adoptées au Québec nous paraissent un bon exemple de proportionnalité des moyens relativement à la menace sanitaire, d’équilibre juste et approprié entre le respect des droits des femmes et la protection de la santé publique.
Malgré des mesures sanitaires officielles qui reconnaissent le caractère essentiel des IVG, il n’en demeure pas moins que l’effectivité de l’accès à ces soins peut être compromise par la pandémie de COVID-19. Dans certaines provinces canadiennes, malgré les positions officielles des gouvernements qui ont maintenu les services d’IVG, le faible nombre de cliniques qui offrent ces services peut impliquer des déplacements sur de longues distances pour les femmes qui désirent y accéder, lorsque ces allées et venues sont même possibles. Si l’accès géographique à un avortement était déjà un enjeu pour plusieurs Canadiennes avant la pandémie[99], cette dernière a entraîné des mesures de suspension de certains moyens de transport (comme des autobus interurbains, par exemple) qui ont d’autant réduit l’accès effectif aux services d’IVG[100].
Par ailleurs, certains États ont choisi de considérer les services d’IVG comme non essentiels, appelant du même coup à la suspension des activités des cliniques d’avortement pour permettre de sauvegarder des équipements de protection personnelle, de réaffecter les professionnels de la santé vers des services jugés essentiels et de réduire les risques de transmission du virus. De telles mesures sanitaires — qui, sous le couvert de la protection de la santé publique, relèvent souvent plutôt de visions politiques hostiles à l’avortement — ont fait l’objet de plusieurs dénonciations par les organisations médicales internationales et nationales ainsi que par les chercheurs[101]. Certains tribunaux ont également décrété que ces mesures étaient illégales, puisqu’elles mettent à risque les femmes de façon disproportionnée et injustifiée, sans qu’un lien rationnel clair avec les objectifs de santé publique poursuivis soit démontré[102].
3.2 Les soins prénatals
La période prénatale se déroule tout au long de la grossesse, soit jusqu’à ce que le travail menant à l’accouchement s’amorce. Les soins de la période prénatale comprennent donc le suivi de grossesse assuré par un professionnel de la santé (médecin omnipraticien, obstétricien ou sage-femme, avec des suivis infirmiers possibles également), mais aussi les autres interventions médicales ou psychosociales qui seront nécessaires durant cette période, comme les échographies obstétricales, les cours prénatals ou encore des procédures propres à chaque grossesse comme la vaccination de la femme, l’amniocentèse ou encore la version[103].
En matière de soins prénatals, les recommandations internationales liées à la pandémie de COVID-19 ont conclu que le recours à des consultations en télésanté pour les rendez-vous de routine et les patientes présentant des grossesses à faible risque était justifié, mais qu’il fallait tenir compte des possibles effets discriminatoires sur les populations à faible revenu ou n’ayant pas accès aux technologies nécessaires[104]. Dans plusieurs pays, le recours à la télésanté pour le suivi prénatal a effectivement augmenté au fil de la pandémie, alors que certains États ont plutôt réduit de manière draconienne le nombre de visites de suivi. Si l’usage systématique de la télésanté, sans discrétion quant aux besoins ou aux limitations spécifiques de chaque personne est une mesure qui porte atteinte aux droits des femmes de façon injustifiée et disproportionnée, réduire à moins de huit le nombre de rencontres de suivi au cours de la grossesse est également contraire aux données probantes, et entraîne des effets délétères sur les futures mères et les foetus qui surpassent les potentiels bénéfices liés au contrôle de la pandémie[105].
Au Québec, le gouvernement a formulé et mis à jour des directives ministérielles portant sur les services mère-enfant tout au long de la pandémie de COVID-19, afin de modifier l’offre, la prestation et l’organisation des soins au gré des changements épidémiologiques observés dans la transmission de la COVID-19[106]. Ces directives sont adaptées au fil du temps et varient selon les paliers d’alerte sanitaire en vigueur dans les différentes régions[107]. Elles prévoient notamment que le nombre de consultations prévues dans le suivi prénatal demeure le même ; cependant, les consultations en télésanté sont à prioriser pour certains rendez-vous des patientes en zones orange et rouge. On précise néanmoins que « [t]oute personne qui en fait la demande doit être vue en présentiel[108] », ce qui nous paraît une approche flexible susceptible de tenir compte des besoins de chaque femme et de ses limites inhérentes. Cette directive semble avoir été bien suivie par les établissements de santé[109].
En ce qui concerne la présence du partenaire ou d’une personne significative au moment du suivi prénatal, ce qui inclut les échographies obstétricales[110], les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquent qu’elle est permise à tous les paliers d’alerte[111]. Pourtant, les pratiques dans les établissements de santé varient considérablement d’une région à l’autre et d’un moment à l’autre, malgré les directives ministérielles inchangées depuis l’automne 2020[112]. Plusieurs cliniques médicales, ou d’imagerie médicale dans le cas des échographies, refusent toujours la présence d’un accompagnant ou d’une accompagnante, même lorsque cette personne et la femme enceinte résident à la même adresse[113]. Cette divergence entre les directives et l’application par certains établissements laisse entrevoir une atteinte disproportionnée aux droits des femmes, surtout si l’on considère les risques liés à la transmission de la COVID-19 en présence de deux personnes qui demeurent à la même adresse, par rapport aux bénéfices documentés de l’accompagnement prénatal. En effet, un accompagnement prénatal, et particulièrement par le second parent de l’enfant à naître, a des effets positifs sur la femme (meilleure santé physique et psychologique durant et après la grossesse), l’enfant (moins de risques de naissances prématurées, de petit poids à la naissance) et le second parent (associé à un engagement accru tout au long de la vie de l’enfant, à un plus grand sentiment de compétence parentale)[114]. Ces nombreux avantages semblent outrepasser largement les risques liés à la gestion pandémique.
3.3 L’accouchement et les soins postnatals
Plusieurs droits sont reconnus aux femmes au moment de l’accouchement et dans les premiers moments de la période postnatale, que ce soit par des normes officielles ou officieuses. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la littérature recense de nombreuses situations où des atteintes ont été portées à ces droits, trop souvent sans que ces atteintes soient proportionnelles et justifiées au regard des objectifs de protection de la santé publique. L’organisation internationale Human Rights in Childbirth a produit un rapport à la suite de la première vague de la pandémie de COVID-19 afin de préciser les mesures sanitaires adoptées dans divers pays, qui nuisaient aux droits des femmes dans les soins périnatals. Parmi ces atteintes injustifiées, des restrictions quant à la présence d’un accompagnant ou d’une accompagnante à l’accouchement ont été largement adoptées internationalement, notamment au Royaume-Uni, en Slovénie, en Allemagne, en Lituanie, en Hongrie, en Croatie, à Porto Rico, au Brésil, en Uruguay et en Argentine[115]. L’imposition de différents soins à l’occasion de l’accouchement pour des raisons sanitaires non liées à la condition obstétricale de la femme, sans consentement libre et éclairé, a également été documentée à plusieurs endroits, comme en Espagne (induction du travail, accouchement instrumentalisé et césarienne), en Croatie (césarienne imposée à toute femme suspectée d’avoir la COVID-19 ou d’en être porteuse), au Royaume-Uni (annulation d’une césarienne planifiée et induction du travail)[116], et au Canada — en Ontario — où au moins un hôpital demandait à toutes les femmes de recevoir la péridurale durant leur accouchement, pour éviter une anesthésie générale dans l’éventualité où une césarienne d’urgence s’avérerait nécessaire[117]. Au Québec également, la version provisoire d’un rapport sur le vécu de l’accouchement des femmes en période de pandémie a noté une hausse marquée des inductions hormonales du travail, le taux de référence de 24,9 % étant passé à 48,0 % selon les données colligées depuis le début de la pandémie de COVID-19[118].
Par ailleurs, l’adoption d’une mesure requérant la séparation forcée de la mère et du bébé dans certains hôpitaux en cas de COVID-19, soupçonnée ou avérée, constitue une importante atteinte au droit de la mère de ne pas être séparée de son enfant. Une telle pratique a pourtant été relevée à de nombreux endroits : Espagne, Malte, Roumanie, Royaume-Uni, Croatie, République tchèque, Australie et Argentine[119]. Dans les moments particulièrement importants que constituent les premières heures de vie d’un nouveau-né, et alors que les données médicales probantes ne font pas état de risques liés à la COVID-19 qui surpasseraient les bienfaits liés à la proximité mère–nouveau-né, on peut douter qu’une telle atteinte aux droits de la mère soit justifiée, nonobstant le contexte pandémique. Il est également intéressant de noter que la séparation de la mère et du nouveau-né peut empêcher l’initiation de l’allaitement de ce dernier. Dans ce cas, l’appréciation du risque pour la santé publique est mobilisée de façon très différente, en période de pandémie, qu’elle ne l’est normalement. En effet, on assiste au passage d’une quasi-injonction, en temps non pandémique, à l’allaitement au nom des bénéfices et des risques à la santé du bébé[120] à un déni de l’initiation à l’allaitement pour cause de risques de transmission de la COVID-19. Or, les données scientifiques ont rapidement démontré que l’allaitement pouvait, en fait, protéger le bébé de la COVID-19 par le passage d’anticorps de la mère dans le lait maternel. On peut donc se demander si le « risque » ici mobilisé vise véritablement le bébé ou le risque accru de transmission du virus au personnel soignant[121].
De façon générale, les mesures sanitaires adoptées au Québec en matière de soins périnatals et postnatals ont respecté les droits des femmes et les recommandations scientifiques diffusées à cet égard, mais certaines atteintes ont tout de même eu lieu de manière injustifiée. Le 3 avril 2020, l’Hôpital général juif de Montréal adoptait une politique de non-accompagnement pour toutes les femmes qui accouchaient au sein de son établissement[122]. Cette directive avait pour principal objectif de préserver la santé et la sécurité des équipes de soins et, par conséquent, d’assurer une continuité des services à l’unité des naissances. Cependant, des réactions d’opposition à ce protocole hospitalier se sont rapidement élevées, puisqu’il contredisait non seulement les orientations du Ministère, mais aussi les recommandations de l’OMS[123] en contexte de pandémie de COVID-19. Il est à regretter que le Ministère ne soit pas intervenu pour faire appliquer ses directives : il a plutôt indiqué respecter la position de l’Hôpital général juif[124]. Ce dernier a finalement modifié son protocole le 22 avril 2020, invoquant un changement à la situation épidémiologique. Dans les faits, la mesure n’a cessé d’être fortement contestée et n’a été suivie par aucun autre établissement de santé de la province[125], ce qui a sans doute contribué à son abandon.
Dans ses directives subséquemment produites, le Ministère maintient la recommandation d’un accompagnement à la naissance par le partenaire ou une personne significative pour tous les paliers d’alerte au Québec, et la présence d’une seconde personne est également permise pour les paliers d’alerte vert, jaune et orange[126]. Cette dernière directive vise particulièrement l’accompagnement par des doulas. Tout comme c’est le cas dans certains services prénatals et quant à la situation notée à l’Hôpital général juif en avril 2020, les directives ministérielles concernant l’accompagnement à la naissance par une seconde personne semblent connaître une réception variable dans les milieux de pratique. Ainsi, le Regroupement Naissances Respectées, l’Association québécoise des accompagnantes à la naissance, le Regroupement Les sages-femmes du Québec de même que le Mouvement pour l’autonomie dans la maternité et pour l’accouchement naturel déplorent le 5 avril 2021 que des hôpitaux situés dans des régions où le palier d’alerte est jaune ou orange refusent toujours la présence d’accompagnantes à la naissance aux femmes qui accouchent[127].
Si certaines mesures sanitaires liées à la périnatalité peuvent sembler anodines ou secondaires par rapport aux risques associés à la COVID-19, leurs conséquences sur les femmes ne doivent pourtant pas être sous-estimées. À l’aide d’un questionnaire standardisé de dépistage de la dépression postpartum, des chercheurs italiens ont mesuré les effets de certaines mesures sanitaires, tel que « replacing office visits with remote checkups, sending pregnant women to an offsite laboratory for blood tests, cancelling birth center tours and other nonessential visits, and barring extra people (fathers, doulas, and visitors) from the delivery room and postpartum units[128] », sur les symptômes de dépression postpartum des femmes deux jours après leur accouchement. Les données récoltées auprès des femmes en période de pandémie ont pu être comparées à celles d’un groupe de femmes ayant accouché en 2019. La mise en parallèle des résultats a permis de constater une hausse significative des symptômes généraux de dépression postpartum en période de pandémie de COVID-19 en comparaison de l’année 2019, et une augmentation absolue de 17 % du nombre de femmes présentant des symptômes graves de dépression postpartum (12 % en 2019 comparativement à 29 % en 2020)[129]. Sachant que la dépression postpartum peut avoir des effets importants, tant sur la santé générale de la mère que sur celle de l’enfant[130], on ne peut ignorer les risques pour la santé mentale de celles qui accouchent dans la mise en oeuvre de mesures sanitaires touchant la périnatalité.
Conclusion
Les années 2020 et 2021 auront connu une crise sanitaire mondiale majeure, faisant basculer la planète entière dans une salve de restrictions des libertés individuelles au profit de la prévention ou du contrôle du coronavirus responsable de la maladie à coronavirus 19. Les soins de santé reproductive des femmes n’ont pas fait exception à ces restrictions, parfois au détriment de leurs droits. Si d’aucuns croient, à juste titre nous semble-t-il, qu’une grande part des mesures sanitaires imposées étaient justifiées et respectaient un équilibre entre libertés individuelles et intérêt collectif, force est de constater que certains excès ont tout de même eu lieu en matière de soins de santé reproductive.
Des mesures draconiennes dans les soins offerts aux femmes, pouvant porter gravement atteinte à leurs droits et à leur autonomie reproductive, ont parfois été adoptées au nom de la santé publique et de la lutte contre le coronavirus. Dans certains États, le choix de considérer les IVG comme des soins non essentiels et d’en ordonner la suspension complète est un exemple patent de mesure qui ne peut être justifiée ni par le recours au principe de précaution en santé publique, ni par une proportionnalité entre les conséquences de l’atteinte aux droits et les bienfaits poursuivis par l’objectif. Qui plus est, une telle mesure cache bien souvent des biais et des positions politiques opposées à l’avortement, ce qui fait de la pandémie un faux prétexte pour limiter l’accès aux soins d’IVG.
Au Québec, l’analyse comparée des mesures sanitaires adoptées pour affronter la pandémie de COVID-19 au regard des droits des femmes en matière de santé reproductive permet de constater, globalement, un équilibre et une proportionnalité entre la protection de la santé publique et le respect de leurs droits. La décision de l’Hôpital général juif d’interdire complètement l’accompagnement des femmes durant l’accouchement, au printemps 2020, constitue toutefois un exemple d’atteinte injustifiée et disproportionnée à leurs droits, et illustre également les limites de l’effectivité des directives ministérielles en période de pandémie, qui peuvent être ignorées par les établissements de santé sans entraîner de conséquence d’un point de vue strictement légal.
Par ailleurs, espérons que les nombreux enjeux de respect des droits des femmes en matière de santé reproductive qui ont été soulevés, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, que ce soit par les associations nationales et internationales en santé reproductive ou par la littérature scientifique, pourront entraîner, dans un avenir rapproché, une meilleure reconnaissance de leurs droits positifs. Pensons, par exemple, à la présence d’un accompagnant ou d’une accompagnante au moment de l’accouchement, de même qu’à certaines normes mises en évidence et reconnues comme étant favorables à une expérience positive de la maternité, tant d’un point de vue scientifique que du respect des droits de la personne, qui devraient être explicitement reconnues par le droit étatique afin d’en assurer une meilleure effectivité[131].
En médecine, et plus particulièrement en oncologie, lorsqu’un cancer n’est pas agressif, et qu’il présente peu de risques de porter atteinte à la santé ou à la qualité de vie de la personne qui en souffre, alors que des traitements auraient des effets secondaires néfastes, on privilégiera généralement une approche d’attente vigilante (watchful waiting). Une analogie avec cette approche paraît tout à fait applicable à la situation qui semble se dessiner pour les mois à venir, c’est-à-dire une situation épidémiologique moins virulente (une régression des cas de COVID-19) et, parallèlement à ce recul, des « traitements » de santé publique dont les effets secondaires apparaissent maintenant plus délétères pour la population.
Alors que s’esquissent et se mettent déjà en application des mesures de déconfinement, la vigilance sera de mise pour que les droits des femmes en matière de santé reproductive retrouvent leur pleine portée au détour de la pandémie. Si certaines mesures adoptées portaient atteinte à ces droits, mais pouvaient se justifier dans une perspective de précaution et de proportionnalité des atteintes eu égard à la protection de la santé publique, il faudrait veiller à ce qu’elles soient effectivement abandonnées lorsque leur justification ne sera plus pertinente. Les propos de Simone de Beauvoir, déjà cités à de nombreuses reprises durant cette crise sanitaire, ne sauraient mieux conclure notre texte : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse [et, ajoutons ici, sanitaire] pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant[132]. »
Appendices
Remerciements
L’autrice tient à remercier chaleureusement Malorie Kanaan, étudiante à la maîtrise en droit à l’Université d’Ottawa, pour son aide précieuse à la recherche, de même que sa collègue Mariève Lacroix pour sa relecture attentive et éclairante d’une version provisoire du présent texte. Elle remercie également les évaluateurs et les évaluatrices de son texte pour leurs suggestions fort pertinentes.
Notes
-
[1]
The Lancet, « The Gendered Dimensions of COVID-19 », The Lancet, vol. 395, 2020, p. 1168 ; Jaunathan Bilodeau et Amélie Quesnel-Vallée, « Covid-19 : un impact plus grand chez les femmes », The Conversation, 3 juin 2020, [En ligne], [theconversation.com/covid-19-un-impact-plus-grand-chez-les-femmes-138287] (25 septembre 2021).
-
[2]
Marie-Eve Fournier, « Des solutions féministes à une récession féminine », La Presse, 19 avril 2021, [En ligne], [www.lapresse.ca/affaires/economie/2021-04-19/budget-federal/des-solutions-feministes-a-une-recession-feminine.php] (25 septembre 2021). Pour une critique féministe du budget, voir Pascale Dangoisse et Gabriela Perdomo, « Féministe, le nouveau budget Freeland ? Pas vraiment ! », The Conversation, 29 avril 2021, [En ligne], [theconversation.com/feministe-le-nouveau-budget-freeland-pas-vraiment-159663] (25 septembre 2021).
-
[3]
Voir, par exemple, Nofar Yakovi Gan-Or, « Going Solo : The Law and Ethics of Childbirth during the COVID-19 Pandemic », (2020) 7 J. Law Biosci. 1.
-
[4]
Aux fins de notre texte et par souci de concision, nous parlerons désormais de « femmes » ou de « patientes » afin d’éviter d’alourdir le texte en référant systématiquement aux deux genres. Cependant, nous tenons à souligner que cette façon de faire n’a pas pour objectif de nier l’existence ou la légitimité des personnes ne s’identifiant pas comme femmes, et pouvant tout de même avoir recours à des soins de santé reproductive associés au sexe féminin.
-
[5]
Emmanuelle Bernheim et Christine Vézina, « La trajectoire normative dans le domaine de la santé : entre normes officielles et officieuses », Interrogations, no 6, 2008, [En ligne], [revue-interrogations.org/La-trajectoire-normative-dans-le] (18 octobre 2021).
-
[6]
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)] (ci-après « Charte canadienne »).
-
[7]
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (ci-après « Charte québécoise »).
-
[8]
Louise Langevin, Le droit à l’autonomie procréative des femmes : entre liberté et contrainte, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 3 : « Ma réflexion se fonde sur la prémisse selon laquelle la classe sociale “femmes” doit jouir du droit à l’autonomie procréative, qu’il soit basé sur le droit à l’égalité, à la liberté, à la vie privée, à la sécurité, à l’intégrité physique ou à la santé. » Dans notre texte, nous avons choisi de cibler plus précisément des droits susceptibles d’avoir été atteints par les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.
-
[9]
Charte canadienne, préc., note 6, art. 7 : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. » Charte québécoise, préc., note 7, art. 1 al. 1 : « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. »
-
[10]
Charte canadienne, préc., note 6, art. 15 (1) : « La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. » Charte québécoise, préc., note 7, art. 10 :
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
-
[11]
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.
-
[12]
Id., 166. La Cour suprême ajoute, plus loin au même paragraphe, que « ce droit, bien interprété, confère à l’individu une marge d’autonomie dans la prise de décisions d’importance fondamentale pour sa personne ». Voir également Audrey Ferron-Parayre, Donner un consentement éclairé à un soin : réalité ou fiction ?, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, p. 42 et 43.
-
[13]
R. c. Morgentaler, préc., note 11, 56 et 57.
-
[14]
Par exemple, voir l’analyse quant au droit à l’égalité présentée dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, 99 (ci-après « arrêt Nouveau-Brunswick ») (motifs concurrents des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin, rendus par la juge L’Heureux-Dubé), et qui sera discutée ultérieurement dans notre texte.
-
[15]
Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753 (ci-après « arrêt Dobson »).
-
[16]
Id., par. 86.
-
[17]
L. Langevin, préc., note 8, no 35, p. 30.
-
[18]
Id., no 34, p. 30 ; Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, L.C. 1968-69, c. 38, art. 18.
-
[19]
Sur les obstacles systémiques à l’accès aux contraceptifs oraux, voir L. Langevin, préc., note 8, no 39, p. 33.
-
[20]
Id., no 76, p. 65 ; R. c. Morgentaler, préc., note 11. Voir également l’affaire Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, sur l’absence de personnalité juridique du foetus.
-
[21]
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 10 (ci-après « C.c.Q. »).
-
[22]
Id., art. 11. Pour une critique des pratiques en matière de consentement libre et éclairé dans le contexte de l’accouchement, voir : Marlène Cadorette, Le consentement libre et éclairé de la parturiente en droit québécois, thèse de doctorat, Québec, Faculté de droit, Université Laval, 2006 ; L. Langevin, préc., note 8, p. 278 et suiv.
-
[23]
Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 9 (ci-après « LSSSS »).
-
[24]
Id., art. 4.
-
[25]
Id., art. 6. L’alinéa 2 de cet article prévoit néanmoins ceci : « Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter une personne. » Par ailleurs, le choix du professionnel et de l’établissement par la patiente est tout de même nuancé par l’article 13 de la LSSSS, qui pose des limites à cette liberté : « Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l’établissement prévus aux articles 5 et 6, s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. » Voir Robert p. Kouri et Catherine Régis, « La limite de l’accès aux soins définie par l’article 13 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : véritable exutoire ou simple mise en garde ? », (2013) 72 R. du B. 177.
-
[26]
LSSSS, préc., note 23, art. 9.2. À noter que cet article, entré en vigueur en 2016 et adopté dans le contexte de la Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 2016, c. 28, art. 75, a pour principal objectif d’assurer le libre accès aux soins d’interruption volontaire de grossesse (IVG) par les femmes. Voir Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission de la santé et des services sociaux, 1re sess., 41e légis., 29 novembre 2016, « Étude détaillée du projet de loi no 92 – Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et modifiant diverses dispositions législatives », 16 h (M. Barrette).
-
[27]
LSSSS, préc., note 23, art. 10.
-
[28]
Id., art. 11.
-
[29]
Bien que ce soit un enjeu de fertilité important, nous n’aborderons pas dans notre texte les questions touchant au recours à la gestation pour autrui (GPA), car cet aspect dépasse largement le contexte des modifications apportées aux soins et aux services de santé reproductive en temps de pandémie de COVID-19. Pour un exemple des effets de la pandémie sur cet enjeu, voir notamment Anis Tsoukanova, « À Kiev, des bébés nés de mères porteuses attendent leurs parents », La Presse, 15 mai 2020, [En ligne], [www.lapresse.ca/international/europe/2020-05-15/a-kiev-des-bebes-nes-de-mere-porteuses-attendent-leurs-parents] (25 septembre 2021).
-
[30]
Loi sur la procréation assistée, L.C. 2004, c. 2 (ci-après « LPA »). Voir aussi le Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, [2010] 3 R.C.S. 457, 2010 CSC 61, qui a invalidé de grands pans de la LPA au motif que les dispositions empiétaient sur les domaines de compétences constitutionnelles des provinces en matière d’organisation des soins de santé. La LPA est par ailleurs complétée par plusieurs règlements, dont le Règlement modifiant le Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi), DORS/2019-195 (Gaz. Can. II).
-
[31]
Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, RLRQ, c. A-5.01.
-
[32]
Id., art. 10.3.
-
[33]
Loi modifiant diverses dispositions en matière de procréation assistée, L.Q. 2021, c. 2, art. 18-20, 31 et 32.
-
[34]
Id., art. 32.
-
[35]
Human Rights in Childbirth, [Page d’accueil], 2018, [En ligne], [www.humanrightsinchildbirth.org/] (25 septembre 2021).
-
[36]
Human Rights in Childbirth, Human Rights Violations in Pregnancy, Birth and Postpartum during the COVID-19 Pandemic, 6 mai 2020, p. 3, [En ligne], [humanrightsinchildbirth.org/wp-content/uploads/2020/05/Human-Rights-in-Childbirth-Pregnancy-Birth-and-Postpartum-During-COVID19-Report-May-2020.pdf] (25 septembre 2021).
-
[37]
Birthrights, « Human Rights in Maternity Care », avril 2017, [En ligne], [www.birthrights.org.uk/factsheets/human-rights-in-maternity-care/] (25 septembre 2021). Voir également Rebecca Schiller, Why Human Rights in Childbirth Matter, Londres, Pinter & Martin, 2016 (l’autrice, Rebecca Schiller, est l’une des fondatrices de l’organisation Birthrights).
-
[38]
Birthrights, « Birth Partners », avril 2017, [En ligne], [www.birthrights.org.uk/factsheets/birth-partners/] (25 septembre 2021).
-
[39]
Birthrights, « Choice of Place of Birth », avril 2017, [En ligne], [www.birthrights.org.uk/factsheets/choice-of-place-of-birth/] (25 septembre 2021).
-
[40]
Pour sa part, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive, résumé d’orientation, Genève, 2016, p. 1 (ci-après « Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals »), définit une expérience positive de grossesse comme « la préservation de l’intégrité physique et socioculturelle, [le fait de] vivre une grossesse saine pour la mère et l’enfant […], [de] bien vivre le travail et l’accouchement et [d’]avoir une maternité heureuse (concept couvrant notamment la confiance en soi, la compétence et l’autonomie des mères) ». Une expérience positive d’accouchement se définit par l’OMS, Recommandations de l’OMS sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l’accouchement, résumé, Genève, 2016, p. 1 (ci-après « Recommandations de l’OMS sur les soins intrapartum »), « comme une expérience qui remplit ou dépasse les attentes et croyances sociales, culturelles et personnelles existantes d’une femme, ce qui inclut l’accouchement d’un enfant en bonne santé dans un environnement clinique et psychologique sûr avec le soutien pratique et émotionnel continu d’un ou de plusieurs compagnons d’accouchement et de personnel clinique bienveillant et compétent sur le plan technique ».
-
[41]
Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals, préc., note 40, p. 9.
-
[42]
Recommandations de l’OMS sur les soins intrapartum, préc., note 40, p. 5.
-
[43]
Id., p. 6.
-
[44]
Id., p. 7.
-
[45]
Id., p. 8.
-
[46]
International Federation of Gynecology and Obstetrics et autres, « FIGO Guideline : Mother-baby Friendly Birthing Facilities », International Journal of Gynecology and Obstetrics, vol. 128, 2015, p. 95, à la page 96.
-
[47]
Nicole Doré et Danielle Le Hénaff, Mieux vivre avec votre enfant. Guide pratique pour les parents de la grossesse à deux ans, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 2020, p. 195-197.
-
[48]
Toutefois, si l’État choisit d’intervenir, il ne peut le faire d’une façon qui porte atteinte aux droits et aux libertés fondamentaux, notamment au droit à l’égalité.
-
[49]
Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S-2.2.
-
[50]
Décret 177-2020 concernant une déclaration d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique, (2020) 152 G.O. II, 1101A.
-
[51]
Décret 699-2021 concernant le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire conformément à l’article 119 de la Loi sur la santé publique, (2021) 153 G.O. II, 2411A.
-
[52]
Loi sur la santé publique, préc., note 49, art. 123 :
Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population :
1° ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés ;
2° ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement ;
3° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel ;
4° interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, [à] leur ravitaillement et [à] leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ;
5° ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux ;
6° requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister les effectifs déployés ;
7° faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires ;
8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.
Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.
-
[53]
Id., art. 2 al. 2.
-
[54]
Marie-Claude Prémont, Marie-Eve Couture-Ménard et Geneviève Brisson, « L’état d’urgence sanitaire au Québec : un régime de guerre ou de santé publique ? » (2021) 55 R.J.T. 233. Nous ne traiterons pas dans notre texte des modalités propres au renouvellement périodique de l’état d’urgence sanitaire, ou encore aux contestations judiciaires des mesures adoptées. Pour des analyses fort intéressantes sur ces aspects, consulter notamment : Marie-Claude Prémont et Marie-Eve Couture-Ménard, « Le concept juridique de l’urgence sanitaire : une protection contre les virus biologiques et… politiques », Blogue du Centre d’études constitutionnelles, 22 octobre 2020, [En ligne], [www.constitutionalstudies.ca/2020/10/le-concept-juridique-de-lurgence-sanitaire-une-protection-contre-les-virus-biologiques-et-politiques/] (4 octobre 2021) ; Michelle Giroux, « Réflexions sur la mise en oeuvre de la Loi sur la santé publique au Québec dans le contexte de la pandémie de COVID-19 », dans Colleen Flood et autres (dir.), Vulnerable : The Law, Policy and Ethics of COVID-19, Ottawa, University of Ottawa Press, 2020, p. 69 ; Paul Daly, « Governmental Power and COVID-19 : The Limits of Judicial Review », dans C. Flood et autres (dir.), préc., note 54, p. 211.
-
[55]
Loi sur la santé publique, préc., note 49, art. 123.
-
[56]
Id., art. 124 al. 2 : « Pendant un état d’urgence sanitaire, le ministre agit avec l’assistance du directeur national de santé publique et les ordres ou directives donnés par le directeur national de santé publique doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre. »
-
[57]
Id., art. 123. Voir également l’article 5 : « Les actions de santé publique doivent être faites dans le but de protéger, de maintenir ou d’améliorer l’état de santé et de bien-être de la population en général et elles ne peuvent viser des individus que dans la mesure où elles sont prises au bénéfice de la collectivité ou d’un groupe d’individus. »
-
[58]
Charte canadienne, préc., note 6.
-
[59]
Charte québécoise, préc., note 7.
-
[60]
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (ci-après « arrêt Oakes »).
-
[61]
M.-Cl. Prémont et M.-È. Couture-Ménard, préc., note 54 ; Colleen Flood, Brian Thomas et Kumanan Wilson, « Civil Liberties vs. Public Health », dans C. Flood et autres, préc., note 54, p. 249, à la page 257.
-
[62]
Michel Désy et autres, Enjeux éthiques de la pandémie de COVID-19 : précaution et déconfinement, Québec, Comité d’éthique de santé publique, Commission de l’éthique en science et en technologie, 2020, p. 5 et 6.
-
[63]
Le SARS-CoV-2 est le virus responsable de la maladie à coronavirus 2019, aussi appelée « COVID-19 ».
-
[64]
C. Flood, B. Thomas et K. Wilson, préc., note 61.
-
[65]
M. Désy et autres, préc., note 62.
-
[66]
Michel Désy et autres, Cadre de réflexion sur les enjeux éthiques liés à la pandémie de COVID-19, Québec, Comité d’éthique de santé publique, Commission de l’éthique en science et en technologie, 2020, p. 3, où les auteurs parlent du principe de « prudence », mais se réfèrent plutôt au principe de précaution dans un rapport suivant pour aborder ce même concept (p. 8) : « Dans le cadre, nous parlons de prudence plutôt que de précaution. Nous considérons ces notions comme en bonne partie synonymes. Par contre, le principe de précaution possède une forme plus cristallisée, par son inclusion dans des textes de lois et conventions. De ce fait, son utilisation est balisée par une littérature assez abondante. »
-
[67]
C. Flood, B. Thomas et K. Wilson, préc., note 61, à la page 253.
-
[68]
Id., à la page 254 ; The Lancet, « Caution Required with the Precautionary Principle », The Lancet, vol. 356, no 9226, 2000, p. 265.
-
[69]
C. Flood, B. Thomas et K. Wilson, préc., note 61 ; Commission des communautés européennes, Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution, COM (2000) 1 final, Bruxelles, 2 février 2000.
-
[70]
M. Désy et autres, préc., note 66, p. 5 ; M. Désy et autres, préc., note 62, p. 8 : « Enfin, le principe de précaution doit être appliqué de façon proportionnelle : il doit y avoir un équilibre entre les gains en santé anticipés par les mesures ou les actions proposées, d’une part, et les conséquences négatives qui en découleront, et de préférence, une balance favorable aux gains. »
-
[71]
M. Désy et autres, préc., note 62, p. 8.
-
[72]
C. Flood, B. Thomas et K. Wilson, préc., note 61, à la page 258.
-
[73]
On peut définir un heuristique, sommairement, comme un processus mental simplifié, sorte de « raccourci » que le cerveau emprunte pour parvenir plus rapidement à une décision ou porter un jugement.
-
[74]
Linda c. Fentiman, Blaming Mothers : American Law and the Risks to Children’s Health, New York, New York University Press, 2017, p. 40 : « the psychosocial processes of risk construction affect law makers at all levels, including the legislators and administrative agency policymakers who make decisions about managing risks ».
-
[75]
Olivier Oullier, « Délibérations au tribunal : jugements, décisions, biais et influences », Arch. phil. droit 2012.269.
-
[76]
Voir généralement : Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, New York, Farrar, Straus & Giroux, 2011 ; Paul Slovic, The Perception of Risk, Londres, Routledge, 2000 ; Paul Slovic, The Feeling of Risk. New Perspectives on Risk Perception, Londres, Routledge, 2010.
-
[77]
Par ailleurs, ces différences de perception ne sont pas associées au niveau d’éducation, au statut socioéconomique ou à la littératie scientifique, des variables qui auraient pu expliquer les écarts de perceptions, mais qui ne sont finalement pas concluantes : L.C. Fentiman, préc., note 74, p. 29.
-
[78]
Shai Danziger, Jonathan Levav et Liora Avnaim-Pesso, « Extraneous Factors in Judicial Decisions », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 108, no 17, 2011, p. 6889.
-
[79]
Arrêt Nouveau-Brunswick, préc., note 14.
-
[80]
Id., 77 et 78 (motifs du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Binnie, rendus par le juge en chef Lamer).
-
[81]
L.C. Fentiman, préc., note 74, p. 46. Voir également Louise Langevin, « Mythes et réalités : la personne raisonnable dans le livre Des obligations du Code civil du Québec », (2005) 26 C. de D. 353, 361 : « Les critiques féministes ont analysé le modèle de la personne raisonnable pour en dénoncer le caractère faussement neutre et universel. Elles ont démontré le caractère androcentrique de ce modèle, peu importe le nom qu’il porte, “personne raisonnable” ou “bon père de famille”, tout comme le caractère androcentrique du concept de faute ». La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Dobson, préc., note 15, par. 53 (j. Cory), a d’ailleurs expressément reconnu la subjectivité de la norme d’une conduite raisonnable, dans le contexte de l’évaluation du comportement d’une femme enceinte : « Cette norme objective permettrait au juge des faits de dicter, selon sa propre conception de la conduite maternelle appropriée, la façon dont une femme enceinte doit se comporter au cours de sa grossesse. »
-
[82]
Arrêt Nouveau-Brunswick, préc., note 14, 99 (motifs concurrents des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin, rendus par la juge L’Heureux-Dubé).
-
[83]
Voir Aya Aboelenien, Zeynep Arsel et Charles H. Cho, « Passing the Buck versus Sharing Responsibility : The Roles of Government, Firms, and Consumers in Marketplace Risks during COVID-19 », Journal of the Association for Consumer Research, vol. 6, no 1, 2021, p. 149.
-
[84]
Voir notamment Anne Plourde, « La solution est avant tout entre les mains des gouvernements », Blogue de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), 3 octobre 2020, [En ligne], [www.iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/a21be086-6abb-42cb-a9dc-26f8713f8325/] (5 octobre 2021).
-
[85]
L.C. Fentiman, préc., note 74, p. 46-48, 178 et suiv.
-
[86]
O. Oullier, préc., note 75, 271 : « En effet, nombreux sont les éléments influençant nos décisions qui opèrent sous notre seuil de conscience ».
-
[87]
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, « Pandémie de la COVID-19 – Reprise graduelle des services de procréation médicalement assistée », Québec, Gouvernement du Québec, 15 mai 2020, [En ligne], [www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2113/] (6 octobre 2021). Voir aussi Isabelle Paré, « Baisse “historique” des naissances en vue en raison de la pandémie », Le Devoir, 5 décembre 2020, [En ligne], [www.ledevoir.com/societe/591083/coronavirus-baisse-historique-des-naissances-en-vue] (6 octobre 2021). L’arrêt des traitements et des services pendant plusieurs mois a créé une hausse subséquente de la demande, qui, combinée à l’annonce gouvernementale d’une couverture publique d’un cycle de FIV, fait craindre des délais d’attente supplémentaires pour l’accès aux services : Fanny Samson, « Hausse des consultations en procréation assistée durant la pandémie », Radio-Canada, 21 décembre 2020, [En ligne], [ici.radio-canada.ca/nouvelle/1758528/procreation-assistee-quebec-fecondation-in-vitro-pandemie-covid] (6 octobre 2021).
-
[88]
Jennifer L. Gordon et Ashley A. Balsom, « The Psychological Impact of Fertility Treatment Suspensions during the COVID-19 Pandemic », PLoS ONE, 18 septembre 2020, [En ligne], [journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239253] (18 octobre 2021).
-
[89]
Reut Ben-Kimhy et autres, « Fertility Patients under COVID-19 : Attitudes, Perceptions and Psychological Reactions », Human Reproduction, vol. 35, no 12, 2020, p. 2774.
-
[90]
Anna Tippett, « Life on Pause : An Analysis of UK Fertility Patients’ Coping Mechanisms after the Cancellation of Fertility Treatment Due to COVID-19 », Journal of Health Psychology, 8 mars 2021, [En ligne], [journals-sagepub-com.acces.bibl.ulaval.ca/doi/pdf/10.1177/1359105321999711] (8 octobre 2021) ; Jacky Boivin et autres, « Patient Experiences of Fertility Clinic Closure during the COVID-19 Pandemic : Appraisals, Coping and Emotions », Human Reproduction, vol. 35, 2020, p. 2556.
-
[91]
Jenna M. Turocy et autres, « The Emotional Impact of the ASRM Guidelines on Fertility Patients during the COVID-19 Pandemic », Fertility & Sterility, vol. 114, 2020, p. e63.
-
[92]
Juliana Rigol Chachamovich et autres, « Investigating Quality of Life and Health-Related Quality of Life in Infertility : A Systematic Review », Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, vol. 31, no 2, 2010, p. 101.
-
[93]
A. Tippett, préc., note 90, p. 13, citant Carlo Alviggi et autres, « COVID-19 and Assisted Reproductive Technology Services : Repercussions for Patients and Proposal for Individualized Clinical Management », Reproductive Biology and Endocrinology, vol. 18, 2020, [En ligne], [rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-020-00605-z] (8 octobre 2021).
-
[94]
Jason Hitkari et Goldi Gill, « Mise à jour de la COVID-19 #11 : Le 30 septembre 2020 », Société canadienne de fertilité et d’andrologie, 2020, [En ligne], [cfas.ca/CFAS_Communication_on_COVID-19_Fr.html] (8 octobre 2021) : « Nous recommandons que les soins de fertilité restent accessibles tout au long de la phase de résurgence de la pandémie. »
-
[95]
Certains États multiplient les lois restreignant l’accès aux avortements, avec l’objectif parfois avoué que les contestations à cet égard se rendent à la Cour suprême des États-Unis afin que cette dernière puisse à nouveau légitimer l’illégalité de l’IVG. Voir notamment : Sébastien Blanc, « L’avortement de plus en plus menacé aux États-Unis », La Presse, 3 juin 2016, [En ligne], [www.lapresse.ca/international/etats-unis/201606/03/01-4988126-lavortement-de-plus-en-plus-menace-aux-etats-unis.php] (8 octobre 2021) ; Rafael Jacob, « États-Unis : le droit à l’avortement menacé », L’actualité, 26 mai 2021, [En ligne], [lactualite.com/monde/etats-unis/la-plus-grande-menace-au-droit-a-lavortement-en-30-ans/] (8 octobre 2021) ; Félix Pominville Archambault, « En matière d’accès à l’avortement, les États-Unis rencontrent-ils leurs obligations internationales en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? », (2019) 32 R.Q.D.I. 203.
-
[96]
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), COVID-19 et interruption volontaire de grossesse. Réponse rapide, Québec, INESSS, 27 mars 2020, p. 2.
-
[97 ]
Id., p. 1 et 4.
-
[98 ]
Marie-Ève Cousineau, « Chute marquée des avortements en 2020 », Le Devoir, 6 avril 2021, [En ligne], [www.ledevoir.com/societe/sante/598270/sante-chute-marquee-des-avortements-en-2020] (8 octobre 2021).
-
[99 ]
Christabelle Sethna et Marion Doull, « Spatial Disparities and Travel to Freestanding Abortion Clinics in Canada », Women’s Studies International Forum, vol. 38, 2013, p. 52.
-
[100]
Louis Gagné, « La crise sanitaire menace l’accès à l’avortement au Canada, selon des organismes », Radio-Canada, 31 mars 2020, [En ligne], [ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689733/pandemie-coronavirus-menace-acces-soins-avortement-canada-ivg] (8 octobre 2021).
-
[101]
Aux États-Unis : Michelle J. Bayefsky, Deborah Bartz et Katie L. Watson, « Abortion during the COVID-19 Pandemic – Ensuring Access to an Essential Health Service », New England Journal of Medicine, vol. 382, no 19, 2020, p. e47 ; Greer Donley, Beatrice A. Chen et Sonya Borrero, « The Legal and Medical Necessity of Abortion Care Amid the COVID-19 Pandemic », Journal of Law and the Biosciences, vol. 7, no 1, 2020, [En ligne], [www.doi.org/10.1093/jlb/lsaa013] (8 octobre 2021) ; Rachel K. Jones, Laura D. Lindberg et Elizabeth Witwer, « COVID-19 Abortion Bans and their Implications for Public Health », Perspectives on Sexual and Reproduction Health, vol. 52, no 2, 2020, p. 65. En Italie : Andrea Cioffi, Fernanda Cioffi et Raffaella Rinaldi, « COVID-19 and Abortion : The Importance of Guaranteeing a Fundamental Right », Sexual & Reproductive Healthcare, vol. 25, 2020, [En ligne], [www.doi.org/10.1016/j.srhc.2020.100538] (8 octobre 2021). Portrait de la situation européenne : Caroline Moreau et autres, « Abortion Regulation in Europe in the Era of COVID-19 : A Spectrum of Policy Responses », BMJ Sexual & Reproductive Health, 2020, [En ligne], [www.doi.org/10.1136/bmjsrh-2020-200724] (8 octobre 2021). Position de l’organisation Médecins Sans Frontières : Manisha Kumar et autres, « Now Is the Time : A Call for Increased Access to Contraception and Safe Abortion Care during the COVID-19 Pandemic », BMJ Global Health, vol. 5, 2020, p. e003175. Perspective de droit international : Jaime Todd-Gher et Payal K. Shah, « Abortion in the Context of COVID-19 : A Human Rights Imperative », Sexual and Reproductive Health Matters, vol. 28, no 1, 2020, [En ligne] [doi.org/10.1080/26410397.2020.1758394] (18 octobre 2021).
-
[102]
M.J. Bayefsky, D. Bartz et K.L. Watson, préc., note 101 ; J. Todd-Gher et P.K. Shah, préc., note 101.
-
[103]
La vaccination prénatale proposée à la femme enceinte, au Québec, comprend généralement la vaccination antigrippale et le vaccin contre la coqueluche (N. Doré et D. Le Hénaff, préc., note 47, p. 133). L’amniocentèse est un test diagnostique pour certaines maladies chromosomiques du foetus qui est offert aux femmes présentant des grossesses à risque élevé (p. 131). La version est proposée aux femmes dont le foetus se présente par le siège dans les semaines précédant l’accouchement. Elle consiste à « tourner [le] bébé pour le placer la tête en bas, à l’aide de manipulations externes uniquement » (p. 190).
-
[104]
Rebecca B. Reingold, Isabel Barbosa et Ranit Mishori, « Respectful Maternity Care in the Context of COVID-19 : A Human Rights Perspective », International Journal of Gynecology and Obstetrics, vol. 151, 2020, p. 319.
-
[105]
Id., aux pages 319 et 321.
-
[106]
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Directive ministérielle DGPPFC-010.REV1 – COVID-19 : Plan 2e vague : Services mère-enfant, Québec, 18 novembre 2020, [En ligne], [publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/archives/dgppfc-010-rev1.pdf] (8 octobre 2021) (ci-après « Plan 2e vague – 18 novembre 2020 ») ; Ministère de la Santé et des Services sociaux, Directive ministérielle DGPPFC-010.REV2 – COVID-19 : Plan 2e vague : Services mère-enfant, Québec, 22 janvier 2021, [En ligne], [publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/archives/dgppfc-010-rev2_pj_plan-2e-vague-mere-enfant.pdf] (8 octobre 2021) (ci-après « Plan 2e vague – 22 janvier 2021 ») ; Ministère de la Santé et des Services sociaux, Directive ministérielle DGPPFC-010.REV3 – COVID-19 : Plan 3e vague : Services mère-enfant, Québec, 12 avril 2021, [En ligne], [publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgppfc-010-rev3_pj_plan-3e-vague-mere-enfant.pdf] (8 octobre 2021) (ci-après « Plan 3e vague – 12 avril 2021 »).
-
[107]
Rappelons que quatre paliers d’alerte distincts ont été établis selon différentes variables prises en considération par la santé publique de chaque région ou sous-région, notamment le nombre d’infections par 100 000 habitants, les hospitalisations régulières et aux soins intensifs ainsi que le nombre de foyers d’éclosion : palier d’alerte 1 (zone verte), palier d’alerte 2 (zone jaune), palier d’alerte 3 (zone orange) et palier d’alerte 4 (zone rouge).
-
[108]
Plan 2e vague – 22 janvier 2021, préc., note 106, p. 2 ; Plan 3e vague – 12 avril 2021, préc., note 106, p. 2.
-
[109]
La recherche effectuée n’a pas permis de trouver de l’information sur le fait que des femmes au Québec auraient eu moins de rencontres de suivi de grossesse que ce qui est habituellement recommandé.
-
[110]
Un suivi de grossesse « normale » comporte généralement deux échographies obstétricales, la première ayant lieu entre la 11e et la 13e semaine de grossesse (datation et, le cas échéant, clarté nucale) et la seconde, entre la 22e et la 26e semaine de grossesse (morphologie du foetus).
-
[111]
Plan 2e vague – 22 janvier 2021, préc., note 106, p. 9 ; Plan 3e vague – 12 avril 2021, préc., note 106, p. 9.
-
[112]
Déjà, la première révision du Plan 2e vague – 18 novembre 2020, préc., note 106, p. 7, prévoyait que la présence d’un partenaire ou d’une personne significative en prénatal était autorisée pour tous les paliers d’alerte.
-
[113]
En date du 12 février 2021 par exemple, la clinique OVO à Montréal refusait toujours que la femme enceinte soit accompagnée pour les échographies obstétricales prénatales.
-
[114]
Analia F. Aljuba et autres, « The Effect of Paternal Cues in Prenatal Care Settings on Men’s Involvement Intentions », PLosOne, vol. 14, no 5, 2019, [En ligne], [www.doi.org/10.1371/journal.pone.0216454] (8 octobre 2021) ; Natasha J. Cabrera, Jay Fagan et Danielle Farrie, « Explaining the Long Reach of Fathers’ Prenatal Involvement on Later Paternal Engagement », Journal of Marriage and Family, vol. 70, no 5, 2008, p. 1094.
-
[115]
Human Rights in Childbirth, préc., note 36, p. 8 et 9. Voir également R. Rima Jolivet et autres, « Upholding Rights under COVID-19 : The Respectful Maternity Care Charter », (2020) 22 Health Hum. Rights 391 ; Kirstie Coxon et autres, « The Impact of the Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Maternity Care in Europe », Midwifery, vol. 88, 2020, [En ligne], [www.doi.org/10.1016/j.midw.2020.102779] (8 octobre 2021).
-
[116]
Human Rights in Childbirth, préc., note 36, p. 12. Voir également Michelle Sadler, Gonzola Leiva et Ibone Olza, « COVID-19 as a Risk Factor for Obstetric Violence », Sexual and Reproductive Health Matters, vol. 28, no 1, 2020, p. 46.
-
[117]
Human Rights in Childbirth, préc., note 36, p. 11, citant Katie Griffin, « Almonte Hospital Requesting Pregnant Women Get Epidurals Amid COVID-19 », CTV News, 2020, [En ligne], [www.ottawa.ctvnews.ca/almonte-hospital-requesting-pregnant-women-get-epidurals-amid-covid-19-1.4891727] (8 octobre 2021).
-
[118]
Accoucher en pandémie, Rapport préliminaire, 25 septembre 2020, p. 12, [En ligne], [accoucherenpandemie.ca/wp-content/uploads/2021/04/accoucherenpandemie_rapportprelim.pdf] (8 octobre 2021).
-
[119]
Human Rights in Childbirth, préc., note 36, p. 13 et 14. Voir également Riccardo Davanzo, Anne Merewood et Paolo Manzoni, « Skin-to-Skin Contact at Birth in the COVID-19 Era : In Need of Help ! », American Journal of Perinatology, vol. 37, 2020, no 2, p. S1.
-
[120]
Annick Vallières, « Remise en question de l’institution de la maternité illustrée par le cas de l’allaitement maternel », dans Appréhender, documenter et répondre aux inégalités sociales et à leurs effets : perspectives de jeunes chercheurs du CREMIS, actes de colloque, Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS), 2017, p. 41.
-
[121]
Durant le séjour hospitalier qui suit la naissance, le personnel soignant vérifie l’état général du nouveau-né beaucoup plus souvent que celui de la mère. Le guide Mieux vivre avec votre enfant détaille par exemple quelques soins apportés au nouveau-né durant le séjour au lieu de naissance, d’une durée de 24 à 36 heures : injection de vitamine K, onguent antibiotique dans les yeux, examen physique complet, dépistage sanguin (N. Doré et D. Le Hénaff, préc., note 47, p. 243 et 244). La proximité entre une mère infectée et son nouveau-né peut dès lors poser plus de risque de transmission au personnel soignant qui se voit, dans cette situation, exposé à la charge virale de la mère à chaque visite au nouveau-né.
-
[122]
Julien McEvoy, « Les futures mamans devront accoucher sans leur proche à l’Hôpital général juif », Radio-Canada, 3 avril 2020, [En ligne], [ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690988/accouchements-les-accompagnateurs-interdits-a-lhopital-general-juif] (12 février 2022).
-
[123]
Andréanne Malacket et autres, « L’accouchement en solo, un risque à la santé des femmes et des enfants », Le Devoir, 6 avril 2020, [En ligne], [www.ledevoir.com/opinion/idees/576510/l-accouchement-en-solo-un-risque-a-la-sante-des-femmes-et-des-enfants] (8 octobre 2021) ; Annabelle Caillou, « Vent de résistance pour soutenir les femmes enceintes », Le Devoir, 6 avril 2020, [En ligne], [www.ledevoir.com/societe/576505/vent-de-resistance-pour-aider-les-femmes-enceintes?fbclid=IwAR1USyqrFIOROka3WMBJmzfbrazUgktqWX%E2%80%A6] (8 octobre 2021).
-
[124]
A. Caillou, préc., note 123.
-
[125]
Guillaume Lepage, « L’Hôpital général juif permet à nouveau l’accompagnement à l’accouchement », Le Devoir, 23 avril 2020, [En ligne], [www.ledevoir.com/societe/sante/577543/l-hopital-general-juif-recule-sur-l-accompagnement-a-l-accouchement] (8 octobre 2021).
-
[126]
Plan 2e vague – 18 novembre 2020, préc., note 106, p. 7 et 8 ; Plan 3e vague – 12 avril 2021, préc., note 106, p. 8 et 9.
-
[127]
Accoucher en pandémie, « Zones jaune et orange : respectez les droits des femmes et des personnes qui accouchent ! », communiqué de presse, 5 avril 2021, [En ligne], [www.accoucherenpandemie.ca/zones-jaune-et-orange-respectez-les-droits-des-femmes-et-des-personnes-qui-accouchent] (8 octobre 2021).
-
[128]
Vincenzo Zanardo et autres, « Psychological Impact of COVID-19 Quarantine Measures in Northeastern Italy on Mothers in the Immediate Postpartum Period », International Journal of Gynecology & Obstetrics, vol. 150, 2020, p. 184, à la page 185.
-
[129]
Id., à la page 186.
-
[130]
Justine Slomian et autres, « Consequences of Maternal Postpartum Depression : A Systematic Review of Maternal and Infant Outcomes », Women’s Health, vol. 15, 2019, p. 1.
-
[131]
N.Y. Gan-Or, préc., note 3, 15.
-
[132]
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome II « L’expérience vécue », Paris, Gallimard, 1949.