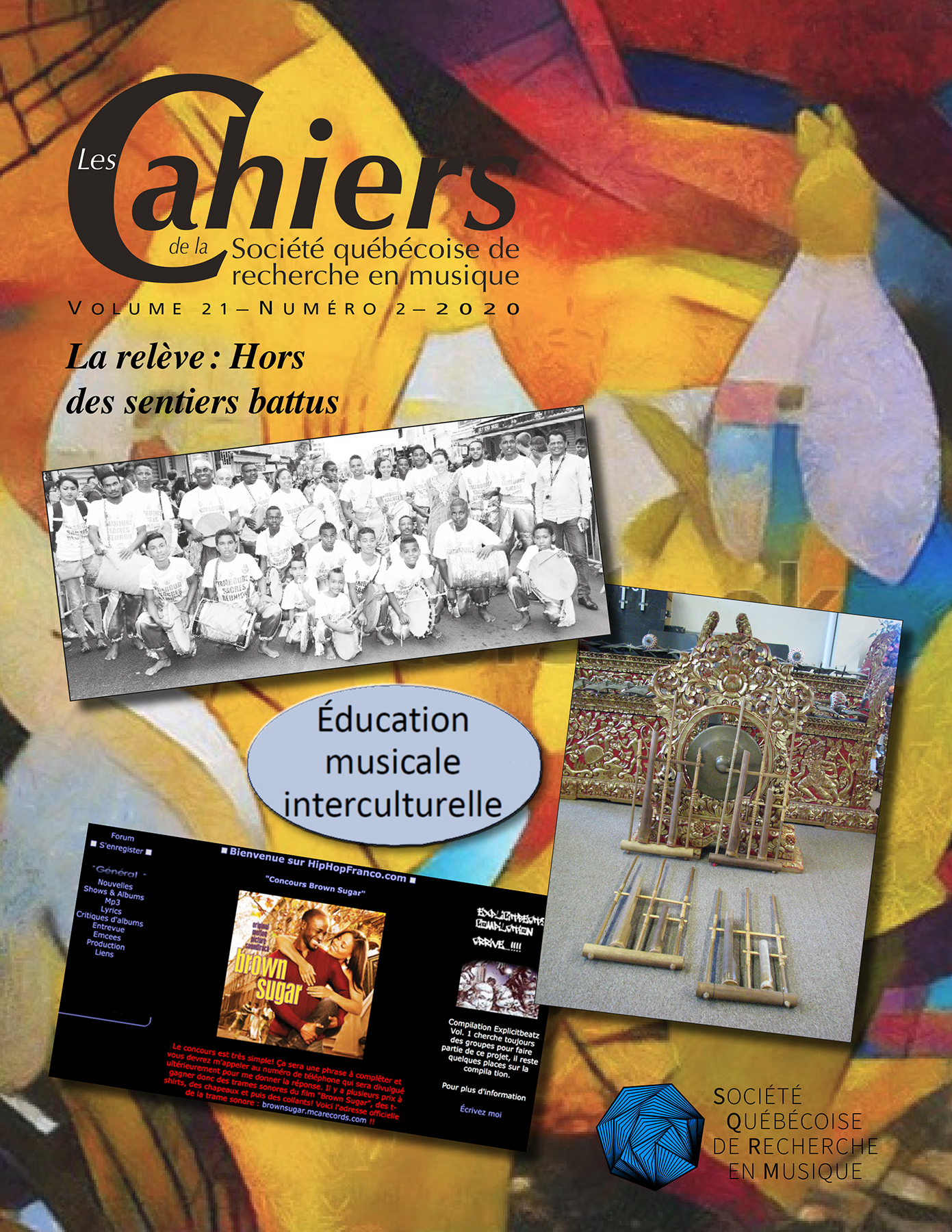Article body
L’historiographie musicale a longtemps accordé la préférence aux compositeurs sur les interprètes, à la musique symphonique et de chambre sur l’opéra, à l’opéra italien sur l’opéra français ; et oui, aux hommes plutôt qu’aux femmes. Il reste donc encore beaucoup à découvrir et à écrire sur les cantatrices qui ont pratiqué les genres lyriques français au xixe siècle. Un article daté de 1994 par Mary Ann Smart consacré à la mezzo-soprano française Rosine Stoltz a d’abord montré la voie[1]. Ce n’est que depuis la fin des années 2000 que, parmi les musicologues d’expression anglaise, les chercheur·e·s Karen Henson, Steven Huebner, Kerry Murphy, Sean Parr, Hilary Poriss, Clair Rowden ou Flora Willson ont contribué à éclairer les figures de Pauline Viardot, Caroline Carvalho, Christine Nilsson, Céléstine Galli-Marié, Nellie Melba, Sibyl Sanderson, Emma Calvé[2] : autant de noms incontournables pour quiconque fréquente ces répertoires créés par des femmes jusqu’ici largement méconnues. Le cas de Viardot, également compositrice et animatrice culturelle, est probablement celui qui suscite le plus d’intérêt. Delphine Ugalde, dont la biographie n’est pas moins passionnante, mériterait peut-être elle aussi une attention plus poussée : si on exclut le livre qui nous occupe ici, elle n’a eu droit, à ma connaissance, qu’à une unique apparition dans un article de Delphine Mordey sur la musique durant la Commune de Paris[3].
Ce n’est pas un hasard si les cantatrices que je viens d’évoquer ont plutôt tendance à être des célébrités du Second Empire et de la Troisième République : le développement de la presse et du vedettariat au cours de la seconde moitié du xixe siècle a facilité la tâche aux historiens, en leur fournissant à la fois une masse de renseignements et un cadre d’analyse. Si on peut qualifier le champ de recherche ouvert en 2006 par le livre de Susan Rutherford The Prima Donna and Opera, 1815–1930 de « prima donna studies », il faut reconnaître qu’il a fait la part belle à ce type particulier de prima donna qu’est la diva de la fin du xixe siècle et du début du xxe[4].
Le livre de Kimberly White Female Singers on the French Stage, 1830–1848 vient à la fois s’insérer dans ce champ des prima donna studies et en atténuer l’insistance sur la diva (en se rapprochant peut-être davantage de l’intention originelle de Rutherford). White s’intéresse à l’artiste lyrique non pas en tant que diva, mais en tant que travailleuse ; non pas à l’individu, mais au collectif ; non pas à la créature extraordinaire qui ne saurait se soumettre aux conventions sociales, mais à des femmes auxquelles on reproche, au contraire, d’être trop ordinaires et trop rangées. La littérature sur les divas de la Troisième République est souvent à l’image de leur iconographie : des portraits en costume de scène à l’expression et aux couleurs intenses, tel celui de Galli-Marié en Carmen par Henri-Lucien Doucet ou celui de Rose Caron en Salammbô par Léon Bonnat. Le livre de White, au contraire, est fidèle à l’illustration choisie pour la jaquette : une lithographie au clair-obscur très doux qui rassemble, sur un plan d’égalité et sans signes distinctifs, six artistes de la scène parisienne du début des années 1830.
Le portrait de groupe de la jaquette est un portrait « [d’]actrices » au sens qu’avait le mot au xixe siècle, tous genres théâtraux confondus : y figurent trois cantatrices du Théâtre-Italien et deux comédiennes. White, quant à elle, se borne au personnel de l’Opéra et de l’Opéra-Comique, les deux compagnies qui, encore sous la Monarchie de Juillet, détenaient le monopole des genres lyriques français. Mais ce qu’elle dessine ici, c’est bel et bien un portrait de groupe. À la rigueur, on pourrait reconstruire l’âge d’or du grand opéra français à partir de seulement quatre interprètes : Laure Cinti-Damoreau, la créatrice de La Muette de Portici, Guillaume Tell et Robert le Diable ; Julie Dorus-Gras et Cornélie Falcon, les deux sopranos de Gustave III, La Juive et Les Huguenots ; et Rosine Stoltz, la protagoniste des grands opéras de la fin des années 1830 et du début de la décennie 1840, dont La Favorite. C’est l’approche qu’adopte Karin Pendle, pionnière des études sur l’opéra romantique français récemment disparue, dans un article sur la prima donna parisienne de 1830 à 1850[5] qui ne prend en considération qu’un petit nombre de cantatrices. Le projet de White est d’une tout autre envergure, comme en témoigne l’annexe où figurent les résumés biographiques de dizaines d’artistes, parmi lesquelles on retrouve les grandes gloires de l’Opéra tout comme des musiciennes n’ayant pas connu le succès. White affirme s’être penchée sur « la vie et la carrière de près de cent interprètes, des premiers rôles jusqu’aux “ratées[6]” » (p. 1). En outre, l’autrice est sensible au fait que les sources publiées (coupures de presse, littérature) témoignent souvent de fantasmes masculins plutôt que des portraits de femmes réelles — d’où la nécessité de s’appuyer, comme elle le fait, sur des sources d’archives.
Bien qu’elle n’emploie pas le mot prosopographie, d’ailleurs peu courant en anglais, la démarche de White se rapproche de cette méthodologie qui consiste à tracer une biographie collective d’un milieu social à partir des biographies individuelles de ses membres. Quoique le titre de l’ouvrage soit Female Singers au pluriel, le livre est une biographie collective de la cantatrice française. La répartition en chapitres scande les étapes successives de la vie de cette cantatrice idéal-typique : la formation, les débuts, les conditions de travail, la vie privée et le retrait de la scène. Cette articulation fait émerger deux axes de conflictualité, deux contradictions de fond qui font en sorte que la cantatrice s’expose à des sollicitations concurrentes. La plus évidente est bien entendu la contradiction entre l’artiste et la femme honnête : la cantatrice est censée à la fois se démarquer des conventions sociales au nom du culte romantique du génie et s’y conformer au nom de la morale bourgeoise. Cela revient à dire que les cantatrices « étaient soit la propriété de leurs maris, soit celle du public (masculin[7]) » (p. 89). Le spectre de la « cantatrice mariée » fait l’objet d’une véritable panique morale où, en apparence, ce serait l’excès de pudeur qui ferait scandale. Mais à y regarder de plus près, l’enjeu est le droit des hommes à disposer des femmes, comme le révèle on ne peut plus clairement le critique Henri Blanchard : « toute actrice […] doit être du domaine public » (p. 192). Ceux qui sont familiers avec la France fin-de-siècle savent que les choses ne vont pas beaucoup s’améliorer après la Monarchie de Juillet. Le Figaro publie à la une, en date du 15 août 1886, un article d’Henry Fouquier qui porte le même titre que celui de Blanchard plus de cinquante ans auparavant : « Les Actrices mariées ». Le contenu n’a pas trop changé non plus : Fouquier prend comme prétexte les tout récents mariages d’Adelina Patti et de Christine Nilsson pour insinuer que les femmes de théâtre célibataires rendent un service à la société en assurant l’apprentissage sentimental et sexuel des jeunes hommes avant qu’ils se marient.
L’autre contradiction qui traverse Female Singers on the French Stage concerne moins spécifiquement les femmes que la Monarchie de Juillet. Elle n’est pas mise en avant de façon aussi explicite, mais émerge néanmoins de la juxtaposition des chapitres sur la formation des cantatrices et sur leur milieu professionnel. Il s’agit de la tension entre ce qu’on pourrait appeler l’artiste-fonctionnaire et l’artiste-entrepreneuse. En lisant les pages consacrées au Conservatoire de Paris, on peut conclure que, selon le modèle hérité de la Restauration, l’Opéra et l’Opéra-Comique sont des grands corps de l’État, que leurs artistes sont de haut·e·s fonctionnaires, et que le Conservatoire est la grande école qui prépare les candidat·e·s à ces postes. Les termes sont certes anachroniques, mais les concepts ne le sont pas forcément : le Conservatoire, après tout, a été fondé lors de la réorganisation des formations spécialisées entreprise en 1794 et 1795 par la Convention thermidorienne et le Directoire, qui a également produit l’École Polytechnique et le premier embryon de la future École normale supérieure. Si on décide de voir ici à l’oeuvre un idéal méritocratique (encore un terme anachronique…), les observations de White — chiffres à l’appui — sur l’origine sociale des cantatrices sont d’autant plus pertinentes. Les histoires d’ascension fulgurante, de la misère jusqu’au sommet de la gloire — lesquelles, comme le remarque White, relèvent davantage de la fantaisie que de la réalité —, serviraient précisément à valider cet idéal méritocratique. Le stéréotype littéraire de la petite fille pauvre à la voix d’ange devenue prima donna serait alors au corps des artistes lyriques de l’État ce que le proverbial soldat portant dans sa giberne le bâton de maréchal est à l’armée. (À la liste que dresse White des incarnations de ce stéréotype, on pourrait ajouter, quelques décennies plus tard, l’héroïne de La Tosca de Victorien Sardou). L’endogamie dans les milieux théâtraux et la transmission intergénérationnelle de la profession, quant à elles, seraient des indices de ce que la sociologie bourdieusienne qualifie de reproduction de corps[8]. Il serait intéressant, à ce propos, d’élargir le regard aux artistes de la Comédie-Française, de façon à avoir une vision globale des parcours des « actrices » rattachées aux théâtres d’État.
À partir des années 1830, pourtant, ce modèle est remis en question. L’Opéra et l’Opéra-Comique se réorientent vers une gestion managériale, et les artistes se voient offrir toujours davantage de perspectives d’enrichissement, mais toujours moins de stabilité et de protection. On ressent, à la lecture de cet ouvrage, qu’un fossé se creuse entre la formation assurée par le Conservatoire et le marché du travail théâtral. Des élèves que les classes de chant du Conservatoire ont préparées à une carrière de fonctionnaires se retrouvent à devoir se frayer un chemin dans un monde où le « laisser-faire » capitaliste règne impitoyablement. Pour éclairer les défis auxquels sont confrontées les cantatrices, White dispose d’un atout inattendu et précieux. À plusieurs reprises, elle recourt à des mémoires inédits de Delphine Ugalde, qu’elle a pu consulter au musée de la Mutuelle nationale des artistes. Et qui mieux qu’Ugalde pour représenter le nouveau type d’artiste-entrepreneuse ? La carrière de cette interprète d’opéra-comique, d’opérette et de féerie couvre en effet l’Opéra-Comique, le Théâtre-Lyrique et les théâtres commerciaux, sans oublier l’expérience qu’elle acquiert comme titre de directrice de théâtre. On pourrait penser que l’inclusion d’Ulgade, fondamentalement une artiste du Second Empire dont les débuts remontent à 1848, serait déplacée dans un livre sur la Monarchie de Juillet. Au contraire, elle est tout à fait justifiée : non seulement il serait insensé de se priver d’une source aussi rare que ses mémoires, mais on apprécie mieux le nouveau marché du travail en se plaçant en aval dans le temps, de la même façon qu’il faut se placer en amont pour comprendre le Conservatoire.
Malheureusement, les mémoires d’Ugalde font figure d’exceptions parmi les documents dont nous disposons. White, on l’a dit, est déterminée à ne pas laisser les hommes parler à la place des femmes dont elle se préoccupe ; en même temps, elle est pleinement consciente que ses tentatives de restituer la voix des femmes se heurtent à des sources limitées. Elle arrive pourtant à montrer que la cantatrice de cette époque pouvait profiter au mieux des espaces d’autonomie que la loi et les conventions sociales lui accordaient. Et son livre est aussi une réussite à un autre égard. Le plus naturel, ou le plus facile, quand on écrit sur des interprètes, c’est de les réduire à leurs rôles, ou de considérer que leur contribution la plus significative à l’histoire de la musique consiste en leur association avec les compositeurs. Ces tendances deviennent à la fois plus prononcées et plus problématiques s’il s’agit d’interprètes féminines. Mais une fois la lecture de Female Singers on the French Stage terminée, on se rend compte qu’il est possible d’écrire un livre entier en parlant de la cantatrice pour elle-même, et jamais de la cantatrice en tant que muse. Et c’est rafraîchissant.
Appendices
Notes
-
[1]
Mary Ann Smart (1994). « The Lost Voice of Rosine Stoltz », Cambridge Opera Journal, vol. 6, n° 1, p. 31-50.
-
[2]
Karen Henson (2015). Opera Acts: Singers and Performance in the Late Nineteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press ; Steven Huebner (2009). « La princesse paysanne du Midi », dans Annegret Fauser et Mark Everist (dir.), Music, Theater, and Cultural Transfer: Paris, 1830-1914, Chicago, The University of Chicago Press ; Kerry Murphy (2011). « Melba’s Paris Debut: Another White Voice? », Musicology Australia, vol. 33, n° 1, p. 3-13 ; Sean M. Parr (2011). « Caroline Carvalho and NineteenthCentury Coloratura », Cambridge Opera Journal, vol. 23, n° 12, p. 83117 ; Hilary Poriss (2015). « Pauline Viardot, Travelling Virtuosa », Music and Letters, vol. 96, n° 2, p. 185-208 ; Clair Rowden (2019). « Deferent Daisies: Caroline Miolan Carvalho, Christine Nilsson and Marguerite, 1869 », Cambridge Opera Journal, vol. 30, n° 2-3, p. 237-258 ; Flora Willson (2010). « Classic staging: Pauline Viardot and the 1859 Orphée revival », Cambridge Opera Journal, vol. 22, n° 3, p. 301-326.
-
[3]
Delphine Mordey (2010). « Moments musicaux : High Culture in the Paris Commune », Cambridge Opera Journal, vol. 22, n° 1, p. 1-31.
-
[4]
Susan Rutherford (2006). The Prima Donna and Opera, 1815-1930, Cambridge, Cambridge University Press ; Voir aussi Rachel Cowgill et Hilary Poriss (dir.) (2012). The Arts of the Prima Donna in the Long Nineteenth Century, Oxford, Oxford University Press ; et Karen Henson (dir.) (2016). Technology and the Diva: Sopranos, Opera, and Media from Romanticism to the Digital Age, Cambridge, Cambridge University Press.
-
[5]
Karin Pendle (1986). « A Night at the Opera: The Parisian Prima Donna, 1830–1850 », The Opera Quarterly, vol. 4, n° 1, p. 77-89
-
[6]
« The lives and careers of almost one hundred performers, from the lead artists to the “failures” » (p. 1).
-
[7]
« Either […] belonged to their husbands or they belonged to the (male) public » (p. 89).
-
[8]
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron (1970). La Reproduction, Paris, Les Éditions de minuit.